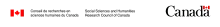Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 300 - Lettres, arts et sciences humaines
Description :L’industrie audiovisuelle doit conjuguer, depuis 2007, avec le développement d’un nombre croissant de services de TPC, à savoir des plateformes de vidéo à la demande (VOD) permettant de visionner des productions audiovisuelles en flux continu (streaming) sur Internet. Dans ce contexte caractérisé par la migration des pratiques de visionnement en ligne, ce colloque vise à mettre en lumière les études francophones qui se déploient autour de ce phénomène médiatique, mais aussi plus spécifiquement les pratiques culturelles et œuvres audiovisuelles produites en contexte francophone.
La recherche sur la production audiovisuelle francophone à l’ère du streaming — qu’il s’agisse des plateformes elles-mêmes, des œuvres produites, ou encore des enjeux de production ou de réception propres à ces contextes — accuse un retard important. Si l’hégémonie des services de VOD transnationaux (Netflix, Prime Video, AppleTV+, Disney+, etc.), de propriété états-unienne, contribue à marginaliser l’offre audiovisuelle dans d’autres langues que l’anglais, elle nuit également à la production scientifique. En effet, la recherche tend à marginaliser l’étude des industries et productions médiatiques en milieux francophones; même les études réalisées en français se concentrent, pour une large part, sur les services et productions anglophones, compte tenu de la légitimité culturelle dont elles bénéficient. Les ouvrages collectifs portant sur la culture du streaming font également peu de cas des productions francophones.
Peu d’études sont donc réalisées afin de documenter les œuvres audiovisuelles qui sont produites en langue française à l’ère numérique, de même que l’état des services de streaming et l’articulation des pratiques de visionnement connecté ou en rafale (binge watching) en contexte francophone. Soulignons également que derrière les plateformes les plus populaires se cachent de nombreux services de VOD de portée nationale (ICI TOU.TV, Club Illico, Crave, FranceTV Slash, etc.) ou transnationale (TV5MONDE), qui ont un rôle important à jouer en faveur de la diffusion de contenus francophones en ligne.
Ce colloque entend ainsi contribuer à une meilleure étude des médias et productions audiovisuelles francophones à l’ère du streaming et du visionnement en rafale (binge watching), de même qu’à une réflexion sur l’état des études médiatiques en français. Cette rencontre scientifique favorisera également la mise en commun de diverses expertises afin de parvenir à une compréhension plus détaillée des spécificités des cultures médiatiques francophones à l’ère numérique.
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsable : Partenaires :Programme
Plateformes francophones : stratégies de production et de curation
-
Communication orale
De l’analyse des plateformes « locales » dans le secteur audiovisuel : quand des éléments d’analyse nous invitent à repenser les méthodes mobiliséesÉric George (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Financée par le CRSH, notre recherche a pour objectif d’analyser les places et rôles des plateformes créées depuis les années 2010 dans les transformations des filières du cinéma et de la télévision. Elle repose sur la mise en évidence (1) des éléments présentant une certaine continuité dans les modalités de fonctionnement des deux filières, (2) des éléments qui invitent à penser certaines émergences susceptibles de favoriser de nouvelles modalités de fonctionnement et (3) des éléments susceptibles de favoriser d’éventuelles ruptures dans le développement de ces deux filières (sur les continuités et émergences).
Nous proposons de porter ici notre attention sur les activités de plateformes "locales", à savoir celles de trois des principales entreprises du secteur audiovisuel au Canada et au Québec : (1) Crave (Bell Canada), (2) Club Illico (Québecor), (3) ICITOU.TV et CBC GEM (Société Radio-Canada) en présentant des éléments d’analyse invitant à penser à la fois en termes de continuités, d’émergences et de ruptures éventuelles en expliquant ceux-ci à partir de la prise en compte des histoires particulières des entreprises, mais également du fait que notre corpus comprend des plateformes de taille "locale". Ce sera l’occasion de constater dans quelle mesure il apparaît pertinent ou non d’appliquer les mêmes critères d’observation pour l’analyse des activités des entreprises transnationales et des entreprises locales dans les développements respectifs de leurs plateformes.
-
Communication orale
Cinéma Sur Demande : Universiciné et CinémutinsYlenia Olibet (Université Concordia)
Cette proposition vise à contribuer aux études médiatiques francophones à l’ère du streaming en examinant deux études de cas françaises : les plateformes Universciné et Cinémutins. Ces plateformes se présentent comme des alternatives tant à l'hégémonie des plateformes VOD américaines qu'aux plateformes développées par les chaînes de télévision, grâce à leur modèle organisationnel, leur offre et leur éditorialisation de contenu.
Universciné se définit comme une "plateforme VOD dédiée au cinéma indépendant", offrant des "films emblématiques du cinéma indépendant contemporain", y compris des films "en marge du système de distribution". Quant à Cinémutins, elle propose une sélection "de films qui font référence dans le cinéma politique, l’histoire sociale, les luttes sous toutes leurs formes".
Bien que différentes, ces deux plateformes, avec le soutien du CNC, ont pour objectif principal la diffusion du cinéma d'auteur, indépendant et militant, en assurant son exploitation, sa visibilité et sa diffusion commerciale. Mon analyse portera d'abord sur leurs modèles d'organisation, y compris les partenariats avec des festivals de cinéma dans le cas d'Universciné, et la relation directe avec les réalisateurs dans le cas de Cinémutins. Ensuite, mon analyse se penchera sur les stratégies d'éditorialisation des films sur les deux plateformes. Ainsi, je m'interrogerai sur la manière dont ces plateformes se positionnent en tant que circuits alternatifs aux plateformes mainstream.
-
Communication orale
Pratiques du visionnage en ligne: analyse de la plateforme MyCanal en Afrique francophoneFranck Mbadinga (Sorbonne Nouvelle)
Le groupe Canal+ voulant élargir son influence en Afrique francophone s’est lancé dans une programmation labélisée à travers sa plateforme MyCanal (LAFON, 2021). Cette application montre que le processus de circulation des produits audiovisuels pousse certains agents à l’intérieur du marché audiovisuel à établir des coopérations dans l’optique d’améliorer ses intérêts.
Il nous apparait important de poser un regard sur les enjeux de la production et de la réception des contenus MyCanal. Culturellement, le déploiement du groupe de télévision Canal+ en Afrique francophone à l’heure de la diversité culturelle est essentiellement un moyen d’élargir le champ culturel africain dans son envie de s’ouvrir au monde. Ainsi, quels sont les enjeux propres à la production médiatique francophone à l’ère numérique de MyCanal ? Quelle est la fréquence des pratiques de visionnement de MyCanal en contexte francophone ? Cette communication constitue une tentative de réponse à ces questions à travers la caractérisation de cette plateforme. Pour cette étude, la méthodologie retenue a été définie en fonction des objectifs et des conditions de consommation de notre cible. Elle repose sur l’analyse des données de Médiamétrie de 2023 recueillies auprès des clients gabonais souscripteurs de la mesure d’audience des programmes diffusés sur MyCanal. Ces données nous permettront de faire une étude de cas de la plateforme, dans une approche de la production du marché médiatique (SONNAC & GABSZEWICZ, 2013).
La plateformisation de la production audiovisuelle : entre local et global
-
Communication orale
Netflix et la production locale pour le marché international. Le cas du film québécois Jusqu’au Déclin (2020)Lucile Ouriou (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Le thriller Jusqu’au déclin (2020) de Patrice Laliberté fut le premier film original québécois commandé par Netflix. Fruit d'un bras de fer entre les producteurs et les diffuseurs du Québec et Netflix, Jusqu'au Déclin a su conquérir la critique québécoise, mais aussi se hisser dans le top cinq des contenus, non anglais dans sa forme originale, les plus visionnés au Canada en 2020 (Caillou 2020). Loin d’être un cas isolé, ce film s’inscrit dans une tendance initiée déjà visible depuis plusieurs années chez Netflix, à savoir de s’imposer comme un distributeur et producteur incontournable de l’industrie cinématographique mondiale.
Les plateformes de streaming ont défini les usages, mais ils ont aussi su rebattre les cartes de ces industries, en déstabilisant des entreprises historiques mieux implantées, mais "plus structurellement rétives à l’innovation de rupture" (Durand, 2016, p.65).
Netflix est-il le remplaçant des productions classiques des majors pour la création et la promotion de réalisations locales à destination d’un public international? Et comment mesurer le “succès” d’un film à l’ère des plateformes de streaming, où les critères d’audience, de rentabilité et de qualité sont rendus généralement opaques par Netflix? Cette contribution vise à comprendre les leviers du “succès” du film Jusqu'au Déclin pour ainsi explorer la question de la globalisation culturelle et du discours entourant la circulation des œuvres audiovisuelles non anglophones par Netflix.
-
Communication orale
À l’ombre de PornHub : les plateformes pornographiques québécoisesEric Falardeau (Université Laval)
La pornographie québécoise produite pour et diffusée sur internet par SVoD est un sujet insuffisamment documenté et étudié. Alors que le géant Mindgeek, qui a bâti son empire à partir de Montréal, bénéficie d’une littérature importante, autant du côté journalistique, les joueurs locaux (Ad4x, Pegas Productions) sont ignorés par les chercheurs.es, et ce, pour de multiples raisons : influence dérisoire des contenus sur la scène internationale, absence de données ou de statistiques d’écoute, renseignements inexistants sur le profil de leurs membres, opacité de leurs structures d’entreprise ou encore jugements de valeur négatifs entourant la qualité de leurs productions. Ce désintérêt des universitaires pour notre pornographie témoigne d’un plus large problème portant sur ce type de contenus : le manque d’analyse entourant les particularités nationales, voire locales, au détriment des pays producteurs dominants (États-Unis, France, Italie).
Cette communication vise d’abord à établir une première cartographie de l’écosystème pornographique québécois sur le web. Nous procéderons ensuite à une analyse plus ciblée des contenus offerts par ces derniers afin de proposer une définition de ce que serait la "pornographie québécoise". Des méthodes de recherche quantitatives seront mobilisées pour comparer les différents acteurs tandis que des méthodes qualitatives serviront à cerner la situation particulière de la pornographie québécoise francophone en ligne.
-
Communication orale
Créer des séries qui voyagent : Les productions "françaises globales" d'ArteMichael Gott (University of Cincinnati)
Les séries européennes sont promues via diverses initiatives économiques et culturelles régionales, nationales et européennes, notamment le forum industriel Séries Mania et le programme de coproduction télévisuelle Creative Europe. De nombreuses séries sont ainsi produites grâce à une alliance européenne informelle qui comprend à la fois des diffuseurs publics et privés, de même que des approches similaires de narration qui traversent les frontières culturelles et nationales. Ainsi, même les séries qui, en apparence, proviennent d'une seule industrie nationale sont imprégnées d'histoires de création et de production plus complexes.
Un acteur français clé dans ce réseau diversifié est Arte. Avec des assises en France et en Allemagne, Arte se présente comme "la chaîne culturelle européenne". Malgré ce surnom, Arte s’est mutée en plateforme et atteint un public croissant via la VOD. Afin de diversifier ses séries et d'élargir son audience au-delà de la France (et de l'Allemagne), Arte a également mis en place une variété de partenariats de coproduction, en particulier en Europe. Cette communication examinera leur stratégie de contenu visant à créer des séries qui oscillent entre l'attrait local et transnational. Plus précisément, je me concentrerai sur l’exemple de DNA (Danemark/France, 2019-2022), le fruit d’une stratégie qui vise des partenariats multipartites (3+) qui aboutissent à des intrigues et des trajectoires à l'écran manifestement multinationales.
Lunch
Quelle place pour les œuvres passées sur la VOD ?
-
Communication orale
“Ça appartient au Québec cette série-là” : retour sur le débat médiatique autour de la mise en ligne des nouveaux épisodes de La petite vieThomas Carrier-Lafleur (UdeM - Université de Montréal)
Production culte de la télévision québécoise s’il n’en fut jamais, La petite vie occupe, comme on le sait, une place particulière dans nos imaginaires collectifs depuis ses débuts dans les années 1990, au point où l’émission a dépassé le simple statut d’œuvre d’art ou de produit culturel pour devenir un phénomène de société. Son retour sous la forme de six nouveaux épisodes, d’abord exclusivement disponibles sur ICI TOU.TV, dans sa section EXTRA, a été accueilli avec une grande anticipation, mais aussi avec une certaine appréhension de la part du public comme de la critique. Claude Meunier, créateur de l’émission, ne s’est d’ailleurs pas retenu pour désavouer le choix de Radio-Canada d’offrir cette nouvelle saison en primeur sur son service de VOD, défendant l’idée que la série "appartient au Québec".
Avec la présente communication, nous souhaitons revenir sur les "enjeux" – pour les cartographier, d’abord, et aussi pour en déconstruire certains – qui ont été abordés et débattus dans la foulée de la mise en ligne de ces épisodes, en octobre 2023. Au-delà de ces réactions immédiates, cette polémique, certes relativement modeste, mais néanmoins symptomatique, soulève des questions plus larges sur l’identité québécoise, la diversité culturelle et les défis de la diffusion numérique de contenu patrimonial. Elle nous invite, en définitive, à réfléchir sur la place de la culture québécoise et de ses archétypes dans un environnement numérique en constante évolution.
-
Communication orale
(Re)construire le passé : la rediffusion en contexte de streamingJessie Morin (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Si la rediffusion d’anciennes séries télévisées croît en popularité sur les plateformes de streaming, contribuant ainsi à garder vivantes des oeuvres comme Seinfeld, Friends ou Gilmore Girl, elles se heurtent aux débats contemporains de sociétés en pleine construction. Le Québec n’échappe pas à ces enjeux. En 2022, quelques jours après l’arrivée de la télésérie historique Les filles de Caleb (1989-1990) sur sa plateforme, Netflix retire le deuxième épisode en raison de la représentation d’un "blackface". Les réactions se font alors entendre dans l’espace public québécois. On y décèle un discours alliant l’oeuvre, le patrimoine et l’identité.
Dans le cadre de cette présentation à l’intersection de la Public History et des études culturelles, nous observerons les spécificités des mesures mises en place par les plateformes Tou.tv et Netflix quant au deuxième épisode des Filles de Caleb, en plus d’analyser la réaction d’une dizaine de chroniqueur.euses à la suite de l’événement. Ces textes d’opinion mettent en lumière le sentiment nostalgique lié à une pratique de visionnement de plus en plus désuète à l’heure du streaming. Ils permettent également une réflexion sur un contenu destiné à un auditoire des années 1990 en contexte actuel. Cette communication pose un regard nouveau sur l’évolution des rapports qu’entretient le public avec le passé, en plus d’enrichir les réflexions sur la représentation de référents culturels québécois à l’ère d’une diffusion transnationale.
-
Communication orale
À la croisée de la mémoire et de la découvrabilité : exploration des stratégies pour les contenus francophones disparus des écransCatalina Briceno (UQAM - Université du Québec à Montréal)
En quelques années, la découvrabilité s’est hissée au rang des priorités en matière de politiques culturelles au Canada et au Québec (Guèvremont & al. 2019; Bisaillon,2021; Beaudoin & al. 2024) puisqu’il s’agit, pour les contenus culturels souvent financés par des fonds publics, de trouver leur chemin jusqu’aux consommatrices.teurs dans un environnement numérique de plus en plus régi par des logiques algorithmiques qui tendent à favoriser une concentration de l’offre sur des grandes plateformes (Napoli, 2019). Cette situation représente un défi supplémentaire pour des communautés culturelles en minorité linguistique sur le web (Tchéouali, Agbobli, 2020).
La présente communication est le fruit de mes travaux de recherche sur la découvrabilité et la mise en valeur du répertoire audiovisuel québécois à l'ère numérique. Combinant ces années de réflexion et de recherche (Fading Databases, 2019; Briceño, 2020), il s'agira d'interroger la possibilité de mettre en place un système de gestion collective qui permettrait de prolonger la vie visible des œuvres audiovisuelles québécoises qui ne sont plus accessibles sur les marchés (Gouvernement du Canada, 2021). Pourrait-on, par une combinaison de leviers législatifs et publics, répondre au double impératif de préserver le patrimoine audiovisuel et d’alimenter la découvrabilité du répertoire des productions en français?
La recherche-création à l’ère du streaming
-
Communication orale
L’analyse vidéographique et l’étude de productions québécoises sur les services de TPCThéo Boisvert (Université du Québec à Montréal), Dominique Gagnon (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Émergeant récemment comme méthode alternative de recherche, l’analyse critique vidéographique consiste à soutenir une argumentation en utilisant les mêmes matériaux que les œuvres médiatiques à l’étude afin de renforcer le propos par des exemples audiovisuels (Álvarez López, 2012 ; Lavic, 2012 ; Grant et al., 2016). Cette méthode trouble la vision dichotomique séparant recherche et création, favorisant plutôt l’émergence du sens au travers du processus créatif, en plus de proposer une façon plus accessible et engageante de présenter les résultats. Cependant, pour autant que les essais vidéo portant sur le cinéma foisonnent, pareille attention a rarement été accordée aux séries télévisées (Mittell, 2017 ; Grant et Kooijiman, 2019). Bien que la recherche francophone s’intéresse de plus en plus à la question (Gallerani et Pagello, 2022 ; le site Amour en séries du Labo Télé), nous constatons que l’étude des productions destinées aux services de TPC québécois par l’analyse vidéographique reste minime. Cette communication vise à démontrer l’intérêt de la création vidéographique pour la formulation de réflexions critiques sur les productions médiatiques locales à l’ère du numérique. Il sera aussi question des défis liés à cette méthode. En dépit de ces obstacles, la création vidéo nous permet d’illustrer avec dynamisme nos constats sur les tendances narratives et esthétiques des séries sur les services de TPC québécois.
-
Communication orale
Fourchettes et tribulations amoureuses : L’essai vidéo comme expérience et exploration d’affectsMeganne Rodriguez-Caouette (UdeM - Université de Montréal)
À partir d’analyse d’extraits de la web-série Fourchette (ICI.TOU.TV, 2019-2021), et de bribes de deux ouvrages de l’autrice Sarah-Maude Beauchesne (Les Fourchettes (2020) et Faire la romance (2023)), cette présentation s’attardera à montrer les liens entre l’expérience du montage d’essai vidéo et du fragment amoureux.
L’hypothèse soulevée dans cette communication est que l’expérience de l’essai vidéo, sous-champ de celui plus large du videographic criticism (Morton 2017), est une exploration photogénique du fragment en tant qu’affect. En effet, le but du montage de l’essai vidéo est d’assembler des pièces hétéroclites de différents médias et médiums et de les assembler pour former un tout cohérent qui répond à des sensibilités propres. À la manière du punctum de Roland Barthes et de la photogénie selon Jean Epstein, l’essai vidéo est à penser comme une rumination (Morton, 2017) personnelle et affective d’images et de textes qui seront réassemblés pour créer un nouveau récit contraint à l’affect de son créateur ou de sa créatrice.
La présentation s’attardera donc à montrer que l’essai vidéo est avant tout une expérience exploratoire de l’affect qui se matérialise par la fragmentation d’objets culturels. De plus, l’approche privilégiée sera orientée sur l’expérience physique et émotive de l’essai vidéo.
-
Communication orale
Vers une Accessibilité Universelle dans l'Ère du Streaming : Défis et Innovations pour l'Inclusivité des Personnes en Situation de HandicapLisa Melinand (UdeM - Université de Montréal)
Dans le cadre de ma thèse doctorale, qui porte sur l’accessibilité universelle dans l'ère du streaming, je m’engage dans un projet de recherche-création-action visant la création de l’application "CineHubQuebec". Basé sur le principe de capacitisme, cette plateforme, qui est en partie le résultat de mes expériences personnelles en tant que personne sourde appareillée, vise à améliorer l'accessibilité audiovisuelle pour les personnes en situation de handicap dans le contexte francophone.
Soutenu par le partenariat SSHRC CinExMedia (Contribuer au bien-être à l’ère des écrans), ce projet de plateforme est caractérisé par une approche participative, intégrant activement trois pôles: les salles de cinéma à Montréal proposant des aménagements pour les personnes en situation de handicap, les maisons de productions québécoises, qui produisent un contenu adapté pour un public handicapé (comme MELS et AMI-télé), et les organismes d’appui, comme Audition Québéc et INCA. Cette démarche m’a permis de collecter des témoignages divers et des retours d’expérience pour comprendre les besoins et les préférences des utilisat(rice)eurs en matière d'accessibilité.
Ainsi, ma communication me permettra de présenter une synthèse des témoignages que j’ai recueillis de la part d’usagers, de créateurs de contenu, et de diffuseurs au Québec qui illustrent les limites et les possibilités de l’accessibilité basée sur la notion de capacitisme.
Pratiques de réception et usages à l’ère de la VOD
-
Communication orale
La stratification sociale des pratiques de consommations audiovisuelles des jeunes en France : Un modèle de la distinction par les régimes de curationAbel Aussant (Sciences Po)
Cette communication porte sur l’espace des pratiques de consommations de biens audiovisuels des adolescents et jeunes adultes français. Elle s’inscrit dans une démarche de mise en évidence des formes contemporaines de la distinction par la culture. À partir de l’enquête sur les pratiques culturelles des Français 2018, je mets en œuvre une méthode d’analyse géométrique des données, pour modéliser l’espace des pratiques de consommation audiovisuelle des 15 – 29 ans en France. L’analyse fait apparaître une nette opposition entre les pratiques numériques et l’univers de la télévision traditionnelle. L’utilisation de modèles de régression permet de dévoiler le caractère fortement stratifié de cette opposition. Toutes choses égales par ailleurs, les individus les plus diplômés et issus des familles les plus dotées en capitaux culturels, ont tendance à plébisciter les médiums numériques et à fortement rejeter la télévision. Pour expliquer ce phénomène, je mobilise deux classes d’explication. La première mobilise la littérature sur la fracture numérique. La seconde questionne l’existence de phénomènes de distinction par des "cultures de la curation" socialement différenciées. L’étude de la stratification sociale des modes d’accès à la culture en ligne/hors-ligne permet de réaffirmer l’actualité du paradigme bourdieusien pour analyser les pratiques culturelles émergentes, notamment chez les jeunes, qu’on suppose parfois être "connectés" de manière indifférenciée et universelle.
-
Communication orale
"C’est important de soutenir les contenus québécois, mais moi, j’en regarde pas"Destiny Tchehouali (Université du Québec à Montréal), Christine Thoer (UQAM - Université du Québec à Montréal)
En avril 2023, nous avons réalisé une enquête avec l’association québécoise de la production médiatique (AQPM) et l’académie de la transformation numérique (ATN), afin d’explorer les habitudes de visionnement de contenus audiovisuels de 1000 jeunes adultes, âgés de 18 à 24 ans, vivant dans différentes régions du Québec et dont l’une des deux langues parlées régulièrement à la maison était le français. Nous avons plus particulièrement sondé les modalités d’accès, les pratiques de visionnement, l’appréciation et l’intérêt des jeunes adultes au Québec à regarder des films, séries, documentaires et émissions de téléréalité et de variétés québécois ainsi que leur connaissance, accès, appréciation et utilisation des plateformes de VOD locales permettant de visionner ces contenus. Pour affiner notre compréhension, nous avons réalisé 4 groupes focus avec des jeunes adultes vivant à Montréal et en région.
Nos résultats montrent que l’appréciation et les représentations des contenus québécois sont contrastées mais qu’une majorité des jeunes adultes sondés déclare un intérêt pour ces contenus, et plus généralement, la culture québécoise. Cet intérêt ne se traduit pas nécessairement par l’écoute régulière des différentes catégories de contenus québécois, ce qui s’explique, entre autres, par des enjeux de découvrabilité systémique des contenus québécois sur les services de VOD et les médias sociaux privilégiés par les jeunes adultes.
-
Communication orale
L'impact de la plateformisation sur la consommation des séries télévisées francophones à Montréal: entre choix identitaires et accessibilité des contenusDimitra Laurence Larochelle (Université Sorbonne Nouvelle)
Notre étude porte sur l’expérience des plateformes de VàD francophones par les jeunes adultes résidant à Montréal, dont le français est la première langue. L’objectif de notre enquête est d’examiner comment l’usage de ces plateformes participe au processus de négociation d’une identité francophone pour des jeunes adultes (âgés de 18 à 22 ans) d’expression française, vivant à Montréal. Nos résultats se basent sur 15 entrevues réalisées de janvier à juin 2023 à Montréal.
Notre étude a révélé que le visionnage des séries francophones s’inscrit souvent dans la continuité d’une tradition familiale et constitue, dans la plupart des cas, un choix conscient de la part des jeunes adultes interrogé·e·s, qui souhaitent encourager l’industrie sérielle québécoise. De plus, les jeunes téléspectateur·rice·s s’attachent aux séries québécoises, puisque ces dernières leur offrent la possibilité de s’identifier avec les situations et les personnages représentés, et d’écouter leur propre langue, surtout leur accent. Cependant, plusieurs facteurs semblent freiner la consommation des fictions sérielles diffusées par les plateformes francophones (le potentiel de socialisation offert par les plateformes qui dominent le marché audiovisuel comme Netflix, les fonctionnalités limitées proposées par les plateformes locales, etc.), ce qui conduit les jeunes à limiter leurs abonnements, privilégiant ainsi les plateformes qui leur proposent plus de fonctionnalités et un nombre de contenus plus important.
Diversité et inclusion à l’ère de la VOD (1)
-
Communication orale
La production de séries originales francophones sur les services de VOD canadiens : un état des lieuxStéfany Boisvert (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Afin de pallier le manque de recherche sur les services de VOD francophones et/ou nationaux, un projet – le premier du genre – a été mis au point afin de recenser l’ensemble des contenus originaux en langue française produits au Canada et destinés aux services de streaming nationaux, pour ensuite évaluer les tendances (narratives, esthétiques, idéologiques) de ces productions. Cette communication entend ainsi faire connaître les premiers résultats de cette recherche. Il s’agira de présenter la base de données qui a été conçue et sera bientôt mise en ligne, pour ensuite discuter de quelques constats quant aux tendances thématiques et narratives, le tout évalué à l’aune de la diversité des représentations et personnages.
À la suite d’une analyse multimodale de plus de 50 séries fictionnelles, il fut possible de constater une diversification significative des personnages, thématiques et expressions culturelles et identitaires. Par exemple, les statistiques témoignent d’une représentation croissante de la diversité sexuelle, de genre et ethnoraciale. Cependant, une analyse textuelle et intersectionnelle a aussi permis d’identifier des problèmes persistants, tels que la marginalisation de certains groupes sociaux. Plus largement, les personnages non-normatifs sont majoritairement relégués aux rôles de soutien. Ces résultats attestent de l’importance de questionner plus finement les affordances narratives des services de VOD (Lotz et Lobato, 2023).
-
Communication orale
"Mais… T’aimes plus les filles ou les garçons ?": La représentation de la bisexualité chez les femmes dans la série web pour adolescent·es NomadesJuliette Lavallée (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Depuis le confinement, on a assisté à une hausse drastique du nombre d’abonnements à des plateformes de télévision en ligne (ATN, 2020). De ce fait, l’offre télévisuelle à l’ère de la télévision en ligne est plus que jamais diversifiée. Plusieurs études ont d’ailleurs su illustrer le rôle pédagogique de la télévision, notamment en ce qui concerne la sexualité, l'identité et les rôles genrés (Parsemain, 2019). La télévision peut permettre au public de s’informer sur les enjeux et cultures queer. Cependant, bien qu’on assiste aujourd’hui à une meilleure représentation des hommes blancs homosexuels, les femmes queer sont encore peu représentées à l’écran (Capsuto, 2000; Davis & Needham, 2008).
Considérant que la télévision joue un rôle éducatif auprès de ses téléspectateurs·trices et que les services de télévision par contournement se popularisent, il devient alors pertinent d’analyser le contenu offert actuellement sur nos propres plateformes de TPC francophones. Quelles sont donc les visions que construit ICI TOU.TV concernant les femmes queer? Dans le cadre de ce colloque, je ferai une étude de cas de la série Nomades (2019-2020). Il sera question de voir comment la série aborde la bisexualité au travers de son personnage principal, Sam. Cette présentation sera ainsi l’occasion d’observer en quoi cette série francophone destinée à une plateforme de streaming offre des potentiels de renouvellement tant au niveau des discours, de la narration que des thématiques.
-
Communication orale
Plateformes de streaming, fictions et diversité dans le contexte françaisMarine Malet (University of Bergen)
La diversité et l'inclusion sont devenues des enjeux majeurs dans nos sociétés contemporaines. Si de nombreuses études interrogent les liens entre plateformes et diversité, celles-ci s’inscrivent majoritairement dans un contexte anglo-saxon. Or, comme le souligne l’Observatoire Européen de la Diversité, cette dernière "dépend largement de la composition de la société d'un pays […] et il n'existe pas de norme universelle en matière de diversité" (Cabrera, 2021 :3). Cette communication entend donc interroger les spécificités de la production sérielle française, et la manière dont les plateformes se saisissent des enjeux de diversité et d’inclusion.
Trois ont été retenues pour l’étude : une internationale et commerciale (Netflix), une nationale et commerciale (Canal+) et une nationale publique (France TV). Pour chacune, trois productions françaises ont été identifiées, parmi les plus populaires en France en 2023 (Lacoue, 2024). En analysant leur(s) thumbmail(s) ainsi que leur synopsis à partir des critères du Baromètre de la diversité de l’ARCOM, il s’agira d’éclairer la manière dont chacune représente la diversité de la société française. Des entretiens individuels conduits avec des professionnels du secteur (2023-2024) permettront également d’éclairer les résultats obtenus. Cette contribution a donc pour objectif de proposer une première interrogation sur le paysage de la VOD en France, ainsi que des liens entre productions locales, diversité/inclusion et streaming.
Lunch
Diversité et inclusion à l’ère de la VOD (2)
-
Communication orale
La représentation de l’autre : Enquête sur les conditions de production de personnages racisés dans une websérie LGBTDéborah Gay (Université de Toulouse Jean-Jaurès)
Cette communication souhaite montrer comment une fiction audiovisuelle est porteuse de la vision d’un Autre exotisé (Ahmed, 2006) et par quelles actions des comédiens racisés peuvent modifier leurs personnages à la marge. Pour cela, nous avons réalisé en 2017 une observation participante de 7 mois sur la première fiction sérielle LGBT française, appelée Les Engagés, diffusée sur la plateforme web de France Télévisions, des premières discussions entre scénariste et diffuseurs à sa diffusion. Nous avons pu entrer sur ce terrain grâce au scénariste, devenu notre allié (Beaud et Weber, 2010). Cette communication s’appuie aussi sur des entretiens compréhensifs (Kaufmann, 2016) avec 13 membres de la production.
Dans cette fiction, deux des personnages sont d’origine maghrébine, le personnage principal et sa sœur. Nous nous focalisons ici sur la période de tournage pour pouvoir analyser l’agentivité des comédiens racisés. Ces comédiens tirent parti de flous dans le scénario pour nuancer la représentation d’une minorité à laquelle ils appartiennent, dans un rapport en tension avec les réalisateurs et le scénariste, responsables de la direction d’acteurs, du montage et de l’écriture du récit. La rapidité de tournage, le moindre financement des webséries (Ziemniak, 2017) sont autant d’éléments qui ont leur part à jouer sur le plateau. Ce tournage montre alors comment se met en place une technologie de genre (de Lauretis, 2007) et de race (Cervulle, 2013).
-
Communication orale
Entre web et télévision : influence des enjeux de diffusion dans les séries radio-canadiennes féministesAnne-Sophie Gravel (UQAM - Université du Québec à Montréal)
La montée du numérique ayant créé une nouvelle voie d’accès à la production pour les créatrices de l’audiovisuel, on constate un renouvellement des thématiques et des pratiques dans les téléséries québécoises. La Société Radio-Canada produit et diffuse précisément des webséries dont les thématiques rejoignent plusieurs enjeux féministes, et qui remportent un succès populaire. La chaîne nationale semble donc, grâce à sa plateforme de diffusion numérique TOU.TV, favoriser un renouvellement des formats qui se conjugue à une (re)modulation des identités féminines représentées, contribuant ainsi à déshomogénéiser les féminins.
Certaines de ces séries, d’abord destinées au web, intègrent ensuite la programmation télévisuelle linéaire de Radio-Canada après avoir remporté un succès populaire. Les créatrices ont donc l’occasion de produire, à partir des marges, certains contenus qui leur ressemblent, mais doivent néanmoins composer avec des contraintes liées au mandat généraliste du diffuseur public national. La série Fourchette est un cas de figure qui nous occupera dans le cadre de cette présentation, puisque parallèlement à sa diffusion, la plateforme de balado de Radio-Canada (Ohdio) a produit un balado avec sa créatrice, Sarah-Maude Beauchesne, pour détabouiser certains sujets associés au féminin. Ohdio semble donc corroborer l’existence d’une ambivalence des tons entre la diffusion télévisuelle et les espaces en marge de ce cadre.
-
Communication orale
Le "Netflix Queer" français : analyse industrielle et discursive de la plateforme de streaming QueerScreenNoémie Sorel (UdeM - Université de Montréal)
Fondée en 2019 par le distributeur Optimale, QueerScreen est une plateforme de streaming dédiée au cinéma queer qui compte près de 300 films, séries et pièces de théâtre dans son catalogue. Dans cette communication, nous proposerons une analyse industrielle et discursive du modèle de la plateforme de streaming française QueerScreen. Celui-ci reflète l’idée que le cinéma queer se trouve "at the juncture of various film cultures, each shaped by their own peculiar history and obeying specific regimes of cultural value" (Damiens 2020 ; 7), à savoir à la fois comme une forme de divertissement, un cinéma "de qualité" et un cinéma identitaire.
Décrite à de multiples reprises comme le "Netflix Queer", QueerScreen se construit discursivement dans une relation ambivalente avec ce dernier. QueerScreen lui emprunte l’organisation de son catalogue selon des catégories de genres thématiques. Elle propose aussi les "QueerScreen Originals", des films disponibles en exclusivité pendant un mois, reprenant les modèles alternatifs de rotation de films sélectionnés de certaines plateformes alternatives. Aussi, les catégories telles que "Cinéphiles" et l’organisation d’un festival en ligne en 2021 font indéniablement référence à une culture filmique cinéphilique. Par des partenariats avec les médias LGBTQ+, QueerScreen se conçoit comme une plateforme identitaire destinée avant tout à la communauté LGBTQ+ française.
Entre Web et télévision : stratégies et contenus convergents
-
Communication orale
Les plans Équité-Diversité-Inclusion-Accessibilité de la plateforme radio-canadienne Tou.tv : avancée politique ou élite cannibale?Julie Ravary-Pilon (UdeM - Université de Montréal)
À la manière des travaux récents du philosophe Olúfẹ́mi O. Táíwò et de son concept de l’"Élite cannibale/ Elite Capture" (2022) pour réfléchir l’accaparement des luttes identitaires par les puissants, cette recherche vise à interroger les programmes EDIA mis en place par Radio-Canada et plus précisément leurs impacts concrets sur sa plateforme francophone Tou.tv. Est-ce que les plateformes numériques sont toujours le lieu privilégié pour déployer les stratégies EDIA des institutions "traditionnelles"? En brossant une historiographie des différentes mesures et retombées de ces divers engagements depuis sa création en 2010, il sera démontré que les liens entre le média traditionnel (ICI Radio-Canada télé) et sa plateforme (ICI Tou.tv) se sont transformés au fil des années passant d’ "espace test"/ pépinières de talents de création issus de la diversité à un outil de stratégie de fidélisation et d’exclusivité des contenues de qualité, dans lesquels les enjeux sociaux EDIA sont devenus incontournables.
Une étude de la stratégie de découvrabilité empruntée pour la web série Amours d’occasion (Eva Kabuya, 2019) et Lakay Nou (Frédéric Pierre, 2024) ainsi qu’une analyse du Plan pour la diversité de l’Inclusion de Radio-Canada (2018-2021) nous permettra de peindre un premier portrait des promesses remplies (meilleure visibilité des groupes minorisés devant et derrière la caméra) et des opportunités manquées (institutionnalisation dépolitisée) par la plateforme Tou.tv.
-
Communication orale
À table! Les émissions de cuisine au Québec à l’ère du streaming : la télé gourmandeBélanger Anouk (Université du Québec à Montréal), Catalina Briceño (Université du Québec à Montréal), Juliette Provost-Dubois (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Le culinaire et la télévision entretiennent des relations étroites depuis toujours, alors que les émissions de cuisine ne sont pas très présentes dans la recherche en études télévisuelles au Québec. Cette présentation propose une réflexion croisant le développement de la "food tv" et de la télévision à l’ère du streaming. Les émissions culinaires ont subi une expansion marquée au cours des 25 dernières années où la production de chefs-célébrités, des synergies commerciales, la popularité et l’influence des formats de télé-réalité mondiaux jouent un rôle. Ainsi, le milieu de la télévision québécoise évolue à travers ses émissions culinaires. Les magazines culinaires, les compétitions gastronomiques, les émissions de recette axées sur le quotidien des familles ou le terroir québécois, les émissions de variétés portant sur les univers culinaires de vedettes et les émissions culinaires animées par des vedettes, aux émissions nichées, en passant par la télé-réalité, l’explosion récente des émissions culinaires s’avère une thématique porteuse pour étudier la télévision québécoise.
Nous proposons de brosser le portrait de la "food tv" au Québec. Puis, nous présenterons les continuités et changements alors que la télévision migre vers les plateformes. Au final, la "food tv" se révèle une clé de lecture intéressante pour la télévision par contournement, ses logiques de plateforme et de marché, et participe ainsi à développer les études télévisuelles au Québec.