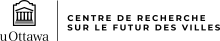Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 300 - Lettres, arts et sciences humaines
Description :Depuis 20 ans, la recherche portant sur la diversité religieuse a beaucoup avancé dans le monde francophone sur les questions relatives aux accommodements raisonnables, à la laïcité et à la liberté de conscience et de religion. En revanche, leur étude à l’échelle municipale est demeurée disparate et parcellaire. Récemment, les recherches portant sur la religion et la ville sont foisonnantes partout dans le monde, surtout dans les contextes de forte migration. Les villes servent de « loupe pour la théorie sociale » et, parmi les dynamiques urbaines, les changements religieux sont les plus notables au cours des 20 dernières années, et ce, « en dépit ou en tant que conséquence du processus de sécularisation et de modernisation ». Des recherches conduites dans différents contextes nationaux ont montré que l’échelle de la ville ou de la métropole permettait d’aborder sous un jour nouveau des débats qui demeurent trop souvent cantonnés sur un plan très théorique, comme ceux concernant la laïcité ou neutralité de l’État. C’est à la hauteur de la ville, dans son fonctionnement quotidien, que peuvent être observées des séquences placées sous le signe de la controverse, de la négociation ou transaction sociale.
Ce colloque veut apporter une contribution aux débats actuels sur les politiques publiques devant la diversité socioreligieuse, dans les espaces municipaux francophones minoritaire et majoritaire. Les communications offriront une analyse multifactorielle des enjeux spécifiques suivants, autour d’études de cas ou de perspectives théoriques : a) la transformation du paysage religieux et les évolutions de la neutralité ou laïcité de l’État, appréhendées à l’échelon urbain local; b) la manière dont les citoyens, groupes religieux et personnes sans religion s’approprient et se représentent l’espace urbain et la visibilité du religieux; c) la gouvernance de la diversité religieuse dans les pratiques quotidiennes des municipalités; et d) les modes de participation des groupes religieux à la vie urbaine.
Remerciements :Les organisateurs du Colloque aimeraient remercier pour leurs appuis logistiques et financiers:
- Le groupe de recherche MUREL, financé par le CRSH et le FRQSC
- La Chaire COLIBEX
- La Chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles, UOttawa
- Le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, UOttawa
- Le Centre de recherche sur le futur des villes, UOttawa
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables : Partenaires :Programme
Accueil et introduction
-
Communication orale
IntroductionSolange Lefebvre (UdeM - Université de Montréal), E.-Martin Meunier (Université d’Ottawa)
Bloc I : Immigration, francophonie et municipalités
-
Communication orale
Entre sécularisation et pluralisme religieux: quel est l’effet de l’appartenance religieuse des immigrants sur la composition religieuse des villes de Montréal, Québec et Gatineau?Jacob Legault-Leclair (University of Waterloo), Nicolas Mougeot (Université d’Ottawa)
Lors de cette communication, nous analyserons le lieu d’établissement et la dispersion géographique des immigrants appartenant à différentes religions. Nous quantifierons la proportion d’immigrants au sein des grandes villes québécoises (Montréal, Québec, Gatineau) et du reste de la province en fonction de leur appartenance religieuse et de leurs déplacements subséquents sur le territoire québécois. Notre objectif sera de déterminer si les grandes villes québécoises se sécularisent ou bien si elles se diversifient religieusement sous l’influence de la (non)appartenance religieuse des immigrants. Pour ce faire, nous brosserons un portrait de la dispersion géographique des immigrants de différentes confessions religieuses au Québec entre 1991 et 2021 et nous mesurerons l’influence que cela peut avoir sur la composition religieuse de Montréal, Québec, et Gatineau. Ensuite, nous comparerons l’appartenance religieuse des citoyens de ces villes à celle du reste du Québec. Pour atteindre cet objectif, nous utiliserons les recensements canadiens de 1991, 2001 et 2021, ainsi que l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Ces bases de données nous permettront de quantifier le nombre d’individus (immigrants ou non) au sein des grandes villes québécoises en fonction de leur appartenance religieuse. En utilisant quatre bases de données, nous pourrons également procéder à une comparaison historique de l’évolution du religieux au sein des différentes villes.
-
Communication orale
Les dynamiques de l’hyperdiversité ethnoconfessionnelle dans les modèles de spatialisation des lieux de culte non chrétiens dans la région de MontréalFrédéric Castel (UQAM - Université du Québec à Montréal)
L’hyperdiversité ethnoreligieuse peut se définir comme le mouvement de diversification d’une population religieuse par l’addition graduelle du nombre de groupes ethniques qui la compose ainsi que par l’élargissement du spectre des variantes confessionnelles et des écoles de pensée. Cette hyperdiversité est une dynamique transformationnelle en constante activité qui touche pratiquement tous les univers religieux. La combinaison des approches quantitative et qualitative permet de mettre en lumière le fait que cette double dynamique, ethnolinguistique et confessionnelle, s’articule dans l’espace montréalais selon des modèles sensiblement différents. Notre présentation se concentrera sur les cas des univers musulman, bouddhiste, hindou et sikh.
On découvrira que la spatialisation des (sous)groupes ethnoreligieux peut suivre des parcours fort différents. Les données statistiques et les enquêtes sur le terrain montrent que la spatialisation des lieux de culte et celle des populations concernées ne se recoupent pas toujours. Les dynamiques d’ancrage dans les quartiers de Montréal et les villes de banlieue, propres à chaque communauté ethnoconfessionnelle, ne suivent pas nécessairement une logique d’ensemble attribuable à un univers religieux orchestré. Des facteurs liés à l’histoire des quartiers et aux conditions socioéconomiques des populations sont aussi à l’œuvre. L’équation ethnoconfessionnelle joue différemment selon les échelles d’observation : État, ville, lieu de culte.
Bloc II : Défis concernant le zonage religieux
-
Communication orale
Qu’est-ce qu’un zonage religieux « juste »? Réflexions à partir de décisions de justice récentesFrédéric Dejean (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Des travaux de recherche conduits depuis les années 2000 ont insisté sur le paradoxe en matière religieuse dans le contexte québécois : s’il y a moins de croyant.e.s, il y a en revanche plus de croyances. Cette évolution se traduit spatialement par une multiplication des lieux de culte dont la présence témoigne des attentes des groupes religieux minoritaires en matière de « droit à la ville ». Les lieux de culte font l’objet d’un processus de reconnaissance par les municipalités à travers le zonage religieux. Or, des travaux de recherche associés au courant du « multicultural planning » ont montré que la production de l’espace urbain est sous-tendue par des normes et des pratiques qui sont loin d’être neutres et qui reflètent les valeurs et les conceptions urbanistiques des cultures majoritaires. Dans ce contexte, on peut se demander si le « zonage religieux » québécois est « juste » envers l’ensemble des groupes religieux en présence. C’est à la lumière de travaux issus du « multicultural planning » que j’analyserai plusieurs décisions de justice récentes et en dégagerai les principes sur lesquels elles prennent appui. Ce faisant, je proposerai des jalons dans l’élaboration d’un zonage religieux « juste ».
-
Communication orale
Le zonage religieux au prisme des échanges entre acteurs religieux et acteurs municipauxFlavie Goulet (UQAM - Université du Québec à Montréal)
La littérature scientifique existante démontre que les lieux de culte constituent des lunettes privilégiées pour étudier la diversité religieuse à un échelon local, parce qu’ils illustrent concrètement les enjeux et les dynamiques en présence (Germain et Gagnon, 2002; Fourot, 2009; Dejean, 2016). Les discussions entourant leur réglementation, leur établissement, ou encore les activités qui s’y déroulent contribuent à instaurer différents dialogues, notamment entre les acteurs municipaux et les acteurs religieux. Cette communication se propose de réfléchir au zonage des lieux de culte à partir des données recueillies dans le cadre de ma recherche de maîtrise dans l’arrondissement Montréal-Nord, qui mène depuis une dizaine d’années une réflexion de fond et de forme à propos du zonage des lieux de culte. En prenant appui sur une consultation publique menée en 2019 à l’arrondissement, ma communication illustrera les enjeux du zonage religieux sur le terrain, mais également ses répercussions sur le dialogue entre les acteurs municipaux et les acteurs religieux de Montréal-Nord.
-
Communication orale
De l’enfouissement à la visibilité. Enquête sur une église de maison montréalaiseJeannine Emungu Viate (UdeM - Université de Montréal), Benjamin Gagné (Université de Montréal/ Université de Strasbourg)
Beaucoup d’églises immigrantes africaines d’origine subsaharienne ne jouissent pas d’une reconnaissance de leur statut par les municipalités montréalaises. Dans l’attente de cette reconnaissance, certaines églises fonctionnent en marge des grandes églises comme églises de maison. Basée sur les discours des membres d’une église immigrante, la communication restitue les éléments d’une enquête ethnographique réalisée dans une église de maison fréquentée par les Congolais. Elle rend compte des dynamiques qui interprètent les normes et les pratiques municipales dans la gestion des agréments au prisme des stratégies de visibilité et d’invisibilité des membres de l’église observée. L’enquête permet de relever, de la part des protagonistes concernés (municipalité, église immigrantes), la tension entre liberté, conflits, arrangements, observances et contournements dans la gestion des agréments.
Dîner
Bloc III : Patrimoine et vitalité religieuse
-
Communication orale
Le patrimoine religieux a Montreal: divers points de vue sur un plan pour l’espace urbainHillary Kaell (Université McGill)
L'église St Jax est une paroisse anglicane historique au centre-ville de Montréal. L’église et son OBNL nommé la Fondation des centres trinité (TCF) tentent de réhabiliter l'image publique du christianisme au Québec. L'objectif de leur équipe est de transformer son bâtiment historique en un espace communautaire explicitement laïque et d'aider d'autres églises à faire de même. Les enjeux sont considérables puisque des centaines d'églises urbaines sont sous-utilisées ou en mauvais état, en particulier les églises catholiques et anglicanes historiques. Cette présentation examine la réponse de l'équipe à un projet pilote dévoilé publiquement par la ville de Montréal en 2023. Ce projet découle du Plan de mise en valeur du patrimoine local de l'arrondissement Ville-Marie (novembre 2020), dont l'un des 10 objectifs est de “préserver les bâtiments religieux”. Dans le cadre du projet pilote actuel, les employés municipaux ont sélectionné quinze églises visibles et historiques de Ville-Marie, dont Saint-Jax, qui sont exemplaires de “bâtiments religieux excédentaires” nécessitant une “réhabilitation”. Dans cette présentation, nous mettons l’accent sur le projet pilote pour illustrer les divers points de vue des personnes impliquées : employés municipaux, St Jax et TCF, membres du public et d’autres églises. On pose la question suivante : comment les différents acteurs du centre-ville de Montréal définissent-ils ce qu'est le “patrimoine,” le “collectif,” et la “religion”?
-
Communication orale
Patrimoine immatériel et liens ancestraux au Quartier chinois de MontréalSophie Ji (Université McGill)
Le Quartier chinois de Montréal est « le seul Chinatown historique significatif préservé au Québec et dans l'Est du Canada » (Ministère de la Culture et des Communications 2023). Ces dernières années, plusieurs personnes et groupes se sont organisés afin de protéger le quartier chinois et son patrimoine, notamment à la suite de la résurgence du racisme anti-asiatique qui a accompagné la pandémie de la COVID-19, ainsi que la menace grandissante des nouveaux développements immobiliers dans le quartier. À travers une étude de cas basée sur la réalisation de deux entrevues avec des acteur.rice.s sur le terrain et des observations sur le terrain échelonnées sur trois jours avec un organisme travaillant à protéger le patrimoine culturel du Quartier chinois de Montréal, cette étude de cas s’interroge sur la place qu’occupent les liens ancestraux et intergénérationnels ainsi que le patrimoine immatériel dans la lutte pour la protection du Quartier chinois.
-
Communication orale
Nouvelles Églises évangéliques et urbanité ; quelle nouveauté et quelle vitalité ?Benjamin Gagné (UdeM - Université de Montréal)
Si les églises évangéliques urbaines canadiennes font l’objet de recherches depuis une dizaine d’années, les questions de contacts sociaux significatifs et les changements de perceptions et d’attitudes des évangéliques envers les non-évangéliques n’ont pratiquement pas été explorés dans le contexte canadien. Les conclusions d’une enquête auprès de jeunes désaffiliés évangéliques relevaient que la socialisation primaire et secondaire s’appuie sur une logique sociale dite du « tout ou rien ». La présentation se penche sur le cas de quatre églises urbaines récentes au Québec dans les villes de Sherbrooke, Laval, Québec et Montréal. Elles auraient contribué à la transformation de plusieurs représentations symboliques, en particulier dans leur rapport Église/« monde ». Certaines d’entre elles, plutôt que de perpétuer l’ancien rapport d’opposition, cherchent à contribuer au renouveau social et spirituel de la ville. L’entrée sur le terrain ayant été effectuée en février 2023, il s’agira donc de résultats préliminaires issus d’observations participantes et d’entretiens menés auprès des responsables des églises.
-
Communication orale
Inclusion et visibilité du bouddhisme engagé dans les espaces urbains montréalais : une étude de cas multiple interdisciplinaireDenis Bolduc (UdeS - Université de Sherbrooke)
Harvey (2013) souligne l'importance des métropoles nord-américaines comme espaces de diversité et l'interaction entre pratiques religieuses et espaces urbains. L'intégration du bouddhisme engagé, peu explorée, questionne l'insertion de traditions non occidentales dans des contextes sécularisés (Queen, 2000). Cette recherche se focalise sur l'inclusion du bouddhisme engagé en Amérique du Nord, analysant son impact sur les espaces urbains et la laïcité. À travers des cas à Montréal, où Tung Lin Kok Yuen Canada Society participe à des programmes sociaux, l'étude emploie une analyse de contenu (N = 17) pour examiner les implications sous diverses perspectives : sociologie, études religieuses, et politique. Les résultats suggèrent que le bouddhisme engagé améliore l'inclusion sociale/culturelle et redéfinit l'espace public, aligné sur l'inclusivité et la pluralité. Elle propose que le bouddhisme engagé peut enrichir les politiques publiques, favorisant le dialogue interculturel et la coexistence harmonieuse.
-
Communication orale
Ambivalences identitaires et religieuses dans l'espace urbain : Réflexions sur la statue de Mère Teresa à MontréalDoan Dani
En 2012, à l'occasion du centenaire de l'indépendance de l'Albanie, une statue de Mère Teresa a été installée à Montréal. Cette sœur de renommée internationale, issue d'une famille albanaise de Skopje, n'a établi des contacts avec l'Albanie que tardivement, presque à l'âge de 80 ans. Ses contributions à la société albanaise demeurent modestes, voire insignifiantes en termes politiques. Utiliser son image comme symbole représentatif d'une communauté, en fonction de l'image nationale, dénude la religieuse de son rôle de missionnaire catholique et de son action humanitaire-religieuse. Cependant, malgré ce processus de sécularisation, l'image nationale reste imprégnée par la religion qui se voit conférer le monopole dans l'identité collective d'une communauté traditionnellement multiconfessionnelle. Cette ambivalence prend place dans un espace public précis à Montréal, confirmant ainsi que l'espace est une construction sociale. L'analyse examine d'abord le concept de l'espace, sa construction et les pratiques d'appropriation, ainsi que les interactions entre les sujets ou les groupes et l'espace. Ensuite, s'agissant de la statue, on retrace son histoire, les acteurs impliqués et les représentations qu'elle véhicule. L'étude s'efforce enfin d'explorer les tensions manifestes et latentes à ces deux niveaux.
Bloc IV : Relations des municipalités avec la diversité religieuse
-
Communication orale
Les défis de l’intégration du religieux en milieu municipal montréalais : une étude de cas de l’ONG multireligieux ‘Religions pour la Paix/ Québec’Patrice Brodeur (UdeM - Université de Montréal)
La ville de Montréal a été à l’avant-garde de la promotion du vivre-ensemble avec la création en 2015 de l’Observatoire international des maires sur le vivre ensemble. À la fin de son rapport « Politiques municipales sur le vivre-ensemble» (2019), produit en collaboration avec la Coalition internationale des villes inclusives et durables (ICCAR), on encourage « le dialogue entre les religions et les cultures ». Les efforts en matière de dialogue interreligieux semblent absents de ce rapport, malgré une référence à la religion dans la notion de ‘diversité’ (p. 10). Et pourtant, la Ville de Montréal a timidement encouragé depuis quelques décennies des efforts interreligieux pour la paix et la non-violence, comme ceux en lien avec la commémoration annuelle les 6 et 9 août de l’utilisation de bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Cette communication présentera les résultats d’une recherche sur le rôle d’une ONG multireligieuse (Religions pour la Paix/Québec/Canada) impliquée dans ces commémorations depuis quarante ans. Elle analyse ses défis changeants pour y impliquer la Ville de Montréal afin de susciter un plus grand impact public. Son approche théorique innovante est basée sur la théorie du dialogue intervisionnel qui explique les chevauchements entre dynamiques identitaires et dynamiques du pouvoir (Brodeur 2022). La méthodologie de ce travail sera principalement basée sur l’étude d’archives privées de cette organisation.
-
Communication orale
L’émergence de la Table interreligieuse de concertation du Québec (2020 -) en temps de pandémie COVID-19 : faire sa place dans la laïcité québécoise à l’ère de la CAQ.Saeid Yarmohammadi (UdeM - Université de Montréal)
Dans la foulée de la mise en place drastique à partir du mois de mars 2020 de politiques à l’échelle du Québec pour comprendre la pandémie du virus COVID-19, les communautés religieuses furent durement touchées dans leurs pratiques rituelles collectives, souvent hebdomadaires, sans compter les célébrations reliées à de multiples fêtes annuelles. Un groupe de leaders religieux juifs, chrétiens et musulmans initialement, et plus largement par la suite, a pris l’initiative de créer la Table interreligieuse de concertation du Québec afin de bâtir des ponts de communication avec le gouvernement du Québec, en particulier le Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Sur la base d’entrevues ethnographiques avec plusieurs des fondateurs et participants à cette Table et d’une étude documentaire, cette communication présentera d’abord un historique des activités et faits saillants de ce regroupement multireligieux récent dans le paysage social du Québec, suivie d’une première analyse de ces communiqués publics afin de faire ressortir à la fois les défis particuliers des communautés religieuses à faire comprendre leurs besoins particulier en milieu laïc québécois en temps de crise pandémique, ainsi que leurs contributions multiples à un meilleur vivre-ensemble à partir de diverses interventions sociales pour freiner l’isolement et contribuer à alléger les souffrances de nombreux membres de leurs communautés respectives en particulier, et de la société en générale.
-
Communication orale
Mini-étude de cas : pratiques Wiccan dans la ville de LongueuilAlexandre Duceppe-Lenoir (Université McGill), Caroline Mailhot (Université de Montréal)
Présentation ayant pour objectif de partager les résultats d’une mini-étude de cas, portant sur les services et pratiques ésotériques en région métropolitaine. Avec cette recherche de terrain, nous explorons les regroupements religieux méconnus et les pratiques spirituelles non-conventionnelles, en l'occurrence les pratiques néopaïennes et ésotériques, afin de comprendre la place des mouvements spirituels alternatifs en milieu urbain. En prenant le pouls de l’écologie religieuse locale, par l’entremise d’entretiens au sein d’organismes ésotériques, nous entamons une schématisation des relations entre les nouveaux mouvements religieux ou spirituels et la municipalité dans laquelle ceux-ci se sont établis. Nous partagerons également nos observations des dynamiques interculturelles et religieuses, dans le but de mettre en lumière les éléments problématiques et les circonstances d’entraide, pour ainsi faire place à une communication expansive et une plus grande inclusivité des différentes croyances dans le paysage religieux.
-
Communication orale
La mémoire des municipalités, à la fois expérientielle, archivistique et morceléeSolange Lefebvre (UdeM - Université de Montréal)
Cette communication donnera quelques résultats d’une recherche poursuivie dans le cadre du projet MUREL, et qui inclut quelques dizaines d’entretiens avec des fonctionnaires municipaux, des élus, de la recherche documentaire et des observations. La question religieuse permet d’aborder la complexité des relations entre les municipalités et les citoyens. L’exposé s’attachera à déployer une diversité des mémoires mises en jeu : mémoire institutionnelle et humaine, mémoire archivistique mise à mal par les fusions municipales à Montréal, la départementalisation des services, les changements et déplacements fréquents de personnel. Si le projet avait l’ambition de constituer, au départ, une cueillette systématique des données, il s’est vite heurté à une réalité à la fois insaisissable et riche, selon un jeu multiforme des mémoires.
-
Communication orale
Conclusions et prospectivesE.-Martin Meunier (Université d’Ottawa), Vincent Mirza (Université d’Ottawa)
Cette communication reviendra d’abord sur les principaux résultats des communications proposées dans ce colloque, en vue de mieux comprendre les points de tension, les enjeux et les perspectives de l’étude de la thématique « Villes et religions dans l’espace francophone ». La seconde portion de la communication ouvrira sur quelques prospectives comparatives. À cette occasion seront présentés les travaux du Centre de recherche sur le futur des villes de l’Université d’Ottawa.