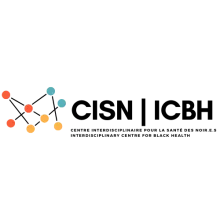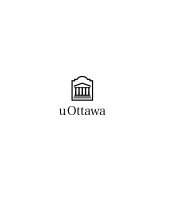Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 100 - Sciences de la santé
Description :La recherche en matière de santé au Canada a toujours adopté une approche aveugle sur les enjeux raciaux. En raison de cela, il y a une importante lacune de la recherche scientifique sur la santé des Canadiens noirs et des populations immigrantes noires. Notre colloque offre un espace pour mettre en lumière les dernières recherches sur la santé des personnes, ainsi que les enjeux de santé publique et les disparités dans les soins et les services les concernant. De plus, ce colloque fournit une plateforme pour des discussions ciblées sur des questions liées à la santé et au bien-être des personnes noires.
Ce colloque est une occasion unique pour discuter en français des disparités en matière de santé observées chez les personnes noires au Canada. En effet, les personnes noires au Canada sont moins souvent dépistées pour plusieurs types de cancers et reçoivent une moins bonne qualité des soins. Parmi les 20 cancers les plus communs au Canada, 15 n’ont aucune donnée sur les personnes noires (Cénat et al., 2022). De plus, des disparités sont également observées dans d’autres maladies chroniques comme l’hypertension artérielle et le diabète (Veenstra et Patterson, 2016). Une autre étude a trouvé que les personnes noires présentent des symptômes dépressifs à des taux six fois plus élevés que les taux de la population générale au Canada (Cénat, Kogan et al., 2021). Finalement, au Canada, les personnes noires risquent davantage d’être diagnostiquées de psychose que les personnes blanches (Cénat, Dromer et al., 2023). Malgré ces preuves, peu d’espaces sont offerts pour discuter des recherches en cours et partager les nouvelles connaissances acquises avec les chercheurs, praticiens, gestionnaires et organismes communautaires, ainsi que pour susciter la mobilisation nécessaire pour réduire ces disparités en matière de santé dans les communautés noires. De plus, les communautés noires francophones sont souvent ignorées par le peu d’études sur les personnes noires au Canada.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Jude Mary Cénat (Université d’Ottawa)
- Grace Jacob (Université d’Ottawa)
- Wina Paul Darius (Université d’Ottawa)
- Sara-Emilie Mcintee (Université d’Ottawa)
- Joana Mukunzi Ntunga (Université d’Ottawa)
- Élisabeth Dromer (Université d’Ottawa)
Programme
Session 1
-
Communication orale
L’usage des pratiques psychiatriques coercitives dans les communautés Noires au Canada : la nécessité d’un état des lieuxEmmanuelle Bernheim (Université d'Ottawa), Delphine Gauthier-Boiteau (Université d’Ottawa)
L’usage des pratiques psychiatriques coercitives (hospitalisation et traitement involontaire, isolement, contention physique, mécanique ou chimique) est en pleine augmentation au Canada. Il s’agit pourtant de mécanismes d’exception, la liberté et l’intégrité étant des droits fondamentaux. Les connaissances sur ces pratiques sont particulièrement lacunaires en contexte canadien où aucune donnée n’est rendue publique. Les études récentes ont démontré les violations systémiques des droits des personnes soumises à ces mesures, et ont établi qu’elles visent généralement les membres de groupes socioéconomiquement précaires. Or, les recherches internationales démontrent depuis une quinzaine d’années que les membres des communautés Noires et Autochtones courent un risque significativement plus élevé que les personnes blanches de vivre des contacts avec la psychiatrie, et de subir des pratiques psychiatriques coercitives. Si les inégalités que vivent les groupes racisés dans l’accès aux soins de santé mentale sont établies en contexte canadien, l’usage des pratiques psychiatriques coercitives à leur endroit reste à documenter.
Cette conférence fera un état des lieux des connaissances internationales et présentera les objectifs d’un projet actuellement en développement au Québec et en Ontario. Il explicitera son approche systémique, faisant le lien entre la psychiatrie coercitive, la protection de la jeunesse et la justice pénale.
-
Communication orale
Explorer la relation entre le racisme et la santé mentale chez les personnes Noires vivant au Canada : leçons tirées de l'étude «CoNSaiMe»Cary Kogan (Université d’Ottawa)
Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus fréquents dans la société canadienne et, de manière anecdotique, particulièrement au sein des communautés minoritaires. Les personnes Noires vivant au Canada sont confrontées à des inégalités en matière de soins de santé mentale, dues en partie à la discrimination raciale. L'un des objectifs du projet de recherche sur la santé mentale des communautés Noires (CoNSaiMe) était d'étudier les déterminants sociaux des problèmes de santé mentale chez les jeunes Noirs vivant au Canada. L'équipe de recherche a utilisé une méthodologie d'enquête en ligne pour obtenir des données afin de : 1) caractériser la prévalence des principaux problèmes de santé mentale chez les Canadiens Noirs, 2) révéler toute association entre les différentes formes de racisme et les problèmes de santé mentale, et 3) déterminer les principales caractéristiques sociodémographiques qui influencent l'expression de ces problèmes de santé mentale. Cette présentation mettra en lumière les principaux résultats de l'étude, qui révèlent l'influence des expériences de racisme des participants sur plusieurs symptômes de santé mentale. Une attention particulière sera accordée à l'association entre le racisme et les symptômes d'anxiété.
-
Communication orale
Traumatismes, racisme, dépression et idéation Suicidaire chez les personnes Noires au CanadaWina Paul Darius (Université d’Ottawa)
Objectif. Bien que l'idéation suicidaire soit un sérieux problème au Canada, sa prévalence et les facteurs associés chez les personnes Noires sont peu documentés. En utilisant des données du projet Santé mentale des communautés Noires au Canada (CoNSaiMe), cette présentation présentera les résultats d'une étude visant à évaluer la prévalence des idéations suicidaires chez les individus Noirs âgés de 15 à 40 ans au Canada, le rôle médiateur des événements traumatiques dans l'association entre la dépression et les idéations suicidaires, ainsi que le rôle modérateur des micro-agressions raciales et du racisme intériorisé.Méthodes. Huit cent soixante participants âgés de 15 à 40 ans ont rempli un questionnaire en ligne.Résultats. Environ un quart des participants ont déclaré avoir eu des idéations suicidaires. Le modèle de médiation modéré a révélé que les événements traumatiques médiaient pleinement l'association entre la dépression et les idéations suicidaires, tandis que les micro-agressions raciales et le racisme intériorisé modéraient cette relation.Conclusion. Ces résultats soulignent l'importance de traiter les micro-agressions raciales et le racisme intériorisé dans les contextes thérapeutiques chez les individus Noirs pour atténuer les impacts négatifs potentiels sur leur santé mentale. Ils soulignent également la nécessité de développer des programmes efficaces de prévention et d'intervention sur le suicide, culturellement adaptés pour les communautés Noires au Canada.
-
Communication orale
Incidence, facteurs et disparités liés au cancer chez les personnes Noires au Canada : Un examen de la portéeÉlisabeth Dromer (Université d’Ottawa)
Au Canada, 2 personnes sur 5 recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, et 1 sur 4 en mourra. Des disparités dans la recherche en santé des personnes Noires nous ont conduits à étudier l’état actuel de la recherche sur le cancer au sein des communautés Noires au Canada. L’objectif était d’évaluer les progrès réalisés et d’identifier les lacunes et les disparités toujours présentes.
Une stratégie de recherche exhaustive a été exécutée en décembre 2021 dans 10 bases de données, générant 3451 études. 19 ont été retenues, portant sur divers cancers (anus, sein, col de l’utérus, colorectal, estomac, poumon, prostate), incluant des données sur l’incidence, le stade du cancer au diagnostic, le type de soins reçus, de durée de l’intervalle de diagnostic et le dépistage. Des disparités raciales chez les personnes Noires ont été soulignées, révélant des écarts en matière de dépistage, d’incidence et de qualité des soins au Canada.
Compte tenu des lacunes observées dans les études sur le cancer chez les personnes Noires au Canada, les gouvernements fédéraux et provinciaux et les universités devraient envisager de créer des fonds spéciaux pour générer des recherches sur cet important problème de santé.
-
Communication orale
L’anémie falciforme, un exemple d'inégalitéBiba Tinga (N/A)
L’anémie falciforme est une maladie génétique des globules rouges qui touche de manière disproportionnée les personnes Noires. Au cours des 45 dernières années, cette maladie douloureuse a été traitée par des soins de soutien au Canada. Les personnes atteintes ont des complications graves, vivent avec un handicap invisibles et beaucoup de crises de douleur qui nécessitent l'utilisation d'opioïdes/de narcotiques. Ce qui entraine une réaction basée sur la race du système de santé.
Entre 2017 et 2019, trois nouveaux médicaments spécifiquement dédiés à l’anémie falciforme ont été approuvés aux Etats-Unis. Ils ne sont toujours pas disponibles au Canada.
D’autres barrières systémiques (telle que celle liée au paludisme) posent des risques aux patients lors des transfusions sanguines qui demeurent pour certains la seule option de traitement.
Compte tenu des expériences uniques vécues par les personnes affectées en raison des caractéristiques uniques de cette maladie et de l'intersection de la race et du statut social avec la maladie, on parle d’iniquité vis-à-vis de cette communauté.
Notre présentation va démontrer les défis auxquelles font face cette communauté au Canada et comment l’association d’anémie falciforme du Canada et ses membres travaillent à la défense de leurs droits.
-
Communication orale
La douleur, les bébés très petits, et la chirurgie - les écarts des soins gynécologiques et obstétriques pour les femmes noiresJennifer McCall
Il y a les décennies de recherche qui démontrent les inégalités des soins et des résultats pour les femmes noires, surtout en regard au santé gynécologique et obstétrique. Ces concernes ne sont pas seulement historiques, mais malheureusement restent très courants aujourd’hui au Canada et dans le monde. Les disparités existent à cause de traitement différent par les professionnels du santé, y inclus le racisme, à cause des déterminants sociaux de la santé, et des différences dans les risques de certaines conditions telles que les gros fibrômes. Que sont les aboutissements différents? Est-ce qu’il y a les solutions? Que sont les prochaines étapes? Cette séance parlera des disparités en les soins and mesures pour les femmes enceintes, y compris le taux de césariennes et la mortalité maternelle, pour les bébés, et pour les femmes avec les concernes gynécologiques, suite par une discussion au sujet de l’évidence pour réduire ces déficits.
Dîner
Session 2
-
Communication orale
Peut-on aborder le même problème de santé et ne pas se comprendre ? Cas des fibromes utérins chez les femmes NoiresAssumpta Ndengeyingoma (UQO - Université du Québec en Outaouais)
Les femmes Noires ont une prévalence élevée de certains problèmes de santé comme le fibrome utérin. Le fardeau de cette maladie et de son traitement chez les femmes Noires est considérablement plus important que celui des autres groupes raciaux, avec des taux de complications plus élevés. Malgré cela, il existe l’inégalité dans l’accès à certains types traitement. Même si les soignants disent respecter le choix de ces femmes lors du choix des traitements, certaines femmes ont l’impression que les soignants se dégagent de leurs responsabilités en leur faisant comprendre qu’elles ont, elles-mêmes, opté pour tels ou tels traitements. L’idée d’élaborer les lignes directrices en matière de santé reproductive pour les femmes Noires du Canada est louable. Toutefois, il ne faut pas voir ces femmes au niveau physiologique seulement. Les études qui s’intéressent aux signes cliniques et les traitements sont plus que ceux qui s’intéressent aux représentations de fibromes utérins par les femmes Noires. Les fibromes utérins devraient être considérés, non seulement comme une configuration de signes cliniques, mais aussi comme un syndrome d’expériences vécues chargées de significations personnelles, culturelles, psychologiques qui expliquent les décisions des femmes dans leur choix de traitement ou la façon de vivre avec leur problème de santé.
-
Communication orale
Vaccination contre la COVID-19 chez les personnes Noires au Canada : Le rôle majeur de la discrimination raciale, de la littératie en santé et des croyances complotistesRose Darly Dalexis (Université d’Ottawa)
En 2021, la proportion de personnes vaccinées contre la COVID-19 au Canada est comprise entre 56.4% à 82.5% avec les communautés Noires parmi les moins vaccinées. Ces disparités observées nous ont amené à réaliser deux revues systématiques et une méta-analyse pour finalement constater que peu de données ont été collectées auprès des personnes racialisées et confirmer l’échec de la recherche canadienne à intégrer et examiner les besoins spécifiques des communautés Noires. Alors, une enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 2002 personnes Noires au Canada, âgées entre 14 et 94 ans pour mieux comprendre les enjeux relatifs à la vaccination et combler les lacunes existantes. Les résultats ont montré que :1)avoir été infecté par la COVID-19 et expérimenter de la discrimination raciale majeure dans le système de santé augmentent la méfiance de ces communautés à l’égard des vaccins.2)les participants âgés de 55 ans et plus ainsi que ceux qui résident dans certaines provinces sont moins susceptible d’être vaccinés et la confiance dans les autorités joue un rôle important dans la vaccination.3)le niveau de confiance et la nécessité du vaccin est identique selon le genre contrairement à d’autres facteurs tel que l’âge, la langue parlée, le niveau d’éducation, etc. Toutefois, la discrimination raciale quotidienne et majeure, la littératie en santé, les croyances conspirationnistes sont les facteurs qui expliquent le mieux la vaccination contre la COVID-19 dans ces communautés.
-
Communication orale
Les communautés Noires face à la pandémie de la COVID-19 : un fardeau sanitaire de trop !Eric Tchouaket (UQO - Université du Québec en Outaouais)
Depuis longtemps dans les pays occidentaux, les personnes Noires sont confrontées à des inégalités de santé, soit pour des raisons de racisme, soit à cause des inégalités sociales existantes. Comme partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 au Canada a mis en évidence le risque accru d'infections et de décès au sein de la communauté Noire. Les statistiques indiquaient une mortalité 2,2 fois plus élevé chez les personnes Noires que chez les non racialisées et non autochtones. Les causes comprenaient : la pauvreté; le fait de vivre dans des quartiers défavorisés; les difficultés d’isolement en raison du caractère exigu des habitations; et les conditions de santé précaires.
De plus, les travailleurs en première ligne dans les centres de santé et de soins de longue durée, tels que les préposés aux bénéficiaires, préposés à l’hygiène et salubrité, agents de sécurité, et les infirmières, qui sont en grande majorité des personnes Noires, ont été les grandes victimes. Ils ont souffert du manque de ressources et d’équipement pour renforcer leurs actions de prévention et contrôle des infections (PCI). Une fois contaminée, leurs familles, collègues, et patients ont été directement affectés. Des actions concrètes en PCI contribueront donc à réduire les infections, et à atténuer ce fardeau de trop qui accentue les inégalités de santé.
-
Communication orale
Les besoins en santé des immigrants francophones en Nouvelle-Écosse : une pente à remonterMalanga-Georges Liboy (Université Sainte-Anne), Yalla Sangaré (Université Sainte-Anne)
La Nouvelle-Écosse étant une province unilingue, l’accessibilité à des meilleurs services de santé en français pour les personnes immigrantes francophones pose un problème. Malgré les efforts réalisés par les gouvernements successifs, les défis sont encore nombreux. Sous l’impulsion de la Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse et de Réseau santé Nouvelle-Écosse, une étude a été réalisée pour répondre aux questions ci-après : 1) Quelles sont les représentations des personnes immigrantes francophones vivant en milieu minoritaire en Nouvelle-Écosse sur leur santé physique et mentale? et 2) Quels sont leurs besoins en matière d’accès aux services de santé en français en Nouvelle-Écosse? Une recherche mixte de type exploratoire a été menée auprès des personnes immigrantes francophones et des étudiant(e)s internationaux des régions de Clare, d’Halifax et de Sydney.
L’objet de cette communication est de présenter les résultats et une série de pistes de solutions. Les médias sociaux et les nouvelles plateformes digitales offrent des perspectives intéressantes. Des initiatives d’offre active sont en place. Les organismes d’accueil ont commencé à décloisonner leurs services. Réseau-Santé tient de plus en plus compte des besoins particuliers des nouveaux arrivants. La loi sur les services en français est un pas dans la bonne direction. Les politiques d’équité, de diversité et d’inclusion commencent à toucher l’ensemble de la chaîne de valeur du système de santé provincial.
-
Communication orale
La discrimination raciale dans les services de soins de santé au Canada: une menace pour la santé publiqueGrace Jacob (Université d’Ottawa)
Objectif. Cette présentation abordera les résultats d’une étude qui a examiné la prévalence et l'impact de la discrimination raciale majeure (DRM) dans les services de santé chez les personnes Noires au Canada, en relation avec la méfiance et l'acceptation du vaccin contre la COVID-19, les croyances conspirationnistes, les facteurs de stress liés à la COVID-19, la résilience de la communauté et les résultats en matière de santé mentale. Méthode. En utilisant les données provenant de l'ensemble de données BlackVax sur la vaccination contre la COVID-19 chez les personnes Noires au Canada (n = 2002, 51,66 % femmes). Résultats. 32,55 % des participants ont déclaré avoir subi de la discrimination raciale majeure dans les services de santé. Ces individus étaient moins susceptibles d'être vaccinées contre la COVID-19. De plus, ils présentaient des niveaux plus élevés de méfiance à l'égard des vaccins, de croyances conspirationnistes, de facteurs de stress liés à la COVID-19, de dépression, d'anxiété et de stress, tout en démontrant une résilience communautaire plus faible. Conclusion. L'étude souligne à quel point la discrimination raciale est un problème de santé publique important au Canada et invite les organismes de santé publique fédéraux, provinciaux et municipaux à adapter leurs programmes et leurs stratégies pour lutter contre la méfiance résultant de la discrimination raciale.
-
Communication orale
Besoins non satisfaits et expériences d’accès aux soins de longue durée des personnes âgées Noires de ≽65 ans, OntarioIdrissa Beogo (Université d’Ottawa)
Contexte. 19 % de Canadiens ont ≽65 ans, soit une hausse de 16,0%, depuis 2001. Ce vieillissement multiculturel inclut les personnes âgées Noires (PAN) dont le portrait de santé et les déterminants sont peu connus. Objectif. Explorer les besoins non satisfaits et l’accès aux soins de longue durée (SLD) des PAN de ≽65 ans en Ontario. Méthode : Étude mixte réalisée en Ontario (Ottawa et Toronto) avec des participants recrutés par convenance. Des entretiens individuels et des sondages ont été réalisés. Résultat. 13 PAN ont participé aux entretiens et 18 au sondage. 90% des PAN ignore les programmes de SLD en Ontario. Tous préférèrent vieillir à domicile ou retourner dans le pays d’origine. Leur familiarité au système de soins varie de 3 à 6/6. En majorité, ils vivent dans un cadre familial multigénérationnel et sont peu concernés par l’isolement social. Quant à la discrimination dans le système de santé, le discours se résume au bénéfice des soins « in Canada, even you're not working, you still have opportunity to go to the hospital. You don't have to pay[...], I like the health care » et des anecdotes frustrantes « One time when I did my surgery at the[..] hospital, they called for ‘just LeeChing’ and when I was going, I hold my hand up […], they did ignore me because I am black, [...], my doctor was waiting [...], he passed me looking for maybe Chinese ». Conclusion: Ce projet souligne l'importance des études représentatives sur la santé des PAN et leurs déterminants.