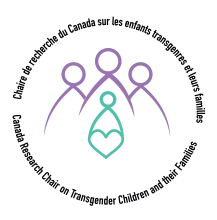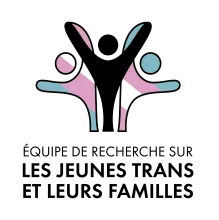Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :Depuis une dizaine d’années, les jeunes trans et non binaires (TNB) sont de plus en plus visibles au Québec, autant dans les médias, les politiques d’organismes qui les desservent que dans la société civile. En 2016, le Code civil et la Charte des droits et libertés de la personne ont été modifiés, notamment pour permettre aux mineurs trans d’obtenir un changement de la mention de sexe sur l’acte de naissance et protéger explicitement l’identité de genre contre les discriminations. En 2017, c’était au tour du gouvernement fédéral de légiférer en ajoutant des dispositions et aussi dans le Code criminel et dans la Charte canadienne des droits et libertés afin de mieux protéger l’identité et l’expression de genre. Depuis juin 2022, il est maintenant possible de demander la mention X sur les documents officiels. Ainsi, les jeunes trans sont non seulement plus visibles, mais aussi mieux protégé·e·s légalement. Cela dit, les situations d’exclusion, de violence et de non-reconnaissance perdurent, et les jeunes TNB continuent à vivre des situations d’adversité qui compromettent leur bien-être et leur inclusion.
C’est d’autant plus vrai pour les jeunes TNB qui se retrouvent à l’intersection de différents groupes historiquement marginalisés, qu’il soit question de jeunes migrant·e·s, racisé·e·s, autochtones, neurodivergent·e·s, en situation de handicap, etc. En effet, les situations d’oppression ne feraient pas que s’additionner, mais s’accumuleraient de manière exponentielle.
Comment les nouvelles connaissances dont nous disposons s’adaptent-elles aux jeunes TNB vivant à l’intersection de multiples dimensions sociales ? Comment assurer que la recherche répond réellement aux besoins des jeunes trans et non binaires, et à leurs communautés, particulièrement celles qui se retrouvent aux croisements de différentes identités sociales ? Quelles interventions s’avèrent les meilleures pour soutenir les jeunes TNB et faciliter le développement de leur résilience ?
Remerciements :Merci à la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles et à l'Équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles. Sincères remerciements à l'Acfas et au comité organisateur du colloque (Robert-Paul Juster, Annie Pullen Sansfaçon, Charles-Antoine Thibeault, Sei Laroche-Tanguay et Claude Amiot) ainsi qu'à Mathé-Manuel Daigneault, coordonnateur.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Annie Pullen Sansfaçon (UdeM - Université de Montréal)
- Robert-Paul Juster (UdeM - Université de Montréal)
- Mathé-Manuel Daigneault (UdeM - Université de Montréal)
- Charles-Antoine Thibeault (UdeM - Université de Montréal)
- Sei Laroche-Tanguay (UdeM - Université de Montréal)
- Mme Claude Amiot (UdeM - Université de Montréal)
Programme
Conférence d’ouverture avec la Clinique Mauve
-
Communication orale
Innover dans les soins intégrés : les pistes pour améliorer l’accès aux soins transaffirmatifs auprès des jeunes trans et non-binaires migrant·e·s et racisé·e·sJavi Fuentes Bernal (UdeM), Edward Ou Jin Lee (UdeM - Université de Montréal)
Les personnes trans et non-binaires (TNB) migrantes et racisées, notamment les jeunes, doivent faire face aux multiples barrières intersectionnelles dans l’accès aux soins et aux services sociaux (SSS). Cette présentation explorera les pistes potentielles afin de diminuer ces barrières et améliorer l’accès aux services transaffirmatifs auprès de cette population. En plus de présenter un survol des pratiques innovantes auprès des personnes TNB migrantes et racisées, cette conférence portera un regard critique sur la place des personnes concernées et les savoirs expérientiels dans la mise en place des SSS. De ce fait, les conférencier·e·s puiseront de leurs expériences de pratique clinique, de recherche et de formation autour de l’accès aux SSS auprès des personnes TNB migrantes et racisées, dans l’implantation de la Clinique Mauve (CM). En automne 2020, la CM a été lancé à Montréal en offrant des soins intégrés auprès des personnes LGBTQI+ migrantes et racisées. L’approche interdisciplinaire est au cœur de son modèle d'intervention et depuis son lancement, la collaboration intersectorielle notamment entre les chercheur·e·s universitaires, le réseau de la santé et des services sociaux et les milieux communautaires a été primordiale à sa réussite. De ce fait, les approches interdisciplinaires et intersectorielles que la CM a pu mettre en place permettent de mieux soutenir les jeunes TNB migrantes et racisées dans leur processus d’affirmation de genre.
Bloc 1 – Vécus et trajectoires des jeunes de la diversité de genre
-
Communication orale
Représenter la préservation de la fertilité chez les jeunes trans et non-binaires : analyse de mèmes au prisme de la justice transreproductiveRebecca Angele (ULavala), Kévin Lavoie (Université Laval), Thalie Pilon (UQO), Maxime Plante (Université Laval), Marie-Philippe Poulin (ULaval)
Dans le cadre de cette communication, nous présentons les résultats d’une étude qualitative sur la préservation de la fertilité chez les jeunes trans et non-binaires (TNB) au Québec. Quinze jeunes de 12 à 23 ans ont participé à la recherche. La méthode de recherche participative « photovoix » (photovoice) a été préconisée pour recueillir leur parole, et ce, à travers deux outils de collecte de données, soit la photographie et le récit narratif. D’abord, les jeunes étaient invité·es à représenter leur point de vue sur la préservation de la fertilité en proposant un mème, soit un assemblage (souvent ironique) de quatre images pour chacun des énoncés suivants : 1) « ce que moi, j’en pense [de la préservation de la fertilité] »; 2) « ce que mes parents en pensent » ; 3) « ce que les professionnel·les de la santé en pensent » et 4) « ce que la société en pense ». Ensuite, des questions leur étaient posées lors d’un entretien individuel pour mieux comprendre leur démarche ayant mené à la création et à la sélection de ces images, et cerner par le fait même leurs représentations de la conservation des gamètes comme moyen d’accéder à la parenté biologique. Ancrée dans une perspective de justice transreproductive, l’analyse des mèmes permet de dégager les aspirations individuelles des jeunes face à la préservation de la fertilité, mais aussi les enjeux familiaux, organisationnels et structurels auxquels iels sont confronté·es.
-
Communication orale
Discontinuation de transition : expérience(s) et perception(s) des professionnel·les travaillant avec les jeunes trans et non-binairesDenise Médico (UQAM), Tommly Planchat (UdeM - Université de Montréal), Annie Pullen Sansfaçon (UdeM)
La grandissante controverse autour de la discontinuation de transition -plus connu sous le terme « détransition » - ravive les débats sur les meilleures pratiques d’interventions auprès des jeunes Trans et Non-binaires (TNB). Si les professionnel·les travaillant avec ce public sont particulièrement la cible des médias qui les accusent d’être responsable du « mauvais diagnostic » de ces jeunes, leurs perceptions et savoirs cliniques sur le sujet demeurent inconnus. Du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, les professionnel·les travaillant avec les jeunes TNB, de tout pays et discipline confondus, ont été invité à répondre à un questionnaire en ligne sur la plateforme Limesurvey. Parmi les 147 professionnel·les ayant initialement participé à l’étude, 61 ont répondu à 60% du sondage incluant les questions sur la discontinuation. La présentation portera sur les résultats d’une analyse thématique (Braun et Clarke, 2019) effectuée sur les questions ouvertes concernant leurs perceptions et expériences cliniques avec la discontinuation de transition. Les professionnel·les rapportent dans leur pratique des situations variées de discontinuation, certain·e·s déclarent ne jamais avoir rencontré ou suivi de jeune ayant discontinué leur transition. Leur compréhension du phénomène est diversifiée et semble globalement cohérente avec la recherche naissante sur le sujet. Le lien entre pratique professionnelle et discontinuation de transition est quasiment absent dans leur discours.
-
Communication orale
Recherche de soins médicaux d'affirmation de genre: processus décisionnel et impact sur le bien-être des jeunes trans et non-binaires et de leurs familles au Canada et en AustralieManvi Arora (UdeM - Université de Montréal), Annie Pullen Sansfaçon (UdeM), Charles-Antoine Thibeault (UdeM - Université de Montréal)
Il est fréquemment rapporté qu'il existe diverses barrières à l'accès aux soins médicaux d'affirmation de genre (SMAG): notamment l'absence de support parental (Clark et al., 2020), la distance, l'absence de connaissances des pourvoyeurs de soins ou encore l'absence de support social (Taylor et al., 2020). Alors que ces études nous offrent un portrait peu réjouissant de l'accès aux SMAG pour les jeunes TNB, elles n'offrent que peu d'informations quant aux facteurs influençant les décisions des jeunes TNB et de leur famille dans les processus décisionnels auxquels font face les parents et enfants TNB à l'approche de la puberté.
Afin de répondre à ce besoin, une équipe de chercheurs a conduit des entrevues semi-structurées dans 6 pays (Canada, Suisse, Angleterre, Australie, Inde et États-Unis) afin d'en savoir plus sur l'impact du processus de recherche de SMAG sur le bien-être des enfants TNB de 8-14 ans et leur famille. Les résultats préliminaires de cette étude permettent de dresser un portrait des facteurs qui influencent les décisions médicales et le bien-être des familles canadiennes et australiennes. Nous présenterons d'abord les facteurs influençant le processus décisionnel des familles (peur des procédures médicales, préservation de la fertilité, importance de la dysphorie, barrières à l'accès, et recommandations médicales), puis aborderons l'impact de l'accès, d'un refus d'accès, ou d'un délai d'accès, sur le bien-être des jeunes TNB et de leur famille.
-
Communication orale
Les jeunes qui détransitionnent : l’apport de la théorie de la perte ambiguë pour l’accompagnement professionnel pendant la transition et la détransitionMorgan Gelly (UdeM), Rosalie Gravel (UdeM - Université de Montréal), Annie Pullen Sansfaçon (UdeM)
Bien que la détransition soit souvent dépeinte comme un retour à une identité cis empreinte de regret, de nouvelles recherches soulignent la complexité de l’expérience des personnes en discontinuation de transition. Leurs expériences semblent hétérogènes (Expósito-Campos, 2021) et nuancées (Pullen Sansfaçon et al., 2023). Néanmoins, les besoins et perspectives de ces personnes sont encore peu explorés. Le but de cette présentation est de montrer le discours de jeunes ayant discontinué un parcours de transition quant à l’accompagnement professionnel pendant la transition et la détransition. Des entrevues de 68 à 116 minutes ont été menées auprès de 20 jeunes de 15 à 25 ans ayant discontinué un parcours de transition. Le recrutement a été fait via des réseaux sociaux. L’analyse thématique inductive (Braun et al., 2019) a permis d’analyser le verbatim et d’identifier les thèmes en lien avec le support professionnel. Trois thèmes ont été identifiés : la perspective actuelle des jeunes quant au support professionnel reçu durant la transition, leurs attentes actuelles quant aux pratiques professionnelles pour les soins d’affirmation de genre et leurs besoins actuels en termes de support professionnel. Les résultats suggèrent des besoins et perspectives variés et complexes. La théorie de la perte ambiguë (Boss, 2007) – référant aux situations de perte dont l’objet est incertain – aide à comprendre l’ambivalence et constitue une piste intéressante à l’accompagnement des jeunes.
Dîner et session par affiches
-
Communication par affiche
Identités et modalités de genre chez les jeunes 2S/LGBTQIA+ au Canada : résultats préliminaires du sondage J’prends ma placeOlivier Ferlatte (UdeM), A. Pozzo di Borgo (UdeM), Amina Rhanim (UdeM), Guillaume Tardif (UQAM - Université du Québec à Montréal), Élie Tremblay (UdeM)Affiche
Problématique. Les conceptions du genre ont rapidement évolué dans la société canadienne ces dernières années. À l’avant-garde de ces évolutions, les jeunes sont de plus en plus à nombreux·ses à se décrire d’une façon qui s’écarte des notions conventionnelles du genre. Les nuances de leurs réalités liées au genre restent cependant peu explorées.
Objectif. Détailler les identités et les modalités de genre des jeunes 2S/LGBTQIA+ au Canada.
Méthodologie. Des analyses statistiques ont été réalisées avec les données du sondage J’prends ma place, élaboré par de jeunes chercheur·es queers.
Résultats. Au total, 3668 jeunes de 15 à 24 ans ont répondu au sondage. 29% (n=972) des jeunes se sont identifié·es à plus d’une identité de genre. En ordre, les identités de genre femme, non-binaire et hommes étaient les plus rapportées. En ce qui concerne la modalité de genre, 40% ont rapporté être trans. La majorité des personnes trans s’identifiait au genre non-binaire (31%), alors que 6% s’identifiait comme femme et 27% comme homme. 81% des personnes intersexes et 58% des personnes bispirituelles s’identifiaient comme trans. Des variations en fonction de l’âge, de l’orientation sexuelle et de la langue sont également notées.
Conclusion : Ce projet est un apport aux luttes contre la disqualification des jeunes en ce qu’il offre des données permettant de se familiariser avec leurs conceptions du genre.
-
Communication par affiche
L’impact des stéréotypes de genre sur la cognition des personnes transgenres et de personnes non-binaires, une approche transdisciplinaireMina Guérin (UdeM - Université de Montréal), Fanny Saulnier (UdeM - Université de Montréal)
Les sexes diffèrent dans de nombreuses fonctions neurocognitives. Ces différences entre les sexes sont appelées cognition sexuellement polymorphe (CPS) et sont influencées par le sexe et les hormones de stress. Des facteurs extrinsèques, tels que la présence de stéréotypes sexuels, influencent également la CPS. Certaines études ont étudié ce phénomène chez des participants cis hétérosexuels. Cependant, aucune étude ne mentionne l'impact des stéréotypes de genre sur les personnes de la diversité de genre, ce qui représentera donc l'objectif principal de cette étude. Nous émettons l'hypothèse que [1] les stéréotypes de genre influenceront la performance cognitive, négativement lorsque le stéréotype désavantage le participant et positivement lorsque le participant est avantagé. [2] Comme la détresse des personnes non binaires est plus élevée lorsqu'elles entendent des stéréotypes de genre, le stéréotype, quel que soit son type, diminuera la performance. [3] L'influence des stéréotypes sexuels sera expliquée par les niveaux d'hormones sexuelles et de stress.
Cette étude en cous de recrutement et financée par le CRSNG a pour but de recruter un total de 264 participants. Le protocole vous sera présenté lors de ce colloque.
Plusieurs retombées sont envisagées par cette étude. Notamment, en comprenant comment les stéréotypes de genre touche les personnes de la diversité de genre, il sera plus réalisable de lutter contre ces situations d’adversité.
Bloc 2 – Contextes sociaux et juridico-politiques et leurs impacts sur le vécu des jeunes
-
Communication orale
« Ce n’est pas une niaiserie inventée par des ados sur Internet » : expériences ayant influencé la construction de l’identité de genre de jeunes adultes non binaires au QuébecAnnie Fontaine (ULaval), Kévin Lavoie (ULaval), Maxime Plante (Université Laval)
La trajectoire des personnes non-binaires tend à se dérouler à l’intersection de multiples systèmes d’oppression qui produisent d’importantes répercussions sur la construction de leur identité de genre, puisqu’ils nient leur existence, les occultent, les restreignent ou les stigmatisent. Qui plus est, le manque de représentations sociales des identités sortant de la binarité contribue à ce que les personnes non-binaires prennent conscience et affirment leur identité de genre de façon encore plus tardive que les personnes trans. De fait, les personnes non-binaires sont particulièrement susceptibles de rapporter des difficultés à conceptualiser leur identité de genre ou de déplorer un manque de vocabulaire pour la décrire. En ce sens, cette communication vise à présenter les résultats préliminaires d’une étude qualitative portant sur les expériences ayant influencé la construction de l’identité de genre de 15 jeunes adultes non-binaires au Québec (18-29 ans), interviewé.e.x.s par le Partenariat SAVIE-LGBTQ. Lors de a communication, nous nous attarderons principalement à exposer les effets de l’hétéronormativité, de la cisnormativité, de la colonisation et du sexisme sur la construction de l’identité de genre des jeunes adultes non-binaires.
-
Communication orale
La transition légale en chiffres : analyse des statistiques sur les changements de mention de sexe au Québec du point de vue des politiques publiquesFlorence Chenel (UdeS - Université de Sherbrooke), Isabelle Lacroix (UdeS)
Depuis le début des années 2000, le Québec a grandement avancé sur le plan des politiques trans-spécifiques. Que ce soit le retrait de l’exigence du célibat (2004), le retrait de l’exigence des opérations de réassignations sexuelles (2015), l’abolition de l’interdiction de transition pour les mineur·e·s (2016) ou l’ajout de la mention de sexe non-binaire (2022), chaque politique a eu un effet sur les parcours de transition des personnes trans et non-binaires. En plus d’une constante augmentation du nombre de demandes, on y voit entre autres des augmentations de courbes majeures dans les mois suivants certaines politiques phares. De plus, alors que dans la période pré-2015, les demanderesses transféminines représentaient annuellement du deux-tiers aux trois-quarts des demandes, à partir de 2016, ce sont les demandeurs transmasculins qui composent maintenant la majorité des demandes de changement de la mention du sexe. Enfin, on note également une augmentation significatives des demandes de changement de la mention du sexe dans les mois suivant le dépôt du projet de loi 2 en 2021, et non uniquement suivant son adoption, ce qui soulève des questionnement intéressant sur les effets de la mouture initiale du projet de loi 2.
-
Communication orale
État des faits : la transition légale au Québec depuis la reconnaissance de la mention du sexe X, et des enjeux factuels toujours présents auprès des jeunes trans et non-binairesCeleste Trianon (UdeM - Université de Montréal)
Depuis la légalisation de la non-binarité au Québec le 17 juin 2022, de nombreuses personnes, jeunes incluses, ont pu accéder à un changement. Par contre, ceci n’est pas vrai pour toutes les jeunes: certaines personnes n’ont tout simplement pas accès à ces changements, pour des raisons variées, dont l’accès à un.e professionnel.le de la santé ou des services sociaux, le droit international privé et l’accès aux certificats de naissance, ainsi que dans certains cas, l’absence de consentement parental et le non-accès à une boîte à courrier confidentielle.
Cette présentation va focuser, d’une perspective intersectionnelle et communautaire / «sur le terrain», sur divers enjeux juridiques et factuels qui font en sorte à ce que la transition légale n’est pas également accessible pour tous les jeunes trans dans l’ensemble du territoire québécois. Divers anecdotes de la Clinique de transition légale (gérée depuis 2022 par l’autrice) seront mis d’avant. Seront abordés aussi quelques pistes de solution pour remédier à certains des enjeux discutés.
-
Communication orale
Performer le (non)-genre : les intrications de la grossophobie et de la nonbinaritéCatherine Lemire (UQAM - Université du Québec à Montréal)
La recherche proposée porte sur le potentiel non-normatif du gras, qui subvertit les normes de genre binaire. C’est suite à plusieurs années d’implication dans des milieux queer qu’est né l’intérêt de cette recherche, alors que nous avons eu l’occasion d’observer que les angles morts qui subsistent sur le terrain quant à ces enjeux se répercutent également dans la littérature queer et féministe.
La nonbinarité, qui défie les catégories de genre binaires, gagne en visibilité depuis les dernières années au sein des sociétés occidentales[1]. Nous mobilisons la performativité du genre butlérienne pour proposer que l’émergence de la non-binarité sur la scène politique mainstream s’accompagne d’une performativité de (non-)genre, et que celle-ci, en dépit de son aspiration à subvertir les normes de genre, reconduit des principes grossophobes[2].
Une légère historicisation de la grossophobie, en tant qu'oppression systémique basée sur la grosseur d'une personne[3], révèle qu'elle prend source dans des origines coloniales sur lesquelles se sont également édifiées le genre. Les catégories de genre binaires, ainsi, s’accompagnent d’une injonction à la minceur, que n’arrive pas à dépasser la non-binarité.
Nous souhaitons, pourtant, réaffirmer le potentiel subversif du gras, alors que le fait d’être gros-se,ou d’être d’une grosseur qui surpasse les standards sociétaux occidentaux valorisant la minceur, déstabilise la notion même de genre[4].
Bloc 3 – Améliorer les réseaux de soutien autour des jeunes : famille, école, environnement
-
Communication orale
Expérience et vécu des parents d’enfants de la diversité de genre vivant en régionNaomie-Jade Ladry (UdeM - Université de Montréal), Annie Pullen Sansfaçon (UdeM), Julie Temple-Newhook (Memorial University)
Lors du coming out, le processus d’acceptation est différent pour chacun·e et peut teinter le type de soutien offert, ce qui peut être un enjeu sur le bien-être et la santé mentale (Pullen Sansfaçon et al., 2015 ; 2019). Les parents vivent également des difficultés telles que du stress externe, de l’ostracisme de la part de leur entourage (Pullen Sansfaçon et al., 2022) et peinent à trouver des services en région. L’accès aux ressources est donc fondamental et les parents ont besoin d’être soutenu·e·s dans l’accompagnement de leurs enfants ainsi que pour naviguer dans les différentes structures de services.
Le projet de recherche, réalisé dans un contexte franco-canadien, tente d’apporter une première documentation sur les expériences des parents ayant des enfants de la diversité de genre en région afin de développer des connaissances sur leurs vécus et mieux saisir les enjeux et leurs besoins spécifiques. Cette recherche a été réalisée en deux vagues, soit une collecte de données auprès de parents d’enfants TNB habitants la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Îles-de-la-Madeleine qui ont participé à cinq rencontres de groupes, et neuf entrevues en profondeurs avec des parents habitant la province de Québec, hors des grands centres urbains. L’analyse s’est faite par vague en faisant appel à l’analyse thématique inductive, avant que les résultats de chaque vague aient été mis en dialogue. Finalement, cette communication présentera les résultats recueillis des deux vagues.
-
Communication orale
Représentations des personnes trans et non-binaires dans une population étudiante collégiale et universitaire rencontrée par le GRIS-Montréal : considérations intersectionnellesMathilde Baril-Jannard (McGill), Amélie Charbonneau (GRIS-Montréal), Aimé Cloutier (GRIS-Montréal), Élias Daigle (Université de Moncton), Marie Houzeau (GRIS-Montréal), Kévin Lavoie (ULaval), Julien Plante-Hébert (UQAM), Gabrielle Richard (Université de Paris-Est Créteil), Olivier Vallerand (UdeM)
Le GRIS-Montréal est un organisme communautaire qui intervient par le témoignage dans une diversité de milieux, notamment scolaires, afin d’y démystifier des orientations sexuelles ainsi que les identités trans et non-binaires. Lors de ses interventions, l'organisme recueille des données par questionnaire. Nous en avons dégagé les représentations de jeunes adultes étudiant au collégial ou à l'université concernant les personnes trans et non-binaires (TNB).
Nous avons pour ce faire employé une méthode mixte. Dans un premier temps, les réponses à court développement de 689 questionnaires ont été codifiées et analysées de manière inductive afin d’en dégager des thèmes principaux. Dans un deuxième temps, un relevé quantitatif de la fréquence de thèmes choisis a été réalisé.
Les résultats s’articulent en trois volets, soit 1) les définitions offertes à propos des personnes TNB comme révélatrices du niveau de compréhension des jeunes adultes; 2) les attitudes à l’endroit des personnes TNB et 3) les représentations des jeunes adultes à l’endroit des personnes TNB.
Après avoir révélé et comparé les principales représentations émergeant du matériau, nous proposons d’exposer les considérations intersectionnelles relatives à ces représentations. Nous partagerons ensuite des éléments de réflexion sur le contexte d’intervention du GRIS-Montréal suivant les mêmes considérations.
-
Communication orale
Le vécu des parents d’enfants trans et non binaires dans la région du Saguenay-Lac-Saint-JeanDelphine Rambeaud-Collin (Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA), CHU Toulouse,), Yann Zoldan (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
Plusieurs études (Hidalgo & Chen, 2019; Pullen Sansfaçon & Medico, 2021) se sont intéressées au vécu des parents d’enfants trans et/ou non binaires (TNB) et ont souligné l’importance du soutien parental pour la santé mentale des jeunes (Pullen Sansfaçon et al., 2015 ; Olson et al., 2016). Peu d’études sur ces questions ont été menées en région, bien que des enjeux spécifiques aient déjà été identifiés au Québec (Pullen Sansfaçon et al., 2021). Aussi, l’objectif de notre recherche est de comprendre l’expérience et le vécu des parents TNB au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Notre méthodologie qualitative basée sur des entretiens de recherche (n=15) est celle de l’exploration phénoménologique de trois aspects : la description du vécu ; la mise en sens et l’interprétation de celui-ci; et enfin la mise en récit de son expérience.
Nos résultats montrent un processus d’adaptation des parents s’accompagnant de marqueurs de stress face aux changements subjectifs et culturels vécus par leurs enfants. Nous proposons une lecture des réaménagements des idéaux familiaux en lien avec un contexte cisnormatif.
Nous présenterons pour illustrer notre propos l’analyse du cas d’un couple de parents.
Nous verrons comment ce cas mis en perspective avec les autres résultats de notre recherche permet d’illustrer les besoins exprimés par les parents du Saguenay-Lac-Saint-jean concernant des services appropriés et accessibles pour soutenir la santé des jeunes et de leur famille.
-
Communication orale
Améliorer l’accès à l’éducation, à la représentation, et aux espaces sécuritaires pour répondre aux besoins des jeunes des jeunes trans autochtones et bispirituel·le·sBoivin Johnny (École), Pasha Partridge (Project 10), Annie Pullen Sansfaçon (UdeM - Université de Montréal)
Les jeunes trans et autochtones et les jeunes bispirituel·le·s subissent de multiples formes de violence structurelle, à l’intersection de leur genre et de leur identité autochtone. Que ces jeunes habitent sur réserve ou à l’extérieur, les études ont mis en lumière des défis spécifiques notamment vécus en lien avec l’auto-identification, des conditions de pauvretés importantes, la violence, et le manque d’accès aux soins de santé. Cette communication présente les résultats d’une recherche-action faisant appel aux cercles de parole coanimés par une Aînée et deux jeunes bispirituel·le·s. Développés en collaboration avec Projet 10, l’organisme partenaire au projet, les cercles de paroles se sont déroulés sur une période de 19 rencontres tenues entre septembre 2021 et avril 2022, à Tiohtià:ke et en ligne. Les participant·e·s des cercles de parole ont discuté de leurs enjeux les plus pressants, des causes sous-jacentes à ces enjeux, et des pistes de solutions pour y faire face. À partir de la perspective du colonialisme d’occupation, cette communication examine les trois grands enjeux ressortis des discussions, soit le manque d’accès à des espaces sécuritaires, le manque de représentation et le manque d’éducation.
Retour sur la journée et perspectives de recherche citoyenne
-
Communication orale
Intersectionnalité, positionnalité et recherche partenariale : quel futur pour la recherche auprès des jeunes trans et non binaire?Claude Amiot (UdeM), Mathé-Manuel Daigneault (UdeM), Robert-Paul Juster (UdeM - Université de Montréal), Annie Pullen-Sansfaçon (UdeM)
Animée par Robert-Paul Juster.
Panélistes :
Claude Amiot – Chercheuse citoyenne, projet Engagement
Mathé-Manuel Daigneault – Professionnel de recherche au Laboratoire inclusif de recherche et de développement de l'UdeS, coordonnateur de l'Équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles & formateur en ÉDI et écriture inclusive
Annie Pullen Sansfacon – Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles
Ce panel réfléchira à la question de la positionnalité en recherche, c’est-à-dire la position sociale qu’occupe une personne pour faire de la recherche auprès d’un groupe que ne partage pas cette positionnalité. Les panélistes discuteront des avantages, mais également des possibles difficultés/défis pouvant émerger de ces dynamiques chercheur·e·s / personnes recherchées
À travers leurs diverses expériences, soit comme personnes trans / cis, jeunes / âgées, parents / intervenant·e·s, et origine culturelle, les panélistes réfléchiront au futur de la recherche sur les jeunes trans et non-binaires et leurs familles.