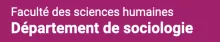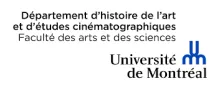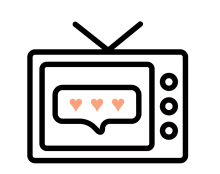Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Les séries télé sont exponentiellement présentes dans notre quotidien, comme en témoignent l’émergence de nouvelles plateformes de vidéo à la demande; la persistance de pratiques comme le visionnage en rafale; les représentations de plus en plus ouvertes aux thématiques de la sexualité ou de la diversité au petit écran, avec la visée parfois « éducationnelle » de celles-ci et les discussions qu’elles suscitent dans l’espace publique; ou encore la création de festivals dédiés. Pourtant, une perception des séries comme « mauvais objet d’attachement » ou « plaisir coupable » est encore courante. Le besoin identifié est de donner une plus grande cohérence aux connaissances au sujet des pratiques qui se développent autour de la culture des séries et, à proprement parler, de la dimension affective de l’attachement. Si des travaux sur la sériephilie existent, il est maintenant le temps d’étoffer ces réflexions à l’aune d’une présence accrue de ces phénomènes dans la vie de tous les jours, de leur statut de repère culturel partagé et de leur influence sur les imaginaires collectifs.
Quels outils pouvons-nous développer afin de mieux comprendre la place de l’amour dans notre relation avec les séries, devant et derrière l’écran ? En utilisant comme porte d’entrée l’exemple des représentations de l’amour et de l’intimité, nous discuterons des façons dont les séries nous communiquent un savoir sur notre forme de vie, sur nos relations, et mettent en scène celles-ci avec une grande complexité. En ce sens, les séries sont à appréhender comme des « modèles de conduite » qui stimulent, autant que la littérature, l’imagination morale et la réflexivité relationnelle (Murdoch, 1970). Ce colloque portant sur l’amour tel que les séries le représentent et sur l’amour des publics pour les séries vise à repenser ces enjeux comme foncièrement politiques, du moment où la représentation médiatique est une des composantes du changement social.
Remerciements :Programme "Mobilisation des connaissances" UdeM/BRDV
Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal
Département de sociologie de l'UQAM
IREF - Institut de recherches et d'études féministes
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables : Partenaires :Programme
L’amour en série
-
Communication orale
Queerer l’amour dans les séries télévisées françaisesStéfany Boisvert (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Durant la dernière décennie, plusieurs recherches et publications ont documenté la place grandissante accordée aux relations amoureuses queer dans les séries télévisées (Beirne, 2012; Brey, 2018; Parsemain, 2019; GLAAD, 2022). Par relations queer, nous référons ici aux relations amoureuses et/ou sexuelles mettant en scène des personnages dont l’identité de genre et/ou la sexualité est non-normative. Or, la plupart de ces recherches se concentrent sur les productions états-uniennes les plus populaires. Mais qu’en est-il au sein des productions télévisuelles francophones? En s’appuyant sur les premiers résultats d’un projet de recherche qui vise à documenter l’inclusion de personnages queer dans les séries télévisées françaises produites depuis 2018 (SKAM France, Chair Tendre, Fiertés, Les Engagés, Les Sauvages, Ici tout commence, etc.), cette communication mettra en lumière la façon dont y sont mises en scène des relations qui bousculent l’hétéronormativité de la télévision hexagonale. Ce faisant, il s’agira aussi de comparer avec la production télévisuelle québécoise (Boisvert, 2022, 2023) afin d’identifier quelques similitudes narratives et discursives (reproduction de schémas narratifs connus, discours plus explicites et visibilité plus grande dans les séries destinées au Web, etc.), tout en identifiant quelques différences concernant le profil des personnages représentés.
-
Communication orale
Amour-haine; White lotus saison 2 et l’emblématique Jennifer CoolidgeJoelle Rouleau (UdeM - Université de Montréal)
White Lotus consolide sa deuxième saison autour des dynamiques de couples (hétéro)normés : jalousie, mensonge, confiance, monogamie, possessivité, tromperie, (travail du) sexe, expérimentation; on s’engage au cours des sept épisodes dans une pléthore d’expériences « amoureuses » désastreuses sous fond de voyage romantique en Sicile. Ma présentation sera de l’ordre de l’essai théorique articulant ensemble les concepts de chrononormativité (Edelman) et de phénoménologie queer (Ahmed) afin d’étudier les propositions d’amour pour et dans la série White Lotus saison 2. J’y poursuivrai également le développement du concept de sensibilités queer afin d’explorer l’ambivalence de la série à mettre en scène de riches états-uniens passant une semaine de vacances dans un tout-inclus italien où l’activité principale revêt du « people’s watching ». Il y a dans l’expérience de cette double spectature, un étrange mélange entre une curiosité, une envie et un dégout pour cette vie où les relations amoureuses sont représentées plutôt sous le spectre du contrôle que du sentiment amoureux. Finalement, tous les personnages de la série sont insupportables à leur manière, rendant l’affection spécifique envers l’un d’entre eux difficile, changeante, mouvante. J’argue toutefois que l’amour pour la série triomphe grâce au personnage de Tanya McQuoid interprété par Jennifer Coolidge qui incarne le double tranchant de cet « american dream » à la fois dans son personnage que dans sa carrière d’actrice.
-
Communication orale
Découvrir l'amour et la sexualité dans le paysage italien, clichés et nouvelles perspectivesGreta Delpanno (UdeM - Université de Montréal)
Des essais vidéos sur la représentation de l’amour romantique en Italie et ses clichés seront proposés en se concentrant sur des thèmes qui reviennent dans différentes séries télévisées italiennes. Le paysage est ici montré comme un locus amoenus où le coup de foudre et le romanticisme s’épanouissent sur les plages chaudes ou dans les villes médiévales. À cette occasion, je voudrais présenter la série Prisma (Prime Video 2022- ) et la manière dont elle se situe dans le panorama télévisuel italien. Prisma raconte l’histoire de deux frères jumeaux qui explorent leurs relations avec leurs pairs, leur premier amour, leur sexualité et leur identité de genre. La série aborde les enjeux du queerness en témoignant comment les jeunes se remettent en question sans aucun type de jugement. Ce produit pourrait être considéré comme un coup de pouce, de la part de son créateur, Ludovico Bessegato, et de Prime Video lui-même vers une représentation plus complète des nouvelles générations. La série tombe-t-elle dans le piège d’afficher certains des stéréotypes déjà vus dans d’autres séries italiennes contemporaines ? Comment les relations amoureuses sont-elles montrées et comment le paysage italien est-il abordé ? Pour cette occasion, j’aimerais chercher des réponses aux questions posées ci-dessus et pousser cette réflexion plus loin, en contextualisant la série, et éventuellement entamer un dialogue pour analyser le sujet plus en profondeur.
Amour et féminisme
-
Communication orale
Geneviève Sellier, L’amour dans les dramas sud-coréens, expression d’un féminisme populaireGeneviève Sellier (Université Bordeaux Montaigne)
Depuis environ deux décennies, les séries sud-coréennes ou « dramas » ont trouvé un public dans le monde entier, essentiellement féminin et souvent populaire, grâce à leur capacité à traiter les sentiments en général et l’amour en particulier comme un processus de longue haleine, marqué par des échanges minuscules au sens dramatique, mais importants en termes psychologiques, par des regards et des paroles qui décrivent par le menu les interactions entre les personnages. Dépourvus de toute scène de sexe, ces dramas mettent l’accent sur les multiples interférences affectives qui compliquent la vie des personnages, très souvent féminins, soumis aux pressions familiales dans cette société encore très patriarcale, aux pressions d’un monde professionnel très hiérarchisé et totalement dominé par les hommes (toutes ces protagonistes travaillent, en général dans le secteur tertiaire).
Ces « dramas » écrits par des femmes scénaristes, rangés sous le terme anglophone de « romance », sont des séries closes comportant le plus souvent une seule saison de 16 épisodes, dont la force subversive est d’autant plus grande qu’elle se place du point de vue du personnage féminin, c’est-à-dire le plus soumis à toutes les formes de domination.
-
Communication orale
Du harem inversé au boy’s love : les nouveaux scripts sexuels et romantiques pour femmesJulie Lavigne (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Le Devoir titrait en janvier 2022, « 2021, l’année de la mangamania au Québec ». La montée en popularité chez les jeunes et moins jeunes des mangas et de leur version animée ne fait plus aucun doute. Que ce soit sur Netflix ou des plateformes plus spécialisées comme Crunchyroll, Funimation ou encore la plus récente HiDive, les animés japonais transforment le paysage audiovisuel des jeunes. Or, dans les animés pour filles (shojo) en particulier, on remarque de nouveaux scripts sexuels et romantiques qui renouvellent l’horizon d’attente en matière de discours sur l’amour et la sexualité. Dans cette présentation, je présenterai les analyses préliminaires sur deux scripts novateurs tirés d’un corpus d’une vingtaine d’animés shojo ou josei (pour femmes adultes) conçus par des femmes mangakas : les animés de type boy’s love ou yaoi qui relatent des relations sexuelles ou romantiques entre hommes, et les harems inversés, qui présentent des histoires centrées une femme convoitée romantiquement ou sexuellement par de nombreux hommes ou femmes.
-
Communication orale
Elles sont ensemble et je suis avec ellesAnne Martine Parent (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
Dans la deuxième saison de Sex Education, une ligne d’intrigue se développe autour d’une agression sexuelle que subit le personnage d’Aimee : un homme se frotte contre elle et éjacule sur son jeans dans un autobus bondé. Quelques épisodes plus tard, Aimee et d’autres filles sont en retenue dans la bibliothèque de l’école; on soupçonne l’une d’entre elles d’avoir fait un graffiti calomniant une enseignante. Le groupe de filles est sommé de trouver ce qui les unit en tant que filles. Elles n’y arrivent pas jusqu’au moment où Aimee parle de son agression. Chacune d’entre elles, par la suite, confie une expérience de violence sexuelle. Ce groupe de filles qui se retrouvent ensemble par hasard, est hétéroclite; certaines sont amies, d’autres se détestent, mais dans cette mise en commun de leurs expériences de violences sexuelles, elles sont soudainement unies. C’est cette union de filles et de femmes en réponse aux violences sexuelles que je me propose d’aborder dans ma communication. Je vois cette union comme une sororité dans laquelle des filles et des femmes qui n’ont parfois aucune affinité ni liens d’amitié sont finalement liées par une expérience intime commune. Ce que je veux analyser, aussi, c’est mon rapport à cette sororité, l’amour et la solidarité que je ressens pour elles et qui font que je me sens moi aussi unie à elles. J’utiliserai principalement les travaux de Sara Ahmed sur les affects, et en particulier les affects féministes (2004, 2010, 2017).
-
Communication orale
Amitiés féminines et nouvelles représentations de la sexualité dans les séries à chœur féminine (2010-2020)Céline Morin (Université Paris Nanterre)
De I Love Lucy (1951-1957) jusqu’à Desperate Housewives (2004-2012) en passant par The Mary Tyler Moore Show (1970-1977), les séries télévisées ont privilégié comme centre des récits la figure de l’héroïne qui, dans son cheminement plus ou moins victorieux vers l’émancipation personnelle, devait vaincre les obstacles sexistes en mobilisant des ressources individuelles. Ce mouvement se double aujourd’hui d’une vague de séries « à chœur féminin », centrées sur des couples ou des groupes de femmes très solidaires. Cette présentation explore six de ces productions : Girls, Mom, Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend, Grace & Frankie et Sex Education. Dans ces séries, les personnages mettent leurs amitiés au service de forums intimes, où la solidarité féminine sert d’espace de discussion, d’élaboration et de négociation de la sexualité individuelle, en ayant pour socle la reconnaissance des désirs et des pratiques. Cette pluralisation des scripts sexuels ouvre la voie à des innovations majeures de représentations, au premier rang desquelles la diversification des corporalités représentées et l’ouverture des âges de la sexualité, des adolescent·e·s aux personnes âgé·e·s.
Lunch et présentation de la plateforme Mieux comprendre l’amour pour/par les séries
Perspectives sur la sériphilie
-
Communication orale
La sériphile aujourd’huiJoyce Cimper (UdeM - Université de Montréal)
Cette intervention se propose de faire, tout d’abord, un état des lieux des études portant sur la sériphilie. Elle retracera les théories ayant été formulées jusqu’ici pour expliquer notre attachement pour les fictions télévisées (personnages, monde immersif, complexité narrative, etc.). Après un tour d’horizon des stratégies employées par les instances de production afin de favoriser notre engagement, la présentation se focalisera sur les instances de réception et examinera les gestes spectatoriels par lesquels tendent à se manifester notre affection pour les séries (créations faniques, visionnages répétées, etc.) ainsi que les espaces dans lesquels elle se déploie (les réseaux sociaux, le domicile, l’étranger avec le tourisme sériel). La présentation exposera ensuite les stratégies et les pratiques demeurant à explorer afin de comprendre pourquoi et comment au juste nous aimons aujourd’hui les œuvres du petit écran (du rôle que peuvent avoir les plateformes dans l’exacerbation de notre intérêt aux watch parties).
-
Communication orale
Appropriation / possession / appartenance : considérer l’engagement des étudiant.es dans une production collective de savoirZakia Ahasniou (UdeM - Université de Montréal)
Cette communication réfléchira à l’attachement des séries dans le cadre des études télévisuelles et plus spécifiquement à l’engagement qu’entretiennent les étudiant.es de cette discipline avec leur objet d’étude. En passant par des notions de réception et de fandom plus générales pour expliquer la spécificité d’un amour pour la/les série/s, nous nous intéresserons à comprendre comment cette spécificité participe d’une production de savoir et d’un partage de connaissance pour les étudiant.es dans le cadre de l’enseignement académique. Nous chercherons à comprendre comment la vaste étendue d’objets d’étude potentielle, l’accessibilité et l’immédiateté grandissante de ces objets et leur rapport intime avec le temps de diffusion constituent des éléments, propres à la sérialité, qui tendent à conférer aux fans sériels une connaissance très large de l’objet d’étude, peut-être même un statut d’expert.es. Il sera alors intéressant de réfléchir et d’émettre des hypothèses sur l’impact de cette connaissance spécifique des étudiant.es sur une hiérarchie structurelle du partage de savoirs afin de se demander si les études télévisuelles, par la nature de leur objet d’étude en constante évolution, inachevé, contemporain, peuvent participer d’une déconstruction de la hiérarchie structurelle dans l’enseignement académique et favoriser une construction collective et horizontale de savoirs. On se demandera quelle place peut prendre cet attachement, cet amour, dans le travail académique.
-
Communication orale
Apprendre à vivre, apprendre à aimer. Autour de The LeftoversSimon Laperrière (UdeM - Université de Montréal)
Le 14 octobre 2011, 2% de la population mondiale a soudainement disparu de la surface de la Terre. Neuf ans plus tard, l’avènement d’un virus aux origines nébuleuses entraîne un confinement à l’échelle planétaire. Plusieurs sériphiles tissent alors un lien entre les deux événements, et ce, même si le premier est de l’ordre de la fiction télévisuelle. Selon le raisonnement de cette communauté de fans, The Leftovers pourrait bien dissimuler les clés pour mieux réfléchir la pandémie de la COVID-19. Interpréter l’actualité à travers le prisme de la culture populaire peut surprendre. Au lieu de remettre en cause sa rigueur, cette communication souhaite démontrer comment cette approche découle d’une posture exégétique. En s’inspirant des travaux de Pacôme Thiellement, elle propose d’analyser le regard que pose certain·e·s téléspectateur·ice·s sur le monde contemporain. Par la même occasion, elle révèle comment The Leftovers – à défaut d’élucider la genèse de la COVID – nous apprend à vivre.
Table ronde
Table ronde avec des invité.e.s du milieu de l'industrie, des festivals et de la critique.
-
Communication orale
Comment un critique amoureux du cinéma a fini par aimer aussi les sériesBruno Dequen (Revue 24 images)
-
Communication orale
La présence des séries dans les festivalsCamille Martinez (Festival du nouveau cinéma)
Lancement et réseautage
Scènes de la vie conjugale
-
Communication orale
Intimité, analphabétisme émotionnel et ambiguïtés des outils thérapeutiques dans les trois versions sérielles de Scenes from a Marriage (1973-2021)Lamia Djemoui (UQAM - Université du Québec à Montréal), Chiara Piazzesi (UQÀM)
Dans le schéma global du couple hétérosexuel, le travail émotionnel est davantage effectué par les femmes (Renard, 2018). Ces obligations naturellement féminines (Becker, 2005 ; Wright 2011), nécessaires au maintien du lien affectif dans l’intimité, sont consolidées par certains discours psychologiques (Renard, 2018) représentatifs d’une culture thérapeutique contemporaine. Toutefois, si elle renforce les relations de pouvoir entre les genres (Duncombe et Mardsen 1993, Moskovitz 2001), en responsabilisant les femmes face à leur « devoir » (Renard, 2018) émotionnel: la place de la culture thérapeutique dans l’intimité demeure complexe (Wright, 2011). En effet, elle endosse, aussi, le rôle d’instrument démocratique (Giddens, 1992) qui impose aux partenaires, une communication émotionnelle authentique et paritaire (Moskovitz, 2001), synonyme d’honnêteté relationnelle (Imber, 2004). Notre présentation analysera cette ambiguïté dans les trois versions de Scenes from a Mariage (1973 – 2022), dans lesquelles l’injonction à la communication émotionnelle authentique prescrite par la culture thérapeutique se caractérise par le thème de l’analphabétisme émotionnel. À partir d’un décryptage sémiologique (Frau-meigs, 2012), notre analyse visera à problématiser l’analphabétisme émotionnel afin de souligner le caractère hétéroclite du langage amoureux. Une analyse comparative des représentations du dévoilement de soi permettra de souligner la nature ambivalente de la vérité subjective.
-
Communication orale
La poétique de l'incertitude dans les séries contemporaines: Netflix et "Moments in Love"Marta Boni (UdeM - Université de Montréal)
Cette présentation abordera les enjeux de la présence de moins en moins timide des représentations des relations queer au petit écran. L'étude du couple lesbien dans "Moments in Love", la saison 3 de Master Of None, adaptation libre de Scenes from a Marriage, sera au centre de la présentation et permettra de soulever des questions liés à une poétique de l'incertitude dans les séries contemporaines.
Réflexivité et attachement
-
Communication orale
C’est comme ça que je t’aime (2020) de François Létourneau : comment une chanson pop de 1974 devenue série transcende le thème de l’amour et séduit le publicAnnick Girard (Collège militaire royal de Saint-Jean)
C’est comme ça que je t’aime (2020) de François Létourneau tire son titre d’une chanson pop de 1974 du crooner Mike Brant. Si Létourneau explique avoir cherché une chanson qui parle d’amour pour représenter la quête amoureuse du personnage d’Huguette (Marilyn Castonguay), il a par ailleurs choisi un ver d’oreille dont la mélodie s’imprime dans la mémoire du spectateur. Plus précisément, à travers ce succès devenu chanson titre, une tension dialectique entre thème de l’amour et attachement du public à la série se développe au fil des épisodes : les paroles qui calquent grossièrement la poésie de Louise Labé (Je vis, je meurs…) canalisent la thématique, et la musique, aux « couleurs » d’une époque ravivée(s), contribue à séduire le spectateur. Ainsi, paroles et interprétation musicale sirupeuses, stéréotypées et répétitives, fétiches pour Adorno, sont exemplaires ici d’une dialectique caractéristique de la pop selon Gayraud, dialectique porteuse d’une promesse d’émancipation.
-
Communication orale
L’art perdu du faux souvenir télévisuelSylvain Lavallée (UdeM - Université de Montréal)
Cette présentation se propose d’utiliser le modèle de « The Lost Art of Forehead », un épisode particulièrement réflexif de la saison 11 de X-Files, diffusé en 2018, dans lequel Fox Mulder et Dana Scully rencontrent un mystérieux personnage, Reggie Something, pour penser cette question du lien amoureux que nous pouvons entretenir, comme spectateur·rice·s, à une série télévisée, et plus spécifiquement à ses personnages. N’est-il pas possible, en effet, de voir Reggie comme une projection d’un désir de vivre à l’intérieur d’X-Files, d’accompagner les personnages dans leurs enquêtes, et même de leur imaginer une conclusion alternative, comme le ferait un fan? Une idée qui trouve écho, aussi, dans une intrigue secondaire, lorsque Mulder recherche un épisode (imaginaire) de The Twilight Zone qu’il aurait vu, enfant, à la télévision, et qui l’aurait précipité vers ses obsessions envers le paranormal, ce qui renvoie à la manière qu’une œuvre audiovisuelle peut s’inscrire dans nos souvenirs. Pour réfléchir à ces enjeux, nous ferons appel à la philosophie de Stanley Cavell, plus spécifiquement à ses écrits sur le cinéma (l’épisode n’est pas sans évoquer cette phrase qui ouvre The World Viewed : « Movies are strand over strand with memories of my life »), et à l’ouvrage de Sandra Laugier Nos vies en séries, qui transpose la pensée de Cavell vers les séries télévisées.
-
Communication orale
« The End », ou Penny Dreadful à la recherche de l’immortalitéMeganne Rodriguez-Caouette (UdeM - Université de Montréal)
La fin de la série télévisée Penny Dreadful (Showtime, 2014-2016) a grandement déçu les fans. Cette fin, que certains et certaines jugent indigne sur les réseaux, pousse les fans à produire des fanfictions qui réparent ce qu’iels considèrent comme une erreur du dénouement.
Cette présentation se concentrera à expliquer que le geste de produire des fanfictions est poussé par un sentiment d’amitié virtuel, donc une forme d’amour, qui se développe entre les téléspectateurs et les téléspectatrices de la série télévisée Penny Dreadful et ses personnages. L’angle méthodologique de ce travail emprunte celui des fans studies, principalement à partir des travaux d’Henry Jenkins ([1992] 2013), de Jean-Pierre Esquenazi (2009) et de Kelley Brit (2021).
Cela se fera dans un premier temps par l’analyse de la réception de la finale de la série télévisée. La collecte de commentaires provenant de la plateforme Reddit et leur analyse me permettront d’aborder la relation qu’entretient le public avec l’idée du dénouement selon la conception de Florent Favard (2019) ainsi que la notion d’échec selon Judith/Jack Halberstam (2011). Ce concept et cette notion sont selon moi interreliés par la perception occidentale que le public développe envers les finales de séries télévisées. Et dans un deuxième temps, l’analyse de ce phénomène sera observée à travers la comparaison de deux fanfictions déjouant la fin de la série télévisée Penny Dreadful.