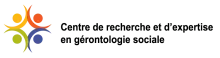Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le fait que le bien-être de nombreuses personnes aînées, dont les populations âgées marginalisées (PAM), repose sur une offre fragmentée de services et de soins qui s’avère fragile. Cette offre requiert davantage de ressources puisque les actions publiques ont une incidence primordiale sur l’exclusion sociale (Noël, 2002), notamment sur le bien-être des populations vivant en situation de précarité.
Cela dit, au-delà de ressources supplémentaires, l’offre de services nécessite aussi un meilleur arrimage entre les divers acteurs qui offrent du soutien à ces populations âgées marginalisées. Il s’avère dès lors nécessaire de bien saisir et agir sur les enjeux de coordination et de gouvernance auxquels font face ces populations dans leur accès aux services.
Ces enjeux comprennent la coordination entre le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et les différents paliers de gouvernement puisque les pourvoyeurs de services sont multiples et qu’il y a une forte segmentation entre prise en charge sanitaire et prise en charge sociale (Garabige et Trabut, 2017).
Ainsi, la gouvernance repose en grande partie sur le gouvernement provincial tandis que les municipalités ont été assujetties à des fusions et des transferts de responsabilités provenant des gouvernements provinciaux et fédéral depuis plusieurs années (Bradford, 2005; Joy et Vogel, 2015).
Comment développer des stratégies de coordination qui contribueront à mettre fin aux nombreuses frictions existantes entre les OBNL et le RSSS au Québec, et favoriseront des collaborations plus étroites entre les différents organismes et les paliers de gouvernement ? Comment s’attaquer à l’exclusion sociale à laquelle les personnes âgées marginalisées sont souvent confrontées en raison de la fragmentation actuelle des services disponibles ?
Répondre à ces questions contribuera au développement de pistes concrètes de solutions pour remédier à l’exclusion sociale des PAM et à un virage plus inclusif du vieillissement au Québec qui prend en compte l’hétérogénéité des personnes aînées et leurs besoins.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Patrik Marier (Université Concordia)
- Meghan Joy (Université Concordia)
Programme
Coordination des services auprès des personnes âgées marginalisées (première partie)
Première de deux sessions des communications du projet de recherche - Les actions gouvernementales au Québec : Impacts sur des personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d’exclusion sociale
-
Communication orale
Cadre théorique - la coordinations des actions publiques auprès des personnes âgées vivant des dynamiques d'exclusions socialesMeghan Joy (Université Concordia), Patrik Marier (Université Concordia), Sandra Smele (CREGES)
Présentation du cadre théorique du projet Les actions gouvernementales au Québec: Impacts sur les personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale. Le projet cible six populations âgées marginalisées: personnes aînées immigrantes, personnes de 50 ans et plus vivant avec un trouble mental grave, personnes aînées en situation d'itinérance ou qui ont vécu une épisode d'itinérance, personnes aînées judiciarisées, personnes aînées LGBT, et personnes aînées vivant dans des milieux ruraux et vivant des formes de précarisation socioéconomique.
-
Communication orale
Personnes âgées LGBTJulie Beauchamp (Université Laval), Sandra Smele (CREGÉS), Isabelle Wallach (UQAM)
Les personnes aînées LGBT font face à différentes formes de discrimination s’inscrivant dans des normes hétérosexistes, transphobes et âgistes, qui contribuent à accentuer leur exclusion sociale (Beauchamp et Chamberland, 2015). De plus, les personnes aînées LGBT au Canada sont plus à risque de se retrouver dans des situations d’isolement social avec l’avancée en âge (Beaulieu et al., 2018). Des études soulignent l’importance de considérer l’intersectionnalité, les différentes positions sociales des personnes aînées LGBT, et de reconnaitre les structures familiales non-traditionnelles (Wilson et al., 2018).
-
Communication orale
Personnes aînées précarisées vivant en contexte hors métropolitainPierre-Luc Lupien (Cégep de la Gaspésie et des Iles), Patrik Marier (Université Concordia)
Vieillir en contexte hors métropolitain peut signifier vivre diverses formes de précarités, notamment économique et résidentielle. C’est notamment le cas en Gaspésie, avec certains indicateurs de pauvreté atteignant jusqu’à dix points de pourcentage de plus que la moyenne québécoise (Statistique Canada, 2016). La précarité résidentielle, en particulier pour les personnes aînées gaspésiennes, est un phénomène connu et étudié (Lupien, 2019). Les difficultés d’accès et une offre inégale et limitée de services (santé et services sociaux, logements adaptés ou aide à l’entretien résidentiel, transport, etc.), peuvent entraîner des dynamiques d’exclusion et de marginalisation pour les personnes aînées.
Coordination des services auprès des personnes âgées marginalisées (deuxième partie)
Deuxième de deux sessions des communications du projet de recherche - Les actions gouvernementales au Québec : Impacts sur des personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d’exclusion sociale
-
Communication orale
Étude de la portée sur la coordination et la gouvernance des programmes et services de soutien et de soins auprès de six populations âgées marginaliséesJulie Beauchamp (Université Laval), Valérie Bourgeois-Guérin (UQAM), Meghan Joy (Université Concordia), Pierre-Luc Lupien (Cegép de la Gaspésie et des Îles), Patrik Marier (Université Concordia), Sandra Smele (CREGES), Tamara Sussman (Université McGill), Rym Zakaria (CREGES)
Étude de la portée dans le cadre du projet Les actions gouvernementales au Québec: Impacts sur les personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale. Analyse exhaustive des écrits scientifiques concernant six populations âgées marginalisées: personnes aînées immigrantes, personnes de 50 ans et plus vivant avec un trouble mental grave, personnes aînées en situation d'itinérance ou qui ont vécu une épisode d'itinérance, personnes aînées judiciarisées, personnes aînées LGBT, et personnes aînées vivant dans des milieux ruraux et vivant des formes de précarisation socioéconomique. Le premier tri, effectué par une bibliothécaire spécialisée en gérontologie sociale, a permis de soustraire 1931 articles scientifiques contenant un des mots clés en lien avec le projet. Le deuxième tri a été effectuée par les auteurs de la communication afin de cibler les contributions pertinentes en utilisant une grille d'extraction. Au final 182 articles ont été retenus. Un dernier tri analysant les éléments spécifiques à la coordination et à la gouvernance révèle 54 articles. La grande majorité des articles portant sur la coordination et la gouvernance discute des populations vivant dans des milieux ruraux (18/54) et celles vivant avec un trouble mental grave (18/54). Il y a une quasi-absence pour trois des six populations étudiées (itinérance, judiciarisée, LGBT).
-
Communication orale
Personnes aînées judiciariséesElsa Euvrard (Université Laval), Michel Gagnon (Maison Cross Roads)
Depuis une dizaine d’années, la population des personnes âgées sous contrôle judiciaire a augmenté d’environ 50%, et en 2018, elle représentait 25% de la population carcérale (Services Correctionnels du Canada, 2018). Les recherches postulent que l’augmentation des personnes âgées en établissement carcéral suivrait tout simplement la courbe du vieillissement de la population, en plus d’être liée à un changement dans les types d’infractions commises, et aux changements récents du système pénal, qui limite le recours aux peines alternatives à l’incarcération (Landreville, 2001).
-
Communication orale
Personnes aînées immigrantesShari Brotman (Université McGill), Jill Hanley (Université McGill), Julien Simard (Université McGill)
La population immigrante âgée est en forte croissance, la vaste majorité vivant au Québec depuis plusieurs années, voire des décennies (DRSP, 2017). La présence de personnes immigrantes exige une adaptation dans l’offre de services pour les personnes âgées, surtout à Montréal où elles représentent 44% de la population âgée (65+) et dont 14% ne parlent ni français ni anglais (Simard et Brotman, 2019). Elles sont relativement nombreuses à vivre avec des faibles revenus à la retraite (Grenier et al., 2019).