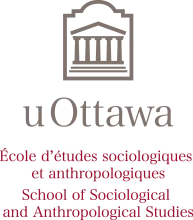Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Le concept de pouvoir d’agir ou empowerment vise principalement des groupes sociaux vulnérables du fait de leur minorisation, de leurs conditions d’existence ou de crises plus globales frappant leur société d’appartenance. Ce concept fait l’objet d’importantes critiques, la principale étant qu’il a été détourné de son objet initial de transformation radicale des structures de pouvoir inégalitaires « à partir du bas » (bottom up) pour en venir graduellement à associer le pouvoir d’agir aux choix individuels et économiques au détriment du pouvoir collectif (Calvès, 2009; Cornwall, 2016). Ceci a conduit un nombre croissant de structures (ONG, associations, structures gouvernementales ou privées, etc.), relayées par des chercheurs de différentes disciplines, à repenser leurs modalités d’action, et, ce faisant, à revisiter certains concepts souvent associés à celui de pouvoir d’agir, dont la signification a fini par devenir ambiguë : participation, vulnérabilité, solidarité, communauté, pour ne citer que ceux-là. L’intention sous-jacente à ces recherches engagées est de permettre la mise en place de dispositifs innovants ancrés dans une démarche collaborative et visant la justice sociale et épistémique. Pour autant, l’enjeu de la durabilité de ces derniers, faute d’une synergie efficace entre eux, reste entier et pose donc la question de leur crédibilité tant auprès des bénéficiaires que des pouvoirs publics censés s’en inspirer pour définir leurs politiques.
Le colloque abordera notamment les questions suivantes en mobilisant des études de cas variées dans leurs contextes et champs disciplinaires : Quels sont les rapports de domination sous-jacents à la mise en œuvre des approches participatives et collaboratives ? Quels sont les enjeux éthiques soulevés par les initiatives s’appuyant sur ces approches ? En quoi l’analyse des trajectoires individuelles permet-elle de mieux comprendre les cheminements vers l’acquisition d’un pouvoir d’agir, les processus d’autonomisation ?
Remerciements :Nous tenons à remercier le réseau international "Recherche avec" pour son implication dans la conception de ce colloque et la diffusion de l'appel sur sa plateforme. Nous soulignons la participation active dans l'élaboration des activités du colloque de l'association la Forge (Bordeaux, France) qui a agi comme source d'inspiration significative dans la réflexion sur l'accompagnement social.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Nathalie Mondain (Université d’Ottawa)
- Marie-Hélène Doublet (CIBC Sud Aquitaine Organisme privé)
Programme
Par quels processus se développe le pouvoir d’agir : analyses comparées internationales de dispositifs de recherche et d’accompagnement social
Ce colloque se déroulera en deux temps durant la matinée:
1) Dans une première partie, à travers une série de communications, nous examinerons différents dispositifs ayant pour objectif de favoriser le pouvoir d'agir au sein de groupes sociaux et dans des contextes variés (y compris internationaux), professionnels et disciplinaires. Les communications seront articulées autour des questions suivantes en particulier mais non exclusivement: Quelles sont les manifestions des rapports de domination lorsque des approches participatives et collaboratives sont mises de l'avant? Quelles sont ces pratiques et quels effets ont-elles sur les bénéficiaires? Quels sont les enjeux éthiques soulevés par ces initiatives ?
2) Une table ronde de clôture réunira des représentant.es des mondes de la recherche et de l'intervention autour des trois points suivants: (i) Comment le concept du pouvoir d’agir a-t-il émergé? Comment le définir? Quels sont les principaux enjeux que soulèvent la mobilisation de ce concept dans l’intervention? (ii) Comment le pouvoir d’agir est il activé dans différents contextes et selon différents publics visés? (iii) En quoi ces approches remettent elles en question les dispositifs existant?
-
Communication orale
L’entretien d’auto-confrontation à l’activité en stage : un outil de justice sociale favorisant l’inclusion socioprofessionnelle des jeunes avec troubles du fonctionnement cognitifAntoine Agraz (Université de Limoges)
La question de l’inclusion socioprofessionnelle en contexte de stage pour des jeunes avec troubles des fonctions cognitives constitue l’un de nos objets de recherche. En 2016, nous avons examiné les représentations du tutorat de stage chez des jeunes scolarisés en Institut Médico-Éducatif à travers des entretiens semi-directifs (Agraz, 2016). Nous avons poursuivi ces investigations en examinant les conduites des tuteurs auprès de ce même public à travers des observations filmées (Agraz, 2020a). Ces recherches ont mis en exergue une tension existante dans les stages que réalisent ces jeunes dans le cadre de leur parcours de formation : la tension entre « logique de production » et « logique d’apprentissage » (Agraz, 2020b). Ces deux logiques peuvent être pensées selon l’environnement dans lequel ces jeunes agissent et « enquêtent » (Dewey, 1967, p.101) en situation de travail, à savoir un environnement où il existe une continuité entre les dimensions biologique (mobilisation du corps) et culturelle (réflexivité). Si nos travaux de recherche ont davantage insisté sur la dimension biologique, nous souhaiterions développer, dans cette communication, la dimension culturelle, à travers la présentation d’un nouvel outil d’exploration d’une réflexivité au travail. En effet, l’entretien d’auto-confrontation (Thiévenaz, 2019) fait naître des enjeux culturels importants au regard de la spécificité du public concerné, et ce autour de la question d’un langage du dire sur le faire.
-
Communication orale
Les rendez-vous manqués d’un dispositif d’éducation à l’entrepreneuriatHénaba Loïs Silas Amangoua (Université de Limoges)
Depuis 2018, l’association Francophonie Sans Frontières en partenariat avec l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo en Côte d’Ivoire, a mis en place un projet de sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat social et solidaire. Ce projet a pour objectif de susciter la prise d’initiative et l’engagement social de ces derniers. Il s’inscrit dans une vision plus globale de développement du pouvoir d’agir.
Premièrement construit autour d’une formation à la rédaction de projet collaboratif, puis une participation au concours entrepreneurial organisé lors de la Conférence Internationale sur l'Économie Sociale et le Co-Développement Durable Inclusif (CIESDI) en 2019. Il s’agit de créer un dispositif d’accompagnement de projets entrepreneurials, étudiants au sein de l’université, lieu d’échange et d’expérimentation sociale. Trois années après la CIESDI de 2019, ce dispositif est quasi inexistant, ce n’est pas faute d’avoir essayé plusieurs fonctionnements. L’étude longitudinale menée auprès des acteurs par la méthodologie ancrée fait émerger des écarts entre les attentes des étudiants et ceux des acteurs de l’association.
Nous analysons dans notre communication ces rendez-vous manqués pour proposer une prospective de dispositif capable de développer du pouvoir d’agir. Les données biographiques de notre recherche offrent l’occasion d’analyser les récits vies marqueurs d’appropriation des parcours et important dans le développement de ce pouvoir d’agir. -
Communication orale
La Forge des compétences: de l' "aller vers" à l'intelligence collectiveMarylene Costa (AXE ET CIBLE Forge des compétences)
Cette communication portera sur un programme social mis en place à Bordeaux, la Forge des compétences. Visant à capter les individus ne fréquentant pas les services d'aide officiels municipaux et gouvernementaux malgré leurs besoins, ce programme, en mobilisant les concepts d' "aller vers" et de résolution collective des problèmes présentés, contribue à redéfinir la notion de pouvoir d'agir. Ce faisant, il ouvre à une réflexion plus large sur la nécessité de repenser les démarches conventionnelles d'aide à l'insertion sociale et économique d'un public extrêmement hétérogène du fait de la grande diversité des parcours individuels (professionnels, familiaux, migratoires, socio-éducatifs, etc.).
-
Communication orale
Le pouvoir d’agir des personnes immigrantes au marché du travailRoxana Merello (Service Intégration Travail Outaouais (SITO))
Le Service Intégration Travail Outaouais (SITO) intègre des personnes immigrantes à la société québécoise par leur insertion en emploi et leur intégration économique. Quatre axes composent notre approche et pratiques.
1) L’acquisition et/ou le développement de huit aptitudes vers l’emploi auprès des personnes immigrantes leur permet de décortiquer les aptitudes priorisées dans la culture d’entreprise québécoise, d’établir des parallèles entre leur culture et la culture d’accueil et avoir la capacité de devenir plus autonomes dans leur intégration au marché du travail.
2) La préparation des personnes immigrantes sur les attentes des employeurs et la culture d’entreprise québécoise, leur donner la possibilité de mieux comprendre ce qu’il est à faire et ce qu’il est à éviter. La connaissance d’une langue (en l’occurrence le français) n’est pas une garantie de l’aptitude à communiquer pour une personne immigrante.
3) La sensibilisation et l’accompagnement auprès des employeurs facilitent l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail. La capacité d’agir d’une personne immigrante peut-être limitée si l’employeur n’a pas été sensibilisé et accompagné dans l’intégration des personnes immigrantes en entreprise.
4) La mobilisation des employeurs, partenaires, élus et société d’accueil à la valeur ajoutée de la main-d’oeuvre immigrante. Cette mobilisation contribue à la capacité d’agir des personnes immigrantes. -
Communication orale
NOUVELLES COOPERATIONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MINEUR.E.S NON ACCOMPAGNÉ.ESPierre Lebret (Futur Au Présent International)
En 2020, l’association franco-sénégalaise Futur Au Présent a créé le programme Passer’Aile afin de contribuer à un meilleur accompagnement des mineur.e.s non accompagné.e.s par le biais d’échanges de pratiques entre travailleur.s.es sociaux.les d’Afrique de l’Ouest au sein de structure d’accueil en France, en Espagne et en Italie. Cette démarche soulève certains questionnements. Les coopérations entre acteurs du Sud et du Nord ouvrent-elles un processus d'hybridation des pratiques dans le domaine de l'accompagnement social des jeunes mineur.e.s ? Cette hybridation est-elle une clé pour mieux saisir l'expérience migratoire des jeunes et renforcer le pouvoir d'agir des acteurs sociaux concernés, dans les pays d'arrivée comme dans les pays de départ ? Comment se construit cette hybridation ? Mais aussi : quel est l'impact d'un tel projet sur le parcours et la vie des MNA ? Permet-il de contribuer à leur autonomisation et à favoriser leur inclusion ? Contribue-t-il à une meilleure réalisation des objectifs qui les ont poussés à émigrer et à une meilleure capacité de s'accomplir en termes personnels et professionnels ?
-
Communication orale
Pouvoir d’agir et retournement de regard. Une analyse critique du Théâtre forum-CNV en recherche participativeSophie Lewandowski (Institut de recherche pour le développement)
Les travaux pionnier sur l’empowerment comme ceux de Paolo Freire et d’Orlando Fals Borda sont souvent interprétés de manière partielle par les dispositifs de recherche et d’accompagnement social. Ils proposent, en effet, aux groupes défavorisés de travailler sur leur pouvoir de se penser, de se dire et d’agir, mais omettent de proposer aux classes majoritaires ou puissantes de revisiter leurs propres postures. Pourtant, la volonté et la « cécité des dominants » qu’évoque José Médina constituent la frontière à laquelle se heurte in fine le pouvoir d’agir des dominés.
Dans trois projets de recherche-action en Amérique du Sud et en Méditerranée, nous avons suggéré un retournement de regard aux catégories sociales favorisées présentes sur les territoires, ainsi qu’aux concepteurs même des projets. Nous leur avons proposé qu’ils expérimente le théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal avant ou en parallèle du même processus réalisé avec les autres catégories sociales. Nous avons ensuite associé au Théâtre forum (TF) la Communication NonViolente (CNV) de Marshall B. Rosenberg qui invite à un retournement de regard plus poussé. Dans les deux cas (TF ou TF-CNV), nous nous sommes heurtés à certains moments à des stratégies de dénis, d’évitement et de blocage qui nous ont permis de dégager neufs points de vigilance sans lesquels ce type d’expérimentations peuvent contribuer à reproduire et non à transformer les systèmes d’iniquité existants