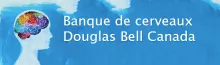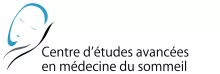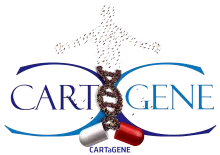Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 100 - Sciences de la santé
Description :Le besoin de développer, utiliser et valoriser les biobanques en santé mentale.
La matinée sera consacrée à des présentations de biobanques/banques de données de differents types et l'après-midi par des présentations de retombées et/ou discussion de problématiques de biobanques en santé mentale.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Robert-Paul Juster (UdeM - Université de Montréal)
- Samir Taga (Centre de recherche de l'institut de santé mentale de Montréal)
- Cecile Le Page (centre de recherche)
Programme
Diversité des biobanques en Santé Mentale
-
Communication orale
La Biobanque SignatureStéphane Guay (Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal), Robert-Paul Juster (Université de Montreal), Philippe Kerr (UdeM - Université de Montréal)
En 2012, la Biobanque Signature a été créée par un groupe de chercheuses et chercheurs transdisciplinaires en santé mentale à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. L’objectif initial de la Biobanque Signature était d’étudier les Signatures biologiques, psychologiques, et sociales des troubles de santé mentale afin de d’identifier les meilleures pratiques de recherche et d’intervention clinique dans les services d’urgence en psychiatrie.
À ce jour, la Biobanque Signature rassemble des biospécimens, ainsi que des données médicales, cliniques, et sociodémographiques de patients vus à l’urgence psychiatrique (n=2086), à leur congé d’hôpital (n=666), à leur premier rendez-vous en clinique externe (n=599), et 12 mois plus tard (n=370). À cela s’ajoute un groupe contrôle (n=149), qui est composé de personnes en santé, de la région de l’Est de Montréal, et qui sont appariées pour l’âge et le sexe des participants de la cohorte de la Biobanque Signature.
Cette présentation d’ouverture sert à présenter le contexte dans lequel le projet de Biobanque Signature a été créé, ainsi que de décrire la cohorte de participants à un niveau sociodémographique. Les avancées de la Biobanque Signature seront présentées, puis les avenues futures de la Biobanque seront discutées. La Biobanque Signature est en pleine effervescence, et représente une opportunité unique en son genre, à l’échelle mondiale, pour propulser les découvertes en neurosciences et en santé mentale.
-
Communication orale
La Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada (BCDBC)Naguib Mechawar (Université McGill)
La Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada (BCDBC), établie à l’Institut Douglas depuis 1980, est devenue une ressource inestimable pour la recherche sur le cerveau humain au Québec, dans le reste du Canada et à l’international. Avec plus de 3,600 cerveaux bien caractérisés en banque, il s’agit d’une des banques de cerveaux les plus importantes au monde. La BCDBC comporte deux volets, soit le volet Vieillissement et maladies neurodégénératives et le volet Maladies psychiatriques et suicide. Cette présentation offrira un survol des opérations à la BCDBC, du don de cerveau à la distribution d’échantillons pour la recherche. Il sera aussi question de quelques percées récentes réalisées dans le domaine de la psychiatrie moléculaire grâce aux tissus cérébraux conservés, caractérisés et préparés par la BCDBC.
-
Communication orale
CARTaGENE, une ressource publique pour la recherche en santé.Catherine Labbé (CARTaGENE - CHU Sainte-Justine)
À la fois biobanque et cohorte populationnelle du Québec, CARTaGENE (CaG) (https://cartagene.qc.ca/) constitue une ressource publique unique avec 43 000 participants représentatifs de la population âgée de 40 à 69 et suivis prospectivement. L’ensemble des données est accessible à la communauté scientifique pour accélérer la recherche en santé.
Le recrutement a été réalisé en deux phases (A : 2009-2010 et B : 2013-2014). Les données collectées regroupent des questionnaires de santé, mesures physiques, nutrition, environnement et habitudes de vie. Des échantillons biologiques permettent de générer des profils biochimiques et génétiques. De plus, les données des participants sont appariées à d’autres bases de données (généalogique (Balsac), environnementale (CANUE), etc.). Les données médico-administratives des participants y sont aussi jumelées et mises à jour annuellement. Des projets spécifiques enrichissent aussi CARTaGENE en fournissant de nouvelles données (IRMs cœurs et cerveaux, données COVID-19 (sérologie et questionnaires), etc.).
CARTaGENE est une cohorte populationnelle, mais les maladies communes y sont bien représentées. Environ 10 000 participants ont déclaré une condition de santé mentale au recrutement, variant de la dépression (n=9199), syndrome du trouble bipolaire (n=484), anxiété (n=1570), schizophrénie (n=98), troubles alimentaires (n=164), troubles addictifs (n=296), troubles obsessionnels compulsifs et troubles du spectre de l’autisme (n=8).
-
Communication orale
La Biobanque Canadienne pour la Recherche sur le SommeilAndrée-Ann Baril (CIUSSS-NIM), Marie-Josée Quinn (CIUSSS-NÎM - HSCM), Marie-Josée Quinn (CIUSSS-NIM)
La Biobanque Canadienne pour la Recherche sur le Sommeil située au Centre d’Études Avancées en Médecine du Sommeil (CÉAMS) regroupe environ 4000 participants ayant une évaluation de leur sommeil. Plusieurs participants ont été diagnostiqués avec un trouble tel que l’insomnie, l’hypersomnie, la narcolepsie, le somnambulisme, l’apnée, ou le trouble comportemental en sommeil paradoxal. La Biobanque inclut aussi certaines populations chez qui le sommeil est souvent affecté, par exemple les personnes âgées ou celles avec une maladie neurodégénérative. Elle contient des échantillons et données issus de projets de recherche québécois, canadiens et européens. Le laboratoire de la Biobanque regroupe différents types d’échantillons, principalement sanguins, mais aussi urinaires, salivaires, ainsi que du liquide céphalo rachidien. Une équipe multidisciplinaire est impliquée dans le développement et le fonctionnement de la Biobanque, ainsi que dans la gestion de ses besoins administratifs, de gouvernance, informatiques et techniques. La Biobanque joue un rôle primordial et facilite la recherche génétique et de biomarqueurs en médecine du sommeil. Elle s'inscrit également dans une mission de science ouverte aux chercheurs intéressés par le sommeil. La Biobanque permet de faire des avancées considérables dans le développement de nouveaux tests ainsi que dans la découverte de mécanismes sous-jacents en médecine du sommeil via l'étude de marqueurs inflammatoires ou de protéines spécifiques.
-
Communication orale
Clinical, Biological, Imaging and Genetic Repository C-BIGR : Une biobanque neurologique au sein de la Science OuverteMarie-Noëlle Boivin (marie-noelle.boivin@mcgill.ca), Nicolas Ferry (Université McGill), Jason Karamchandani (Montreal Neurological Institute), Kevin Lafleur (Montreal Neurological institute), Peng Wang (Montreal Neurological Institute)
Objectifs: Dans un contexte de Science Ouverte, la biobanque C-BIG vise à accélérer la recherche en neurosciences tout en protégeant les patients, leurs échantillons et leurs données personnelles.
Conception & Méthodes : La biobanque C-BIG de l’Institut Neurologique de Montréal a été créée pour être une collection d'échantillons biologiques, d'informations cliniques, d'imagerie et de données génétiques provenant de patients atteints de maladies neurologiques ainsi que de sujets témoins sains. Le matériel et les données sont accessibles à tous les chercheurs via une base de données en ligne et ceux-ci sont encouragés à renvoyer les résultats de recherche à la biobanque.
Résultats: Jusqu’à aujourd’hui, plus de 45 collaborations ont été effectuées avec des laboratoires et des industries à travers le monde.
Conclusions : C-BIG améliore et facilite la collecte de spécimens et de données et fonctionne selon les principes de la science ouverte ; la réglementation et la protection de toutes les informations et du matériel des donateurs. L'objectif à long terme est de développer une collection complète de données et d'échantillons sur un large spectre d’atteintes neurologiques, contribuant ainsi à la recherche mondiale translationnelle en neurosciences en augmentant la collaboration avec toute la communauté scientifique et en améliorant la transparence et la fiabilité.
-
Communication orale
Harmonisation de données: défis et opportunitésJulie Bergeron (Institut de recherche du CUSM), Isabel Fortier (Maelstrom)
La qualité et l'étendue des données et des échantillons collectés par les études épidémiologiques offrent des opportunités inestimables pour faire progresser les connaissances. Cependant, les études individuelles n'ont souvent pas la puissance statistique nécessaires pour enquêter sur des maladies relativement rares et explorer comment l'environnement et le mode de vie interagissent avec les facteurs génétiques. La quête d'échantillons, le besoin de comparaisons valides entre les études et la nécessité d'utiliser de manière optimale les données disponibles ont conduit à un intérêt croissant pour la co-analyse des données entre les études. Cependant, en raison de la complexité et de l'hétérogénéité des informations collectées, les modèles de gouvernance, des procédures d'accès, des défis méthodologiques majeurs doivent être relevés afin d'harmoniser les données et de permettre ainsi la comparaison et/ou l'intégration des informations entre les études. Les programmes de recherche collaborative nécessitent donc l'utilisation d'approches méthodologiques rigoureuses, une infrastructure bien organisée, une expertise, des méthodes et des logiciels spécialisés. Ainsi, des experts de divers domaines unissent leurs efforts pour développer ces ressources, avec pour objectif de promouvoir et soutenir une utilisation optimale des données existantes, des résultats plus fiables, une capacité accrue de recherche collaborative et interdisciplinaire et des perspectives de recherche élargies.
-
Communication orale
Utiliser les données longitudinales de cohortes de naissance génétiquement informées pour comprendre l'étiologie des pensées et comportements suicidaires chez les jeunesMassimiliano Orri (Université McGill)
Les pensées et les comportements suicidaires chez les jeunes sont des problèmes de santé publique importants et leur prévention est impérative. Les problèmes comportementaux et émotionnels à l'enfance ont été identifiés comme des facteurs de risque. Une meilleure compréhension de leur apparition et de leur évolution au cours du développement pourrait permettre d'améliorer les interventions visant à réduire le risque de suicide à long terme. La cohorte de L'Étude Longitudinale du Développement des Enfants du Québec et de l'Étude des Jumeaux Nouveau-nés du Québec est utilisée pour étudier le rôle des problèmes comportementaux et émotionnels dans l'étiologie des pensées et des comportements suicidaires à l'adolescence. Ces cohortes suivent, respectivement, 2120 et 1324 enfants de la naissance à l'âge de 23 ans avec des évaluations comportementales et émotionnelles. Des données pangénomiques ont aussi permis le calcul de scores polygéniques pour une série de traits. Grâce à ces informations, nous avons pu décrire le développement des problèmes émotionnels et comportementaux, leur interaction dans la prédiction des pensées et des comportements suicidaires, et mieux comprendre le rôle de la vulnérabilité génétique sous-jacente. L'aperçu de nos résultats illustrera le potentiel et les possibilités uniques qu'offrent les cohortes longitudinales et génétiquement informées pour mieux comprendre l'étiologie des pensées et des comportements suicidaires des jeunes.
Bon appétit
Retombées scientifiques
-
Communication orale
Les expériences de maltraitance vécue à l’enfance, le sexe et le cortisol jouent-ils un rôle dans l’évolution des symptômes dépressifs et anxieux chez les adultes hospitalisés en mChristina Y. Cantave (University of Groningen), Consortium Signature (CRIUSMM)
Contexte : On remarque souvent la présence de symptômes de dépression et d'anxiété chez les populations cliniques, surtout chez les femmes et les personnes maltraitées. Pourtant, rares sont les études ayant examiné l’existence de trajectoires de symptomatologie au sein de ces populations ainsi que leurs associations avec les expériences de maltraitance durant l'enfance, le sexe à la naissance et l’activité du système physiologique du stress indexé par la sécrétion du cortisol. Objectif : Cette étude a pour but d’identifier des trajectoires de dépression et d'anxiété dans un échantillon de patients hospitalisés en milieu psychiatrique (N=402, 55% de femmes) suivi prospectivement et d’examiner si le cortisol, la maltraitance à l'enfance et le sexe prédisent indépendamment et conjointement ces trajectoires. Résultats: Trois trajectoires ont été identifiées pour les symptômes de dépression et d'anxiété. Chez les hommes, un taux de cortisol élevé prédit une probabilité accrue de présenter des symptômes dépressifs chroniques. De plus, des expériences de maltraitance accrue durant l'enfance prédit chez les hommes des chances plus élevées de présenter des symptômes anxieux chroniques par rapport aux trajectoires Faible et stable et Élevé et décroissant. Des résultats opposés ont été observés chez les femmes. Conclusion : Cette étude suggère que l’impact de la maltraitance vécue à l’enfance et du cortisol sur l’évolution des symptômes dépressifs et anxieux varie en fonction du sexe
-
Communication orale
Entreposage à long terme et stabilité des échantillons : un enjeu central pour les biobanquesEnzo Cipriani (UdeM - Université de Montréal), Robert-Paul Juster (université de montreal), Consortium Signature (CRIUSMM)
L’utilisation de l’analyse de tissus biologiques a gagné en popularité ces dernières années en recherche sur la santé mentale. L’entreposage de tissus humains en biobanque est une approche permettant de répondre à cette demande croissante, particulièrement dans des domaines comme la psychoneuroimmunologie, ou la santé mentale, ou l'acces a des participant.e.s est difficile. L'étude de la neuropsychologie ou de la santé mentale nécessitent des mesures de biomarqueurs humains, tels que marqueurs immunitaires, ou de stress comme la charge allostatique. Ces domaines ont vu une croissance exponentielle des publications sur le sujet depuis leur émergence.
La biobanque Signature permet d’accéder à des données de multiples patients en état de crise lors de leur visite aux urgences psychiatriques, contexte particulièrement difficile à mesurer et offrant une compréhension profonde des troubles étudiés.
Bien que la conservation des échantillons peut avoir une influence sur la qualité des données obtenues, surtout la conservation à long terme, il existe un manque criant de données en conditions réelles. Concernant la stabilité des cytokines congelées, par exemple, une revue de la littérature récente permet de relever une absence de données sur des échantillons entreposés depuis plus de 4 ans.
Le contrôle de qualité pour les biobanques est un enjeu important pour garantir la qualité et l’intégrité des échantillons utilisés ainsi que l’excellence de la recherche en découlant.
-
Communication orale
La charge allostatique comme outil en psychiatrie biologiqueRobert-Paul Juster (UdeM - Université de Montréal), Consortium Signature (CRIUSMM)
La charge allostatique (CA) est « l'usure » mesurable du stress chronique. Nous proposons que l'indexation CA représente une voie prometteuse pour identifier les processus physiopathologiques discrets en psychiatrie biologique. Dans cette présentation, nous fournirons une revue sélective de la littérature CA existante liée spécifiquement aux symptômes psychiatriques. Le modèle CA a été principalement appliqué pour détecter les morbidités physiques et la mortalité dans les analyses épidémiologiques. Bien que prometteur, il a été difficile de l'appliquer à des analyses plus individuelles pertinentes pour comprendre les phénomènes psychiatriques complexes. De plus, la physiopathologie liée au stress entraîne des trajectoires comorbides qui échappent à une prédiction précise. Ceci est particulièrement important dans le contexte de maladies mentales graves comme la schizophrénie, le trouble bipolaire et les troubles de l'humeur qui sont souvent caractérisés par des commodités et multimorbidité secondaires à un diagnostic psychiatrique. En interprétant différemment les biomarqueurs périphériques, on peut calculer un indice AL simple, connu pour prédire diverses pathologies liées au stress. En plus du dépistage des comorbidités, les indices CA peuvent être utilisés pour surveiller les effets des interventions pharmacologiques et psychosociales. Les innovations récentes utilisant la Biobanque Signature seront également discutées ainsi que les orientations futures.
-
Communication orale
Changements neurovasculaires spécifiques au sexe dans la réponse au stress et la dépression : le rôle de la barrière hémato-encéphaliqueLaurence Dion-Albert (Université Laval), Caroline Menard (CERVO)
Le trouble dépressif majeur (TDM) est la principale cause d'invalidité dans le monde et les femmes sont environ deux fois plus touchées que les hommes. Malgré les différences cliniques importantes connues entre les sexes quant à la symptomatologie et aux comorbidités associées, la majorité des études précliniques en santé mentale sont menées chez les sujets mâles. À ce jour, 30 à 50% des patients sont résistants aux traitements antidépresseurs disponibles sur le marché, suggérant que les traitements traditionnels centrés sur les neurones n’adressent pas tous les mécanismes biologiques impliqués dans la dépression. Nous avons récemment démontré que le stress social chronique chez les souris ainsi que le TDM chez l’humain induisent une perte d’intégrité de la barrière hémato-encéphalique (BHE) dans des régions cérébrales différentes selon le sexe. Ces résultats révèlent des altérations neurovasculaires spécifiques au sexe et pourraient expliquer pourquoi les hommes et les femmes déprimées rapportent des symptômes différents. L’analyse de marqueurs sanguins a permis de révéler de nouveaux marqueurs liés à l’intégrité de la BHE. En somme, il est impératif de considérer les différences sexuelles comme variable pour développer des stratégies thérapeutiques innovantes et adaptées pour le traitement du TDM.
-
Communication orale
Conduites suicidaires, problèmes de santé chronique et autres facteurs associés chez des patients admis en urgence psychiatrique : étude corrélationnelle et psychométriqueCamille Brousseau-Paradis (Université de Montréal), Charles-Edouard Giguere (centre de recherche de lIUSMM), Caroline Larue (Université de Montreal), Alain Lesage (Institut Universitaire de santé Mentale de Montreal), Jessica Rassy (UdeS - Université de Sherbrooke)
Les personnes qui souffrent d’un trouble de l'humeur présentent souvent un risque suicidaire élevé. Pour bien répondre à leurs besoins, les services d'urgence sont des acteurs incontournables dans la gestion de ce risque. Cette étude vise à (1) décrire les pensées et comportements suicidaires des patients souffrant de troubles de l'humeur qui se présentent aux urgences psychiatriques; (2) déterminer les meilleurs prédicteurs de suicidalité pour ces patients ; (3) évaluer les propriétés psychométriques du Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R). La suicidalité a été évaluée à l'aide du SBQ-R chez 300 participants de la Biobanque Signature. 53,3% de l'échantillon a déclaré avoir eu des pensées suicidaires ou d'automutilation au cours des deux dernières semaines. Une analyse multivariée a révélé que les scores au SBQ-R étaient associés aux symptômes dépressifs et à la consommation (44,3% de la variance du modèle). L'Alpha de Cronbach était de 0,81 et les charges factorielles étaient de 0,54-0,88. L'analyse factorielle confirmatoire a indiqué que le modèle s'adaptait bien aux données. Il en ressort que le SBQ-R est un instrument bref et valide qui peut facilement être utilisé dans des services d'urgence pour évaluer le risque de suicide. Les symptômes dépressifs et la consommation d'alcool doivent également être évalués, car ils sont des déterminants du risque accru de suicidalité.
-
Communication orale
Neurodégénération et Biomarqueurs sériques : Analyses de la Biobanque SignatureSimon Ducharme (Université McGill)
La démence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative causant une démence précoce chez les adultes entre 40 et 75 ans. La variante comportementale de la maladie se manifeste intialement par des changements de personnalités et de comportements qui ressemblent ceux de plusieurs troubles psychiatriques primaires tels que la dépression, les troubles psychotiques et l'autisme. Étant donné les limites des biomarqueurs diagnostics actuels, les patients souffrant de DFT reçoive souvent un diagnostic erronné et plusieurs années peuvent s'écouler avant que le bon diagnostic soit identifié. Les chaines légères de neurofilaments (NfL) sont un biomarqueurs sanguins d'atteinte axonale qui est élevé dans les maladies neurodégénératives. Quelques études ont suggéré que la valeur des NfL permet de différencier les troubles psychiatriques primaire de la DFT. Grâce aux données de la Biobanque Signature, nous avons complété la plus grande étude contrastant les NfL entre les patients souffrant de troubles psychiatriques et ceux avec DFT. Nous présenterons les résultats et discuterons du potentiel d'applicabilité clinique.
-
Communication orale
Biomarqueurs pour dépister le trouble bipolaire : des banques biologiques à l’innovation en santé mentaleRaoul Belzeaux (Faculté de médecine, Université de Montpellier)
Le trouble bipolaire est une pathologie fréquente qui souffre d’un retard diagnostique fréquent et long de plusieurs années. Très souvent, les patients reçoivent par erreur un diagnostic de trouble dépressif majeur et bénéficient de traitements antidépresseurs qui aggravent le pronostic du trouble bipolaire. A partir de banques biologiques du CHU de Montpellier et de Marseille, nous avons développé une combinaison de biomarqueurs, basée sur des dosages de cytokines, qui permet de différencier efficacement les troubles bipolaires des troubles dépressifs majeurs. A l’occasion de cette communication, le développement de cette découverte brevetée et son développement dans le but d’être mis sur le marché seront détaillés.
Réseautage en biobanque et santé mentale
Les conférenciers et conférencieres sont invité.e.s a une table ronde pour discuter des enjeux de l'avenir des biobanques en santé mentale et développer des stratégies d'échange.