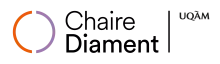Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 100 - Sciences de la santé
Description :Apparu en Scandinavie dans le domaine de l’informatique à partir des années 1970, le design participatif est une approche méthodologique qui consiste à impliquer les utilisateurs finaux d’une technologie dans la conception de celle-ci, à l’aide de diverses activités collaboratives. Bien que les termes design participatif et codesign sont souvent employés comme des synonymes, le terme codesign désigne une approche distinctive de design participatif ancrée dans les disciplines du design centré-humain et impliquant des experts en design. D’après Sanders et Stappers (2008), le codesign est « la créativité des designers et des personnes n’ayant pas reçu de formation en design qui travaillent ensemble dans le processus de conception ». C’est un processus créatif collectif au sein duquel l’usager n’est pas un sujet d’étude, mais un partenaire de conception à part entière. Selon Manzini (2015), le codesign se manifeste sous la forme d’une conversation sociale à multiples facettes dans lequel le « design diffus » rencontre le « design expert ». Reconnu pour augmenter le pouvoir d’agir des individus et des communautés, le codesign est au cœur des approches d’innovation sociale par le design (Manzini, 2015), d’innovation publique (Bason, 2012) et de design social en général (Tromp et Vial, 2022).
En santé numérique, le codesign est encore peu pratiqué (Birnbaum et al., 2015) et, en santé mentale numérique, il est rare et largement sous-exploité (Torous et al., 2018), tout comme les approches de design centré-humain en général (Vial et al., 2022). Des travaux récents soulignent pourtant que le codesign repose sur un processus hautement communicationnel favorisant la multiplicité des points de vue et l’expression de valeurs (Grosjean, 2022), ce qui peut permettre de réduire le risque de découplage entre les utilisateurs imaginés et les utilisateurs réels d’une technologie (Assogba et al., 2015). Le codesign apparaît ainsi comme une solution possible au grand défi de l’engagement des utilisateurs, car, même valide ou validée, si une technologie numérique de santé n’est pas utilisée, elle n’est pas utile.
Suivant une perspective transdisciplinaire ouverte sur les disciplines du design, la recherche en santé, les sciences de la communication et les sciences sociales, l’objectif de ce colloque est de permettre aux participants de mieux comprendre la nature et le potentiel du codesign pour améliorer la qualité et l’adoption des technologies numériques de santé, et d’être mieux outillés pour passer à l’action et intégrer concrètement une approche de codesign dans un projet d’innovation numérique en santé.
Remerciements :Nous remercions le Centre Axel pour son accompagnement dans l'organisation et la conduite des ateliers d'inspiration.
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Stéphane Vial (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Mathieu Dumont (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
- Mélanie Tremblay (ENAP - École nationale d'administration publique)
- Sana Boudhraâ (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Alexandra Ferland (CRIUSMM, Centre Axel)
Programme
Ouverture
Conférence d’honneur
-
Communication orale
Le codesign dans l’innovation responsable en santé : tensions et synergies créativesPascale Lehoux (UdeM - Université de Montréal)
Est-il possible de concevoir des solutions efficaces et sécuritaires et qui en même temps renforcent l’équité et la pérennité des systèmes de santé, apportent plus de valeur au plus grand nombre d’utilisateurs en utilisant moins de ressources et en étant moins dommageables pour l’environnement et économiquement viables? La réponse de l’Innovation Responsable en Santé (IRS) est ‘oui, bien sûr!’ Mais ceci demande aux collectifs impliqués dans l’innovation de savoir résoudre d’une manière créative des tensions importantes entre différents attributs de responsabilité, allant de la réduction des inégalités de santé à la frugalité logicielle aussi bien que matérielle, en passant par une analyse du niveau et de l’intensité des soins requis par différentes solutions numériques.
Dans cette conférence, des concepts clés seront définis et illustrés à l’aide d’exemples afin de cerner comment le codesign peut permettre d’explorer ‘l’espace’ du problème et celui de la solution. Je soulignerai que bien que le but soit collaboratif et sensible aux expériences du terrain, l’expertise propre à la discipline du design ne doit pas céder entièrement sa place. Je poserai donc l’un des débats que ce Colloque vise à susciter. Au-delà d’un arbitrage pragmatique entre différentes priorités, la force du design est de pouvoir envisager des synergies là où d’autres ne voient que des oppositions. Je ferai ici un léger détour sociologique pour que l’héritage de Bruno Latour éclaire nos réflexions.
Session thématique 1
-
Communication orale
Co-construire l’accessibilité des appels d’urgence entre aphasiques et agents de centre d’appels vidéo d’urgenceSophie Dalle-Nazebi (Télécom Paris), Jean-Dominique Journet (Fédération Nationale des Aphasiques de France), Marc Relieu (Telecom Paris), Nicolas Rollet (Telecom Paris)
L'aphasie est une difficulté de communication, qui touche la compréhension et l'expression du langage, et qui est généralement causée par un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. Bien qu'elle affecte plus de 300 000 personnes en France, les personnes aphasiques sont souvent exclues des services de santé, d'orientation, de secours et de soutien téléphonique. Pourtant, des stratégies de communication peuvent être mises en place pour faciliter les interactions, telles que l'utilisation de la voix, des images, de l'intonation, les gestes et les expressions du visage. En France, le Centre National Relais 114 (CNR114) traite les appels d'urgence des personnes qui ne peuvent pas téléphoner, en utilisant la vidéo, le texte et la voix. Depuis 2019, une recherche participative est menée pour rendre ce service accessible aux personnes aphasiques. Cette présentation se concentre sur les dispositifs de co-conception participative mis en place pour impliquer toutes les parties prenantes, y compris les personnes aphasiques, les agents du CNR114 et des urgences locales (samu-centre 15, pompiers, police), ainsi que les aidants familiaux. Les simulations papier puis expérimentales ont montré leur efficacité, en co-présence puis à distance, pour ajuster de manière progressive et concertée l'interface d'appel, la nature des images mobilisées, les pratiques de communication des agents et leurs engagements multiples, notamment avec les services d'urgence locales.
-
Communication orale
Repenser l’expérience de la dialyse à domicile par le codesign : de l'enquête collective à la création de dispositifs de médiation pour les ateliers participatifsMarie-Julie Catoir-Brisson (Audencia Business School), Susana Paixao-Barradas (Kedge Design, Marseille)
Cette communication porte sur une recherche interdisciplinaire sur les technologies en santé, pour améliorer l’expérience de la dialyse à domicile et la communication entre patients, aidants et soignants (PAS). Nous préciserons d’abord le besoin de recherche sur cette pathologie et la nécessité de prendre en compte l’expérience-patient à partir de méthodes visuelles, créatives et narratives pour la rendre compréhensible et partageable. Nous expliquerons ensuite la co-construction du kit d’enquête basé sur la communication épistolaire et la photographie, élaboré avec les patients en contexte de pandémie. Ce dispositif d’enquête visait à créer un lien affectif pour soutenir l'engagement des patients tout en favorisant leur expression sur leur vie quotidienne avec la maladie rénale, les acteurs qui les accompagnent ou encore leurs technologies de soin.
À partir d’une méthodologie ancrée dans le design et la communication, et en nous appuyant sur une approche de co-design et d’ethnographie par le design, nous présenterons les différents outils d’enquête co-créés avec les patients. Nous analyserons aussi le processus de transformation des outils d’enquête en dispositif de médiation pour le premier atelier, pour faire le lien entre la recherche et la conception. Les résultats présentés porteront sur la méthodologie participative et les technologies mobilisées sur le terrain, en valorisant la démarche de créativité low-tech suscitée par le terrain.
-
Communication orale
Co-construire une intervention orthophonique innovante et responsable pour traiter l’(auto-)stigmatisation du bégaiement : résultats d’une réflexion avec les parties prenantesSébastien Finlay (École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal), Geneviève Lamoureux (UdeM - Université de Montréal), Ingrid Verduyckt (École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal)
L’intervention orthophonique pour les personnes qui bégaient (PQB) vise surtout le maintien d’une parole fluide. Bien que des approches tenant compte des aspects psychologiques (comme la honte) suscitent de l’intérêt, elles n’adressent pas directement l’expérience identitaire (présenter une condition stigmatisée pouvant entraîner un processus d’internalisation appelé « auto-stigmatisation »). Pourtant, l’(auto-)stigmatisation constitue un obstacle majeur à la participation sociale de la PQB, qui s’ajoute, voire dépasse celui que représente la parole bégayée. Alors que la littérature récente s’intéresse à documenter le rôle de l’(auto-)stigmatisation sur la qualité de vie des PQB, nous manquons d’interventions ciblant sa diminution. Notre recherche vise à développer une intervention orthophonique pour adresser l’(auto-)stigmatisation basée sur des principes d’innovation responsable en santé (IRS). La première étape de notre projet a consisté en la tenue de deux ateliers de co-création exploratoires pour définir les principes centraux de l’intervention avec les parties prenantes : PQB (n = 5), clinicien·nes (ex. orthophonistes) (n = 5) et spécialistes de l’innovation en santé (ex. concepteur·ices de programmes cliniques) (n = 5). Ces ateliers de co-création ont été encadrés par une méthode de recherche participative (collecte de données mixtes) en 3 étapes, inspirée de la Participative Concept Mapping Approach. Les résultats préliminaires de cette démarche seront présentés.
Session Chaire Diament
-
Communication orale
La double facette du codesign en santé mentale numérique : une méthode de conception et de recherche qualitativeSana Boudhraâ (UQAM - Université du Québec à Montréal), Julien François (UQAM)
Le codesign est souvent associé à des recherches participatives ayant l’intention d’inclure les usagers cibles. Or, il fait plutôt référence à une forme spécifique de conception participative très proche de la co-création. Le codesign puise de la créativité combinée des concepteurs et des personnes non formées à la conception, tout au long du processus de conception.
Cette communication va décortiquer les rôles clés, les avantages et les défis que pose l’adoption du codesign en santé mentale (SM) numérique ainsi que son apport comme outil de recherche qualitative. Pour ce faire, nous exposerons des résultats de 2 études complémentaires : 1) Un projet de recherche-développement d’une solution numérique en SM adoptant l’approche de codesign (Mentallys) et 2) Une recherche empirique sur l’étude des stratégies de conception et de design des services de cyber SM et leurs effets sur l’adoption et l’efficacité de ces services. Le premier étant une étude longitudinale approfondie d’un processus de conception d’une solution numérique visant l’amélioration d’accès aux soins et services de SM dans lequel le codesign est utilisé en amont et tout au long du processus. Le second, est une recherche mixte, sur les processus de design de solutions numériques en SM ainsi que la perception des usagers finaux de ces solutions et l’effet du design sur leur adoption. Nous clôturons par une liste de recommandations pour les chercheurs et praticiens qui voudraient adopter le codesign.
Pause-lunch
Conférence d’honneur
-
Communication orale
Ce que codesign veut dire : la perspective des sciences du designStéphane Vial (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Le codesign est un terme générique utilisé dans de nombreuses disciplines de manière hétérogène. Je souhaite revenir au noyau "design" du "codesign" à partir de la perspective des sciences du design. Selon cette perspective, le codesign est une approche spécifique de design centré sur l'humain dont elle partage l'épistémè. Dans le codesign, les utilisateurs finaux ne sont pas seulement pris en compte ou consultés, ils participent à la création des solutions aux côtés des chercheurs, des concepteurs et des parties prenantes. Il est donc important de faire une distinction épistémologique entre les termes codesign et design participatif, qui sont trop souvent utilisés comme synonymes. Design participatif est un terme utilisé dans diverses disciplines pour désigner un large éventail d'activités qui ne sont pas nécessairement liées aux principes de design centré sur l'humain et dans lesquelles les utilisateurs finaux sont impliqués de manière irrégulière et sporadique. Il faut différencier les deux termes et réserver le terme codesign à une forme spécifique de design participatif ancré dans la culture du design centré sur l'humain. Dans le domaine de la santé mentale numérique, nous entendons par là une approche dans laquelle 1) les utilisateurs finaux sont impliqués dès le premier jour en tant que partenaires dans la conception et 2) les experts en design, aux côtés des chercheurs en santé, jouent un rôle clé en tant que facilitateurs de l'ensemble du processus et des activités.
Session thématique 2
-
Communication orale
Premiers pas vers une gestion du stress adaptée aux étudiants universitaires grâce au codesign de technologies numériquesJennifer Denis (Département de Psychologie Clinique, Université de Mons, Belgique), Justine Gaugue (Département de Psychologie Clinique, Université de Mons, Belgique), Maria-Pascale Lukenga (Université de Mons)
Les étudiants universitaires bénéficient de nombreux dispositifs technologiques pour réduire le stress occasionné par les difficultés éprouvées en milieu académique. Cependant, ces dispositifs restent largement sous-utilisés, car les étudiants les considèrent inadaptés à leurs besoins. Notre étude vise à fournir aux étudiants une plateforme en ligne de gestion de stress adaptée à leurs besoins spécifiques grâce à la méthode du codesign. Une étude mixte sera réalisée pour recueillir des données quantitatives sur l'utilisation d'une plateforme existante de gestion de l'anxiété, qui seront combinées avec des entretiens de Focus group(FG) pour adapter la plateforme en fonction des besoins spécifiques en matière de gestion de stress des étudiants universitaires. Les résultats quantitatifs attendus permettront de réaliser un inventaire d'utilisation de la plateforme de gestion de l'anxiété et d'identifier les améliorations nécessaires pour la rendre plus efficace. Ces résultats seront complétés par l’analyse des FG qui permettront de comprendre les sources de stress des étudiants universitaires et de trouver les méthodes les plus appropriées pour gérer leur stress et les fonctionnalités nécessaires à cette plateforme. Nous présenterons lors du congrès les résultats d'une étude préliminaire sur la gestion du stress chez les étudiants universitaires, qui montrent la nécessité d'une approche de codesign pour concevoir une plateforme en ligne adaptée aux besoins réels des étudiants.
-
Communication orale
L’inclusion de jeunes dans le codesign d’une application mobile portant sur la consommation de cannabis : une réflexion autoethnographiqueValérie Aubut (Uqtr- Université du Québec à Trois-Rivières), Iris Bourgault Bouthillier (Université du Québec à Montréal), Emma Février (Université du Québec à Montréal), Mathieu Gougeon (Université de Sherbrooke), Mathieu Goyette (UQAM - Université du Québec à Montréal)
L’implication continue des personnes utilisatrices dans le développement d’applications mobilespar les firmes technologiques est une pratique courante pour s’assurer de l’adéquation du produitaux intérêts du public ciblé. La recherche participative offre les possibilités de repenser leur rôledans le codéveloppement d’applications mobiles pour s’assurer à la fois de leur acceptabilité et de leur utilité pour les personnes impliquées. Cette présentation propose une réflexion entourant l’inclusion de jeunes au processus de codéveloppement et de mise en œuvre de l’application mobile Canna-Coach. Elle s’appuie sur une méthode autoethnographique qui permet de comprendre l’expérience personnelle de l’équipe de recherche face au processus de codesign. Nous avons rencontré plusieurs défis entourant l’implication des jeunes dans le projet Canna-Coach. Plusieurs éléments clés ont favorisé leur intégration dans le processus : le travail à distance en synchrone, l’adaptation des horaires selon leurs disponibilités, un suivi régulier entre les rencontres, une attitude égalitaire de manière que les jeunes soient considérés comme des membres de l’équipe à part entière et que leur expertise de vécu soit reconnue. Ces éléments sont discutés en lien à l’approche priorisée qui doit être réfléchie lors de l’instauration d’un processus de codesign. Ces éléments réflexifs sont mis en perspective quant à leur transposition possible à d’autres domaines de la cybersanté.
-
Communication orale
Le codesign des composants du Dossier Patient Informatisé de demain peut-il être intrinsèque à l’hôpital ?Louise Robert (CHU de Montpellier)
Le Dossier Patient Informatisé (DPI) apparaît non seulement être en inadéquation avec les besoins des utilisateurs mais il est de plus identifié comme premier motif de burn-out chez les praticiens et source d'erreurs médicale. Bien que l'importance de la participation des utilisateurs finaux au développement de leurs outils technologiques ait été reconnue depuis les années 70, il demeure encore difficile de la mettre en pratique avec le personnel hospitalier. Nous menons actuellement douze expérimentations au CHU de Montpellier (France) afin de valider une méthode de co-design du DPI intrinsèque à l’hôpital. Dans cette communication, nous rapporterons la première de ces expérimentations : le co-design d'un composant spécifique au suivi et à la prescription de l'isolement thérapeutique en psychiatrie. Nous montrerons que la pratique du co-design avec le personnel hospitalier nécessite des transformations systémiques et transforme la relation à l’éditeur. Il devient alors possible de faire émerger de nouveaux espaces relationnels indispensables à l'élaboration d'un système d’information clinique véritablement pertinent et habilitant.
Session Chaire Diament
-
Communication orale
L’expérience d’accès aux soins de santé mentale au Québec : comprendre les enjeux à travers le codesign de l’application MentallysMathieu Dumont (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Stéphane Vial (Université du Québec à Montréal)
Contexte : Les technologies immersives représentent une avenue prometteuse pour faciliter l’accès aux soins en santé mentale. Néanmoins, il existe peu d’études sur l’expérience subjective d’accès aux services en santé mentale. Il s’avère important de mieux comprendre cette réalité afin de soutenir le développement d’innovations technologiques. Cette phase d’observation et de découverte est indispensable au processus de conception et nous proposons que celle-ci puisse être alimentée par le codesign. Objectifs : Ce projet vise à comprendre l’expérience subjective d’accès aux soins par les personnes utilisatrices de services en santé mentale, et ce, afin de soutenir le codesign d’une plateforme numérique : Mentallys. Méthode : À travers des ateliers de codesign, des personnes utilisatrices de service ont été invitées à produire une cartographie de leur parcours de soins. Un devis mixte simultané a été privilégié pour analyser ces parcours (type d’acteur, expérience d’accès aux soins). Résultats : Dix participants ont été impliqués dans les ateliers de codesign et quatre-vingt-deux épisodes de soins ont été analysés. La disponibilité limitée des services, les contraintes financières ainsi que la difficulté à trouver un intervenant à sa convenance étaient les principaux enjeux relevés au regard de l’expérience d’accès aux soins. Les résultats ont permis de mieux comprendre l’expérience concrète des parcours de soins en santé mentale et d’éclairer le développement de Mentallys.
Ouverture
Conférence d’honneur
-
Communication orale
Codesign de technologies d’auto-soin: une approche sensible et ancrée dans des pratiques situées.Sylvie Grosjean (Université d’Ottawa)
L’écosystème des technologies de santé pour les personnes vivant avec des maladies chroniques est foisonnant et de nombreuses technologies ont été conçues afin de soutenir l’autosoin (self-care). Ces technologies ont pour objectif d’équiper les patients afin de leur permettre d’observer des changements, gérer un traitement, des symptômes ou faire face aux conséquences physiques et psychologiques de la vie avec la maladie. Ces technologies peuvent donc suggérer des conseils de soins, soutenir la réflexion en mettant à disposition des patients des informations de santé contextualisées, etc. Ce qui soulève quelques enjeux de conception et une question centrale : en quoi une technologie de santé peut-elle équiper le « travail du patient » afin de le soutenir dans son activité d’autosoin ? Pour répondre à cette question, nous prendrons appui sur deux projets de conception de technologies d’autosoin – en cardiologie et en neurologie - impliquant des patients et des professionnels de la santé. Ces deux cas, nous permettront d’ouvrir une réflexion sur la manière de penser le codesign des technologies d’autosoin. Nous montrerons comme une approche de codesign peut se nourrir de cadres conceptuels issus des sciences humaines et sociales afin de développer (a) une approche intégrée dans des relations socio-matérielles et des pratiques situées mais aussi; (b) sensible aux expériences vécues et incarnées à travers l’analyse des « trajectoires de la maladie ».
Session thématique 3
-
Communication orale
Codesign d’une plateforme numérique en santé : un projet sur l’optimisation de l’expérience patientSamira Amil (VITAM-Centre de recherche en santé durable), Marie-Pierre Gagnon (Faculté des sciences infirmières - Université Laval), Maxime Sasseville (Faculté des sciences infirmières - Université Laval), Jack Tchuente Tchuente (VITAM − Centre de recherche en santé durable)
La prévalence des maladies chroniques est en augmentation continue. Elles sont responsables des deux tiers des décès à l’échelle planétaire et constituent ainsi la première cause de mortalité dans le monde. Au Canada, ces maladies exercent une forte pression sur le système de santé et entrainent la surconsommation de soins et de services partout au pays. Par conséquent, elles mettent en péril la viabilité du système de santé. Une telle situation souligne la pertinence de développer des interventions pour alléger le système de santé et ainsi diminuer le fardeau économique associé à la gestion de ces maladies. Plusieurs experts s’accordent pour dire que les interventions qui augmentent la participation des patients à leurs propres soins sont associées à de meilleurs résultats en matière de santé. Les technologies numériques ont le potentiel de soutenir la gestion des maladies chroniques en tenant compte des besoins, des préférences et des capacités des utilisateurs finaux.
Le projet vise à développer, implanter et évaluer par une étude pilote CONCERTO+, une plateforme multifonctionnelle et personnalisée de cybersanté afin d’optimiser le rôle actif du patient atteint d’au moins une des quatre maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque et dyslipidémie) dans le suivi de son état de santé, sa prise de décisions, sa satisfaction par rapport aux services offerts et sa qualité de vie.
-
Communication orale
Le codesign en santé : un outil de légitimation ?Julie Journot (Université de Bourgogne)
Gagner en engagement, se sentir écouté, avoir des outils personnalisés à ses besoins, améliorer sa participation : les bénéfices d’inclusion des patients dans une dynamique de co-design sont multiples. Nous pouvons questionner les avantages de la mise en place d’un tel dispositif pour les concepteurs des outils en santé, ce que nous proposons au travers de cette communication. Dans cette optique, une méthodologie mixte a été adoptée, comprenant un questionnaire quantitatif, une observation de l’utilisation de l’outil par des patients testeurs et des entretiens semi-directifs. L’analyse de ce processus d’aller-retour entre concepteurs et patients a permis d’identifier des intérêts pour les concepteurs différents de ceux envisagés pour les patients. Dans notre étude, l’intégration des patients testeurs est tardive, le temps et l’espace de réflexion ne sont pas offerts aux patients interrogés, qui n’obtiennent qu’un rôle de suggestion de modifications. Incomplet, ce processus de co-design est limité et est principalement mobilisé en vue de pouvoir communiquer sur la validation de l’outil par les patients. Le co-design s’avère être ici un moyen de légitimation des développements entrepris et de promotion de l’outil de santé avant d’être un procédé facilitant d’engagement des patients.
-
Communication orale
Codesign d’une technologie de microrobotique neurochirurgicaleTom Formont (Units), Jordi Vuong (Units), Roman Weil (ENSCI)
Units, studio de design, a initié une méthodologie de codesign avec Robeauté, startup française de microrobotique neurochirurgicale. Débuté en 2019, ce projet suit toujours son cours, et formalise l’ensemble des enjeux que le design aborde : stratégie, produit (software & hardware), prospective et imaginaires visuels. Cette présentation articule une réflexion méthodologique, sa mise en place et les données récoltées. Elle adresse deux échelles : celle préalable de la vision socio-technique et celle du développement des produits de Robeauté (microrobot, dispositif d’insertion intra-cranial, console de contrôle).
- Face au besoin de porter le développement à long-terme d’un ensemble de produits complexes, une méthode permettant la création d’un imaginaire commun est mise en place. À travers une sélection de contenus visuels et sémantiques, les équipes de Units co-définissent avec Robeauté les valeurs fondamentales à intégrer dans la conception de leur produit. Ce travail permet d’injecter la vision globale de l’entreprise dans la priorisation des fonctionnalités à développer.
- Afin de prototyper les produits, une méthode par allers-retours entre produit “vision” et “prototype” a été mise en place. D’un côté, la vision se matérialise sous la forme de modélisations et de schémas d’architectures afin de codesigner le produit avec des partenaires. De l’autre, un produit en lien direct avec la R&D, où des blocs techniques sont prototypés afin de tester précisément des fonctionnalités.
Session Chaire Diament
-
Communication orale
Affordances pour optimiser la participation en codesign dans un projet en cybersantéMélanie Tremblay (ENAP - École nationale d'administration publique)
Le codesign est une approche permettant aux personnes concernées par un produit ou service de contribuer à la conception de ce dernier (Sanders & Stappers, 2008). La participation de l’utilisateur ciblé (end user) permet de se rapprocher de ses besoins (Thabrew et al., 2018; Tremblay et al., 2022; Vial & Boudhraâ, 2022) . Le codesign nécessite la collaboration entre des experts du processus et des utilisateurs, experts de leur interaction avec le produit ou service (Bratteteig & Wagner, 2012, 2014, 2016). Même si l’approche de codesign a généralement des impacts positifs, des revues systématiques portant sur l’implication de l’utilisateur dans le développement de système rapportent des effets mitigés voir négatifs (Abelein & Paech, 2013; Bano & Zowghi, 2013). Ces impacts négatifs incluent, par exemple, des problèmes de communication et d’incompréhension conduisant à des conflits au sein des équipes de projet, augmentation des attentes des utilisateurs et diminution de la qualité en raison de compétences techniques insuffisantes des utilisateurs. Faire participer l’utilisateur de manière efficiente demeure un grand défi en codesign, modifiant le rôle du designer dans le processus (Manzini, 2015). Basé sur des données empiriques portant sur l’expérience des participants dans un projet de codesign en cybersanté, nous proposons des affordances pour optimiser à la fois l’expérience des participants et l’approche de codesign (Tremblay, 2022).
Pause-lunch
Session thématique 4
-
Communication orale
Apports et limites du codesign avec les personnes aînées : le laboratoire vivant « Mobilaînés »Bessam Abdulrazak (Université de Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement), Sara Bahrampoor Givi (UdeS - Université de Sherbrooke), Dany Baillargeon (UdeS - Université de Sherbrooke), Catherine Girard (Centre de recherche sur le vieillissement), Hélène Pigot (Université de Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement), Véronique Provenche (Université de Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement), Sahar Tahir (UdeS - Université de Sherbrooke)
Dans l’écosystème des approches de codesign se trouvent les laboratoires vivants (LV), des environnements collaboratifs intersectoriels de cocréation plaçant au centre du processus d’innovation les usagers dans leur environnement naturel. L’aspect intersectoriel et le développement dans des environnements réels de vie des usagers constituent des particularités des LV, appelant ainsi une structuration différente du processus d’innovation. Malgré les avantages documentés de cette approche, le LV vient avec son lot de défis et de risques, « […] exacerbés lorsque les utilisateurs finaux comprennent des populations présentant des disparités importantes en matière de santé et de soins de santé, liées à une série de vulnérabilités croisées […] » (Moll et al., 2020. Notre traduction). Cette communication présente le projet Mobilaînés, une plateforme en ligne et hors ligne – dans la 2e phase de conception – permettant d’aider la population aînée de Sherbrooke à se déplacer « où, quand, comment elle le souhaite » et ainsi soutenir sa participation sociale. Par la présentation du protocole laboratoire vivant derrière Mobilaînés, nous montrons l’intégration des personnes aînées dans le processus, les apports, limites et défis de cette participation. Seront également présentés les résultats obtenus à ce jour: les critères d’une plateforme « amie des aînés », les 34 besoins ou préférences convertis en 16 options nouvelles, utiles et réalisables et leur intégration dans la plateforme.
-
Communication orale
Le codesign au service de la conception d’une intervention numérique pour une information individualisée des patients sur l’évolution de leur parcours aux urgencesLoélia Rapin (Sensipode, Nantes Université, Ecole de Design Nantes Atlantique)
La proposition de communication orale que nous faisons présente une des expérimentations menées dans le cadre d’une recherche par le projet de design dans le service d’urgences du CHU de Montpellier. Le projet, débuté fin 2021, vise à apporter des réponses à une problématique de tensions lors de l’admission des patients aux urgences en impliquant les acteurs de terrain. L’équipe projet est composée d’une directrice d'hôpital, une designer, d’une designer doctorante et a mobilisé plus de 400 patients et accompagnants, 30 professionnels des urgences ainsi qu’une vingtaine de professionnels métier de l’établissement. Face à la complexité des interventions dans un service d’urgences, nous avons testé différentes façons de recueillir l’expérience des usagers, ce qui a permis d'identifier les problématiques existantes et dont le manque d'information des patients pendant leur parcours est apparu comme une des sources de tensions. La solution imaginée par les usagers consiste à envoyer des notifications SMS aux patients pour continuer à les informer de façon individualisée sur l’évolution de leur prise en soin pendant les moments d’attente. Notre objectif est de détailler un processus de codesign appliqué au milieu de la santé et de montrer comment il peut aboutir à la conception d’une réponse numérique qui utilise une technologie existante au service d’un réel besoin.
-
Communication orale
Le patient partenaire dans le codesign de technologies en santé et la transformation numérique.Genevieve David (ENAP - École nationale d'administration publique)
L’engagement des patients et citoyens au sein d’organisations vise à co-construire par des processus allant de l’idéation à la prise de décisions partagées sur les activités qui les concernent. Selon le Modèle de Montréal, le patient est un acteur à part entière de ses soins grâce à ses savoirs et expériences de vécu avec la maladie, des trajectoires de soins et services, et des conséquences de la maladie sur son quotidien, ses proches et son projet de vie. Dans le domaine des technologies de l’information et de la transformation numérique, cette relation de partenariat reconnait aux patients partenaires un rôle plus important que simple utilisateur (end-user), afin de faire de l’innovation avec les patients. Ce partenariat avec les patients répond à un désir de favoriser des pratiques éthiques, démocratiques, morales, éclairées et responsables de l’innovation numérique. Nos travaux permettent de dégager quelques constats concernant la préparation et d’implantation de l’approche de partenariat dans les projets numériques. Les équipes TI présentent de meilleurs résultats quant au partenariat lorsque l’équipe présente une volonté à implanter le partenariat dans l’organisation et une préparation adéquate à travailler en partenariat. De plus, un accompagnement de l’organisation tout au long du projet par des experts du partenariat s’avère un élément clé dans le vécu de l’expérience de partenariat pour toutes les parties prenantes.
-
Communication orale
La santé mentale numérique : l'enchâssement dans la pratique clinique et la culture organisationnelle, le cas traceur du CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-MontréalJennifer Dahak (CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal)
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal au travers de ses axes d’excellence notamment en santé mentale, dépendance et itinérance et son mandat d’Institut universitaire en santé mentale est chef de file en innovation dans ce champ. Avec l’expertise de son centre de recherche et de par les collaborations actives auprès des partenaires de l’écosystème notamment par le programme BEACHHEAD ™ de MEDTEQ+, des projets pilotes en santé mentale numérique ont pu voir le jour. L’exposé fera un état de situation sur l’avènement de ses projets pilotes dans les milieux de soins, l’importance d’enchâsser le numérique dans les pratiques cliniques, une revue rapide sur les facteurs facilitant l’engagement des cliniciens dans ces projets ainsi qu’un coup d’œil sur les facteurs entravant le tout en tenant compte du contexte d’implantation plus largement de la Stratégie numérique en santé mentale.
-
Communication orale
Promosanté : co-création d’un programme transdisciplinaire de télésanté axé sur l’autogestion de la santé des personnes aînées à risque de déconditionnementPatrick Boissy (Département de Chirurgie orthopédique, Faculté de Médecine et sciences de la santé, Université de Sherbrooke), Nesrine Koubaa (UdeS - Université de Sherbrooke), Mélanie Levasseur (École de réadaptation, Faculté des lettres et sciences humaines,Université de Sherbrook), Ruth Ndjaboue (École de travail social, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrook), Céline Verchère (Département de Chirurgie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke;)
Introduction : Afin de réduire les incapacités chez les aînés, PROMOSANTÉ est co-créé à l’aide d’une collaboration en activité physique, en ergothérapie et en psychologie, et impliquant plusieurs intervenants. Objectif : Le projet vise à mobiliser les aînés à risque de déconditionnement et favoriser l’autogestion de leur santé. Méthodologie : La méthode du laboratoire vivant est déployée pour soutenir la co-conception du projet. À la phase d’exploration des besoins, les partenaires, incluant des aînés (65 ans et plus), des cliniciens et des gestionnaires dans les services de santé ont été invités à donner leurs réflexions lors des entrevues. Ensuite, une plateforme web intégrant les modules disciplinaires est développée, selon les besoins identifiés, et dont l’utilisabilité sera testée par des usagers potentiels. Après, le projet sera mis en place auprès de 40 participants sur une période de 16 semaines. L’évaluation de l’implantation sur l’activité physique et la participation sociale inclura des mesures objectives et subjectives. Aussi, des groupes de discussion seront réalisés pour explorer les barrières et les facilitateurs, et un plan de pérennisation sera établi pour favoriser le transfert. Résultats attendus : La co-conception permettra le croisement de savoirs et ainsi, une meilleure adaptation aux besoins des aînés. De plus, la documentation des différentes phases du projet guidera la mise à l’échelle des interventions numériques visant l’autogestion de la santé.
Ateliers d’inspiration
-
Communication par affiche
Co-conception de contenu immersif pour l’entraînement de la cognition sociale auprès des personnes détenues atteintes de schizophrénieMathieu Dumont (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Les technologies immersives suscitent un intérêt grandissant dans le domaine de la réadaptation psychiatrique. Des applications variées sont étudiées pour l’évaluation et le traitement des personnes atteintes de schizophrénie. Les technologies immersives offrent la possibilité de pratiquer des habiletés dans un contexte sécuritaire tout en simulant les situations de vie réelle. Ces attributs s’avèrent particulièrement utiles lorsqu’il est question d’intervenir auprès de personnes à risque de comportements violents en milieux sécuritaires. Néanmoins, peu d’interventions ayant recours aux technologies immersives ont été développées jusqu’à présent pour aborder des déficits associés à la violence auprès des personnes atteintes de schizophrénie. Ce projet vise à développer des vidéos immersives pour l’entraînement de la cognition sociale, un facteur associé à la violence, auprès des personnes atteintes de schizophrénie en milieu carcéral et en psychiatrie légale. Considérant les ressources devant être mobilisées pour développer du contenu immersif, il s’avère important de s’assurer que la solution proposée réponde aux besoins et caractéristiques des utilisateurs. Dans cette optique, une démarche de co-conception avec des utilisateurs potentiels est proposée. Celle-ci impliquera des cliniciens et des personnes utilisatrices de services en psychiatrie légale à travers une série d’ateliers de co-conception.
-
Communication par affiche
SeCurESex : application mobile géolocalisée pour villes intelligentesDavid Risse (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Cette application mobile géolocalise à Montréal l’ensemble des cliniques et des points de service spécialisés en santé mentale, santé sexuelle et/ou consommation de stupéfiants. Selon la nature du risque encouru et le type de consommation et/ou d'exposition sexuelle, elle permet à la personne concernée de connaître rapidement en temps et en lieu le service le plus proche pour répondre à son besoin, avec les informations clés : horaires, critères de prise en charge (carte RAMQ) et de rendez-vous (en ligne; par téléphone; les 2; sur place). Le projet implique le codesign communautaire et universitaire et la coopération de services spécialisés en santé mentale/sexuelle et dépendances. Il contribuera à reconnaître et à valoriser l'expertise d'usagers partenaires et du soutien communautaire.
-
Communication par affiche
Listyp : l'application sociale qui encourage l'écriture chez les jeunes adultes en faveur de la santé mentale grâce à l'IA.Théo Geiller (L'École de Design Nantes Atlantique)
Listyp est une application pour la journaling basée sur la création de listes. Il offre une aide pour trouver des idées de listes et développer les pensées pour chaque élément. En plus, l'application est sociale, les utilisateurs peuvent voir les listes quotidiennes de leurs amis et discuter avec eux. L'IA peut ainsi animer ces discussions et suggérer des débats pour explorer de nouveaux horizons. Listyp encourage la réflexion quotidienne et la communication sociale saine pour améliorer la santé mentale des utilisateurs en les aidant à mieux organiser leurs pensées.
-
Communication par affiche
WatchU&Learn : application pour étudiants malentendantsSylvain Miklohoun (Université Paris-Est Créteil)
On clame que tout le monde a droit à l'éducation mais est-ce que les personnes en situation de troubles auditifs ont pu accéder aux cours en distanciel lors des confinements? C'est dans l'intention d'accompagner les étudiants malentendants que nous avons pensé à une application qui permettra à ces étudiants de suivre directement les cours en visio-conférence tout en restant autonomes sans craindre les railleries ni d'inconformes prises de notes. L'application fera apparaitre sur l'écran un avatar qui traduit en langue de signes les propos de l'enseignant. Cet enseignant verra en retour la transcription de la langue signée de ses étudiants malentendants. Cette application que nous proposons subsistera à l'épreuve du temps et accompagnera tous les cours qui pourront se faire en ligne.
-
Communication par affiche
Développement d’une plateforme numérique collaborative en prévention et réduction des méfaits pour les jeunes consommateurs de substances psychoactivesStéphane Anctil (Faculté de médecine, Université Laval), Marie Pierre Gagnon (Faculté des sciences infirmières, Université Laval), Anne Guichard (Faculté des sciences infirmières, Université Laval), Anthony Lachance (Université Laval), Noah Veilleux (Faculté des sciences infirmières, Université Laval), Catherine Wolfe (Université Laval)
La pandémie de Covid-19 a précipité la conversion de nombreuses interventions de santé vers le
numérique avec pour conséquence d’exacerber les inégalités sociales et digitales de santé, notamment
parmi les populations en situation de grande précarité sociale. Ce phénomène est particulièrement marqué
chez les jeunes consommateurs de substances psychoactives (SPA) pour qui les services en réduction des
méfaits (RDM) sont rares et peu adaptés à leurs besoins spécifiques, alors que la crise des opioïdes affecte
cette population de façon disproportionnée. Dans ce contexte, le projet proposé a pour objectif de
développer collaborativement une plateforme numérique en prévention et réduction des méfaits pour des
jeunes consommateurs de SPA en situation de grande précarité sociale. Les retombées visées pour ce
projet sont :
➢ Limiter l’impact social du virage numérique chez les usagers de SPA;
➢ Complémenter la prestation de services existants et supporter les interventions dans une période
d’épuisement et de pénurie de main d’œuvre au sein du milieu communautaire;
➢ Le co-développement permet que les jeunes usagers de SPA aient accès à une ressource adaptée à
leurs besoins, que ce soit dans le contenu, dans le format ou dans les modalités d’accès;
➢ Développement des services en RDM au Québec;
➢ Contribution à des services de première ligne plus intégrés en santé mentale et toxicomanie;
➢ Diffusion rapide de messages d’urgences;
➢ Possibilité d’intégrer des services connexes.