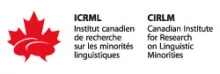Informations générales
Événement : 88e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :Ce colloque explore les liens entre le patrimoine, la mémoire et la vitalité chez les communautés linguistiques en situation minoritaire au Canada et ailleurs dans le monde.
Ce colloque interdisciplinaire encourage les approches critiques des concepts de patrimoine, de mémoire et de vitalité. Comment les communautés minoritaires s’approprient-elles ces notions dans leurs discours et dans leurs pratiques? La notion de patrimoine est facilement associée à celle de mémoire collective, qui renvoie aux processus suivant lesquels se construisent des représentations sociales ainsi que des symboles autour de personnages et de faits marquants caractéristiques de l’histoire d’une collectivité. Quel est l’impact de cela sur la vitalité communautaire? Qu’en est-il du lien entre patrimoine et histoire? Lowenthal fait ressortir les tensions entre la discipline historique, qui est objective et désintéressée, et le patrimoine, qui vise à informer le présent.
En particulier, le colloque vise à faire état du rôle de la mémoire dans ces communautés avec des études de cas. Quels rapports les minorités linguistiques entretiennent-elles avec leur passé et comment ces rapports participent-ils à leur épanouissement au présent? Quels pratiques et lieux participent à la transmission d’une mémoire et de l’histoire des communautés à différentes échelles : locale, régionale, nationale, voire internationale?
Nous nous intéressons, entre autres, à la marchandisation du patrimoine et des activités de mémoire des communautés minoritaires. Comment le passé se traduit-il en une industrie touristique et en produits touristiques? Quel est l’impact économique de ces activités et dans quelle mesure, le cas échéant, la « crédibilité scientifique » est-elle sacrifiée? Compte tenu des enjeux culturels et économiques, comment un dialogue ouvert sur les forces et les faiblesses de ces passés construits peut-il avoir lieu?
Remerciements :Organisé par le Réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise et l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques en partenariat avec le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l'Est, l'Association des Townshippers et le Réseau du patrimoine anglophone du Québec. Nous reconnaissons l'appui du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Quebec.
English version: https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/scpa/quescren/docs/ACFAS_2021_ENG.pdf
Dates :Format : Uniquement en ligne
Responsables :- Patrick Donovan (Université Concordia)
- Lorraine O' Donnell (Université Concordia)
- Anne Robineau (ICRML - Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques)
- Eric Forgues (Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques)
Programme
Mot de bienvenue : QUESCREN, ICRML, SRQEA
Conférencier d’honneur
-
Communication orale
Tintin historien au pays mémoriel des minorités francophonesYves Frenette (Université de Saint-Boniface)
Dans toutes les sociétés, les historiens contribuent à la construction d’une mémoire garante de la filiation entre le passé, le présent et l’avenir. Cependant, par le biais d’enquêtes menées avec méthode, leur apport à la mémoire collective diffère de celui d’autres intervenants. S’ils sont aussi des citoyens engagés, les historiens doivent pratiquer une nécessaire mise à distance, à la fois envers les acteurs du passé et envers leurs propres convictions.
Ce salutaire équilibre est difficile à maintenir pour les historiens des communautés francophones. Marginalisées sous plus d’un aspect, celles-ci sont constamment à la recherche de justice et de reconnaissance. Dans leur combat, les porte-parole des minorités multiplient les références à l’ancrage profond des francophones dans le territoire national ou provincial. Trop souvent, ils considèrent les historiens comme des commémorateurs savants qui confortent du sceau de leur expertise les idées reçues au sujet du passé. Mais est-ce bien là le rôle des historiens ?
Pratiques patrimoniales : mythes et réalités
-
Communication orale
Les pièges et les occasions de la consultation en histoire franco-ontarienne: les expériences des projets de livre sur Dubreuilville (2015-18) et le Moulin-à-Fleur (2019-...)Serge Dupuis (Université Laval)
Les professeurs sont débordés pour réaliser tous les projets pour lesquels ils sont sollicités et les communautés manquent d’expertises - et souvent de ressources - pour mettre en valeur la singularité de leur histoire.
Voilà d’où m’est venue la volonté de mettre mon expertise au dérive des secondes pour réaliser des projets de publication (article, étude ou monographie), la plupart du temps à l’occasion des anniversaires d’organisations, de politiques et de lieux de la francophonie canadienne.
Si le travail pour un mécène ou un client peut offrir un accès privilégié à des documents et à des témoignages, des difficultés méthodologiques et éthiques peuvent émerger lorsque le bailleur de fonds est une partie intéressée.
Comment produire une étude à la fois objective et utile à l’avancement des connaissances, tout en rendant le processus et le résultat stimulant pour ses lecteurs et ses clients, sans basculer dans le jovialisme ou la complaisance?
Voilà à la fois le dilemme et l’opportunité pour la consultation en histoire.Cet exposé revient sur l’expérience de mon premier grand mandat (Dubreuilville) et le plus récent (Moulin à Fleur) afin de dégager les apprentissages que j’ai faits sur la compréhension et la considération.
-
Communication orale
Patrimoine immatériel : transmission d’une mémoire morcelée-le cas d’Ihitoussen, une communauté de forgerons kabyleMassinissa Saidani (Université Abderrahman Mira de Bejaia, Algérie)
Notre proposition de recherche vise à étudier la mémoire collective transmise oralement en Kabylie à travers le cas d'Ihitoussen en kabyle. Pour ce faire, nous avons choisi de procéder avec une approche d'anthropologie interprétative des « cadres sociaux de la mémoire individuelle et collective » des légendes « que nous avons collectées auprès du groupe social ici étudié ».
Ces récits expliquent que le groupe est venu de quelque part, d’un ailleurs non nord-africain, associé implicitement aux origines juives descendant du Roi-prophète David et explicitement des Arabes appartenant à la lignée prophétique de Mohammed. Notre esprit s'étonne, refusant ce sens commun et critique par des questions précises : comment le groupe social berbérophone de Kabylie est arrivé à construire des récits de déni de soi? Est ce qu'il y a d'autres récits qui les contredisant et comment les expliquer? Le phénomène, est-il spécifique à ce groupe? Comment l'expliquer s'il s'agit d'un phénomène généralisé à toute la Kabylie et à tous les berbérophones? Y a t-il une mouvance réfutant ces thèses aliénantes au profil du monde oriental?
Patrimoine et archives
-
Communication orale
Présents et futurs des archives : Archivage proactif avec les communautés québécoises d’expression anglaiseGlenn Patterson (Quebec Anglophone Heritage Network/Reseau de patrimoine anglophone du Quebec)
Cette présentation traite du potentiel de l’archivage proactif et des pratiques qui lui sont associées. Cette approche de l’accès aux archives peut favoriser la transformation de celles-ci – du dépôt « passif » renfermant du matériel de recherche à l’état brut à l’espace de coopération pour une communauté élargie d’intervenants culturels, notamment des membres de la collectivité, des praticiens, des chercheurs, des collectionneurs, des éducateurs et des archivistes. S’appuyant sur son érudition et ses dix années d’expérience dans la mobilisation des Anglo-Québécois à l’égard de l’archivage et de la diffusion de leur patrimoine musical, l’auteur discutera des possibilités d’une participation plus directe des archives dans la création d’une mémoire collective chez les groupes minoritaires.
-
Communication orale
De la vitalité mémorielle au patrimoine documentaire : le travail de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) en soutien aux archives et bibliothèques desservant les CLOSMAlain Roy (Bibliothèque et Archives Canada)
Soutenir l‘épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) pose un défi particulier aux institutions de mémoire telle que Bibliothèque et Archives Canada (BAC). La réponse de BAC se déploie donc sur trois axes.
En premier lieu, il s’agit de définir un fondement conceptuel pour des institutions de mémoire en revisitant le concept de « vitalité » de manière à y inclure la mémoire et le patrimoine et saisir comment une communauté s’inscrit dans le temps, une composante majeure de son identité. Cette mémoire, qui se décline sous diverses formes, devient un vecteur crucial d’épanouissement.
Ensuite, BAC soutient de manière plus significative les organismes impliqués dans le patrimoine documentaire des CLOSM. Deux réseaux, dédiés aux archives et aux bibliothèques, sont en émergence, visant la consolidation de leur rôle comme pôles culturels. Cela a mené à la tenue prochaine d’une conférence nationale pour les archives ainsi qu’à lancer un projet de recherche sur les politiques et normes de bibliothèques. Finalement, le travail sur la vitalité mémorielle conforte le soutien accordé aux collectivités, dont 1,8 millions de $, soit 24% des contributions depuis cinq ans, sont versées aux CLOSM.
Dîner
Enseigner l’histoire : défis et opportunités
-
Communication orale
Développer un cadre pour les projets scolaires et communautaires d’histoire localeBenjamin Loomer (LEARN)
Depuis dix ans, des élèves d’écoles primaires et secondaires anglophones du Québec participent à des projets intergénérationnels qui culminent avec la publication d’ouvrages (papier ou Internet) célébrant divers aspects de l’histoire et du patrimoine des locuteurs de l’anglais d’ici. Ces projets sont conçus par des enseignants et des partenaires communautaires locaux.
Ben Loomer, de l’organisme LEARN, décrit le processus collaboratif régissant ces projets et recense tant ses lacunes déterminantes que les occasions nécessaires au lancement d’un plus grand nombre d’initiatives associant école et communauté. Les projets incitent les jeunes à se lancer dans des recherches sur des mouvements sociaux ou d’importants événements survenus à l’échelon local et les habilitent à approfondir les notions d’identité et de sentiment d’appartenance.
Voici quelques-unes des questions abordées :
- Quels importants événements ou périodes a connus la communauté anglo-québécoise? Comment s’inscrivent-ils dans les récits historiques plus vastes?
- Quelles méthodes et méthodologies serait-il approprié de communiquer aux enseignants et aux étudiants afin de les aider dans leurs recherches de nature historique ou personnelle et dans la rédaction d’un ouvrage?
- Quelles sont les possibilités pour nos partenaires de collaborer efficacement avec les écoles afin de mentorer une nouvelle génération de citoyens actifs s’intéressant au patrimoine local et s’identifiant à la communauté anglophone?
Panel : Patrimoine et mémoire dans les Cantons-de-l’Est
Mémoires et identités
-
Communication orale
Expériences mémorielles et identitaires en AcadieEric Forgues (Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques)
Nous présentons les résultats d'une étude sur le travail de mémoire effectué dans divers lieux historiques en Acadie. Nous avons voulu comprendre les motivations et les objectifs poursuivis par les organisateurs des activités à vocation mémorielle, ainsi que les expériences vécues par les participants à ces activités. Nous avons considéré les activités à vocation mémorielle comme des performances culturelles (Alexander, 2006) qui doivent satisfaire certaines conditions pour être efficaces et produire des effets chez les participants. Nous avons analysé les moyens utilisés pour produire ces performances culturelles à la lumière des objectifs des organisateurs.
L’analyse s’appuie sur des documents provenant des lieux de mémoire étudiés, des entretiens auprès des organisateurs et des visiteurs, ainsi que des observations directes. Elle montre que les lieux de mémoire offrent un cadre pour « mettre en scène » le passé acadien, grâce à des performances qui mêlent, dans certains cas, faits historiques et fiction, donnant lieu à des constructions symboliques inscrivant le présent dans une trame historique. Ces mises en scène font vivre des expériences significatives chez les participants, notamment sur le plan identitaire. -
Communication orale
Identités fantômes : l’impact de la structure de peuplement sur la mémoire locale et l’action collective (comté de Kent, Nouveau-Brunswick)Mathieu Wade (Université de Moncton)
Le comté de Kent (N.-B) est l’un des plus ruraux et des moins densément peuplés dans la province. Aucune agglomération n’y excède 2 500 habitants, près de 70 % de la population habite des territoires non-incorporés et ce comté majoritairement acadien figura longtemps parmi les plus pauvres et les moins scolarisés au pays.
- Je proposerai de penser la structure de peuplement du comté de Kent comme un patrimoine et je tenterai de lier ce patrimoine à la vitalité de ses communautés.
- Je présenterai les liens historiques entre la structure de peuplement et le modèle économique du territoire. Les circuits d’exportation coloniaux ont profondément influencé l’aménagement du territoire, les politiques de peuplement et l’idéologie nationale acadienne.
- Je présenterai les formes de communautés qui se sont constituées au sein de cette structure de peuplement, notamment en proposant une synthèse de l’importante production amatrice de monographies d’histoire locale.
- J’avancerai que ce patrimoine territorial a créé des identités fantômes qui, comme un membre fantôme, peuvent toujours être ressenties, bien qu’elles aient perdu la capacité de faire.
-
Communication orale
Une initiative d'histoire sociale pour saisir les efforts de changement social dans la communauté noire de Montréal, 1970-2020Kevin George (CLSC St Henri), Leith Hamilton (Partnerships for Social Change in Minority Communities)
Les membres de la communauté noire de Montréal doivent acquérir le pouvoir politico-institutionnel nécessaire à la valorisation de la vie des Noirs et à l’essor de leurs collectivités au Québec et au Canada. Le projet Oral History of Social Change Efforts in the Black Community 1970-2020 (« histoire orale des efforts de changement social dans la communauté noire, 1970-2020 ») vise à cerner cette question et à préciser les avancées réalisées, les insuccès subis et les points à améliorer. Des discussions réuniront pour la première fois des aînés ayant participé au renforcement communautaire et à la lutte contre le racisme, des leaders organisationnels montants et des jeunes et des étudiants avides de contribuer au développement de la communauté. Il en émergera la définition d’un avenir qui, souhaitons-le, promouvra des actions durables et efficaces en matière de changement social. Les récits seront communiqués lors d’un colloque communautaire au moyen de diverses stratégies de diffusion. Ils permettront d’énoncer les éléments ayant favorisé l’engagement d’un vaste segment de la population noire en matière de changement : forces, valeurs, contextes démocratique et participatif, richesse culturelle et patrimoine spirituel de l’Église noire. Rappelons que la plupart des actions pour le changement n’ont pas été consignées. Enfin, nous chercherons à apprendre des leçons tirées de l’exercice et à bâtir un avenir idéal pour les efforts visant l’évolution de la société.
-
Communication orale
Entre héritage et modernité : le cas des jeunes issus de la communauté anglophone du Bas-Saint-LaurentEmanuele Lucia (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
On peut retracer l’apparition de l’anglais au Bas-Saint-Laurent au début du 19e siècle avec l’arrivée d’une quarantaine de familles écossaises au village de Metis Beach, et quelques décennies plus tard avec l’arrivée de résidents d’été anglophones. En 2016, la minorité anglophone permanente dans tout le Bas-Saint-Laurent s’élevait à 1 225 personnes. Par contre, le village de Métis-sur-Mer est encore un important lieu de villégiature anglophone l’été dans la région, et est souvent défini comme le noyau de la minorité linguistique au Bas-Saint-Laurent, même si la communauté anglophone permanente est répartie sur l’ensemble du territoire bas-laurentien. Nous avons effectué des entretiens avec des jeunes anglophones et bilingues ayant entre 16 et 25 ans résidents permanents de la région afin d’effectuer un portrait de la communauté actuelle, notamment en termes d’identité et de sentiment d’appartenance. Les jeunes démontrent une appartenance et une identité plurielles et plus éclatées qu’elles ne pouvaient l’être chez la génération plus vieille. Ils reconnaissent et participent au sein de la communauté anglophone historique, liée à Métis-sur-Mer et son héritage, mais ont des pratiques linguistiques plus contemporaines qui contribuent à la création d’une communauté anglophone contemporaine plus diverse. Ces jeunes conservent, mais renouvellent en même temps la communauté avec leurs pratiques territoriales et linguistiques particulières.
Projets de construction identitaire au Canada français
-
Communication orale
Rencontre du passé et du présent migratoire : émergence du récit identitaire franco-yukonnais en milieu minoritaire à travers une recherche intervention en art.Marie-Hélène Comeau (Travailleuse autonome)
Ma présentation fait appel à la transmission du patrimoine et de la mémoire d’une jeune communauté francophone minoritaire du Nord encrée dans un contexte migratoire. Pour ce, je me réfèrerai aux résultats de ma récente recherche intervention en art menée en Études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal. Cette recherche qualitative a permis l’utilisation d’une approche flexible par l’entremise de l’art (Audi, 2010; Dewey, 1915/2005), tout en initiant une réflexion identitaire sur l’histoire passée et présente des individus dans un contexte de partage et d’écoute.
Ainsi, des participantes franco-yukonnaises ont pu transmettre leur micro-récit en vivant une expérience de l’ordre du processus de création unissant le passé de leur lieu d’origine au présent yukonnais. En faisant appel aux émotions et au sens (Gosselin et al., 1998, Dewey, 2005) du passage identitaire raconté dans l’œuvre (Sibony, 2005), l’art en milieu minoritaire s’est imposé dans cette recherche comme un moyen d’accès privilégié au patrimoine communautaire en favorisant l’émergence et la transmission des histoires de l’intime de chacun (Hegyi, 2009; Lyotard, 1984; Ricœur, 1983, 1990; Thibeault, 2015).
-
Communication orale
PassepART: une nouvelle initiative de microfinancement misant sur les arts, la culture et le patrimoine comme vecteur d’identité et de sécurité linguistique et culturelleAnnette Boudreau (Fédération culturelle canadienne-française), Hélène Guillemette (Fédération culturelle canadienne française (FCCF)), Marie-Christine Morin (Fédération culturelle canadienne-française)
La participation à des activités artistiques, culturelles et patrimoniales contribuerait-elle à consolider l’identité francophone, le sentiment d'appartenance à la communauté francophone et l'ouverture à l’autre? Plus encore, est-ce que l'art, la culture et le patrimoine agissent sur la sécurité linguistique et culturelle des francophones en situation minoritaire? C'est ce que nous comptons examiner en prenant l'exemple du programme PassepART, un programme national de microfinancement qui vise à offrir plus d’activités artistiques, culturelles et patrimoniales aux 700 écoles francophones en situation minoritaire, de la maternelle à la 12e année.
La communication permettra aussi de démontrer l’importance de partir du « terrain » afin d'assurer que le mécanisme de livraison du programme soit arrimé aux attentes et aux besoins des organismes communautaires et des partenaires du milieu scolaire. Ce mécanisme de livraison agile est d'ailleurs un trait distinctif du programme puisqu'il fournit une infrastructure facilitant la communication et la collaboration entre le milieu scolaire et le milieu des arts, de la culture et du patrimoine, et ce, afin de mieux répondre aux besoins des élèves francophones en situation minoritaire. -
Communication orale
Inscription du littéraire et vestiges du patrimoine bâti dans la conception de la Place des Arts du Grand SudburyStéphane Gauthier (Le Carrefour francophone de Sudbury)
Le projet d’un «lieu culturel rassembleur» dans la capitale du nickel est né d’une mobilisation du ROCS (Regroupement des organismes culturels du Grand Sudbury). Conscient de bâtir une maison de la francophonie au cœur d’un plan d’aménagement urbain, le regroupement a conçu un centre de diffusion et d'excellence artistique sous l'appellation de Place des arts du Grand Sudbury.
Comment ce projet d'envergure est passé de rêve improbable à une œuvre de mémoire, en dialogue avec l'imaginaire du Nouvel-Ontario et des vestiges du patrimoine matériel?
Voici un extrait de la métaphore fournie aux architectes:
Ainsi il faut imaginer un bâti qui surgit du paysage comme si certaines formes avaient toujours été là, naturellement, faisant partie du tissu urbain. Comme « la roche enceinte de sainte poésie » (Patrice Desbiens). Mais aussi comme le fruit d’un impact, d’un big bang culturel dont l’onde féconde continue de s’étendre comme une réverbération, comme une filiation, d’hier à demain.
Œuvre-symbole, positionnée comme un pôle touristique, la Place des arts sera achevée en décembre 2020. En ses murs, y seront enchevêtrées l’histoire de la ville, de la présence française et du mouvement culturel du Nouvel-Ontario.
Dîner
Seigneurs, religieuses et habitants : du passé au présent
-
Communication orale
Patrimoine canadien de santé au féminin, entre éthiques féminine et religieuseBoniface Bahi (University of Alberta)
Un examen de la mission des Sœurs Grises dans l’Ouest canadien révèle une œuvre socio-sanitaire de grande envergure. La genèse sociale du système hospitalier de l’Ouest canadien et du Nord de l’Ontario, porte leur signature historique. Le tout semble reposé sur une éthique dite féminine et cette autre religieuse. Ce sont plus des causes sociales qui fondent l’engagement des pionnières du mouvement que le couvert religieux. La transmutation de leur projet initial en une d’ingénierie socio-sanitaire qui maintient et entretient le français dans l’Ouest canadien, s’actualise de nos jours. C’est à travers l’élaboration de nouvelles stratégies sanitaires pour une meilleure santé communautaire pour tous. Héritière, la Corporation de la Santé du Manitoba tient et gère l’œuvre sanitaire et hospitalier reçu des Sœurs-Grises.
L’objectif recherché est de mettre en relief une contribution majeure des femmes dans l’édification socio-sanitaire de la fédération canadienne et de l’actualité de cette contribution. La démarche liée à notre étude en voie de publication est ethno-épidémiologique. Elle se double d’une recherche documentaire relative aux sources historiques liées.
-
Communication orale
Mémoires de familles seigneuriales anglophones du Québec : de l’altérité à la bonne ententeBenoit Grenier (UdeS - Université de Sherbrooke)
Dès la conquête, la minorité britannique en sol québécois s’est intéressée à la propriété seigneuriale et celle-ci possède près de 50% des fiefs au moment de l’abolition (1854). Les propriétaires seigneuriaux de souche anglo-protestante constituent donc une quasi «majorité» au sein du groupe, mais ils n’en demeurent pas moins une composante de la minorité linguistique et culturelle «anglaise» du Québec. Ces familles incarnent une figure d’altérité, tant sur le plan socio-économique que linguistique et religieux. Comment composaient-elles avec la population majoritairement canadienne-française et catholique? Quelles solidarités se tissaient avec les autres familles seigneuriales, d’ascendance française? Et quelle mémoire ont-elles conservé et transmise? Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une enquête d’histoire orale menée auprès des descendants de familles seigneuriales du Québec, tant francophones qu'anglophones. Il en a résulté une idéalisation, voire une folklorisation, de la relation seigneur/censitaire, loin des conflits que révèlent les archives, mais aussi une affirmation de valeurs élitaires communes marquées par le bilinguisme et le biculturalisme, valeurs transmises jusqu’à nos jours à leurs descendants.
Conférencière d’honneur
-
Communication orale
« Vous n’avez pas d’histoire » : la passion, contre-récit patrimonial, historique et archivistiqueDorothy Williams (DaCosta-Angelique Institute)
Axé sur la réappropriation et la diffusion de l’histoire des communautés noires anglophones du Québec et du Canada, cet exposé décrit mon incessant parcours comme historienne, militante du patrimoine et bibliothécaire-archiviste.
J’évoquerai notamment le processus d’écriture de mes trois ouvrages innovants : Blacks in Montreal 1628-1986: An Urban Demography et sa traduction, Les Noirs à Montréal, 1628-1986 : essai de démographie urbaine, parus respectivement en 1989 et en 1998, ainsi que The Road to Now: A History of Blacks in Montreal (« la route jusqu’ici : histoire des Noirs montréalais »), publié en 1997. De même, je ferai référence à plusieurs dizaines d’articles.