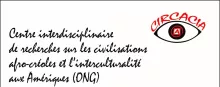Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Ce colloque s’inscrit dans une perspective critique, décoloniale et pluriverselle, et vise à réfléchir aux savoirs, pratiques et expertises des communautés engagées dans les programmes de développement international. Il s’agit également de mettre de l’avant des perspectives plurielles (sociologique, anthropologique, politique, culturelle, géographique, économique, philosophique) pour permettre une meilleure compréhension des enjeux et des défis liés à la prise en compte des savoirs traditionnels dans les projets de développement international.
Pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques actuels, les organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux (ONG) tentent de mettre en place (ou de renforcer) des modes de gestion et de gouvernance environnementale « plus durables », en lien avec les agendas internationaux. Toutefois, les communautés engagées dans ces programmes disposent déjà de savoirs en lien avec leurs territoires, avec les ressources qui s’y trouvent, ainsi qu’avec les façons d’entrer en relation avec ceux-ci. Aussi ce constat ne peut-il manquer d’aboutir à une réflexion critique sur les relations entre, d’une part, les programmes des bailleurs de fonds et de leurs organismes partenaires et, d’autre part, les connaissances et les expertises des communautés sur leurs propres réalités territoriales.
Sur le plan politique, de nombreuses conventions reconnaissent que les communautés autochtones et locales dépendent très étroitement de leur environnement naturel et des ressources matérielles et immatérielles qui en sont issues. Elles reconnaissent aussi que plusieurs territoires sont protégés, conservés et gérés durablement grâce aux savoir-faire que les communautés locales ont su développer. En 1993, la Convention sur la diversité biologique (CDB) a considéré les savoirs traditionnels comme un patrimoine commun de l’humanité et a proposé, avec le protocole de Nagoya qui s’en est suivi, un partage équitable des avantages découlant de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique. Dans cette optique, les savoirs traditionnels feraient référence aux « connaissances, pratiques et philosophies développées par des sociétés ayant une longue histoire d’interaction avec leur environnement naturel » (UNESCO, Savoirs locaux, objectifs globaux, 2017, p. 1).
Remerciements :Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Programme de coopération climatique internationale du Québec
Centre interdisciplinaire de recherches sur les cultures autochtones, créoles et l'interculturalité aux Amériques (CIRCACIA) Cayenne, Guyane
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Marie Fall (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
- Montserrat Fitó (EHESS, Paris - CIRCACIA, Cayenne)
- Mathilde Gouin-Bonenfant (University of Cambridge)
Programme
Session d'ouverture
-
Communication orale
Mot de bienvenueMarie Fall (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
-
Communication orale
Conférence plénière : Différentes approches de la décolonialitéMontserrat Fitó
L'essai au titre et au sous-titre expressifs : Peau blanche, masques noirs. Critique de la raison décoloniale (Gaussens et Makaran, 2020) analyse et contredit certains aspects théoriques notables des études décoloniales. Il marque ainsi un contrepoint au "tournant décolonial" revendiqué par, entre autres, Castro Gómez et Grosfoguel (2007). Notre conférence d'ouverture reviendra sur les arguments exposés dans le débat sur la distinction entre "pensée décoloniale", "question décoloniale" et tournant décolonial", convoquant tant les auteur.e.s concerné.e.s par ces notions que celles et ceux ici et là évoqués, comme c'est par exemple le cas de Frantz Fanon. Nous interrogerons la pertinence des modèles de pensée proposés, selon une approche interculturelle du raisonnement.
Entre savoirs scientifiques et savoirs locaux : reconnaissance et autorité
-
Communication orale
Enjeux épistémologiques autour de la catégorisation des savoirs "traditionnels" et scientifiquesMathilde Gouin-Bonenfant (University of Cambridge)
Cette communication s’intéressera aux enjeux épistémologiques autour de la catégorisation des savoirs dits traditionnels et de ceux considérés comme scientifiques. Je présenterai premièrement différentes critiques de cette dichotomie au niveau théorique (Agrawal, 1995; Ellen, 2004; Harding, 1997). Puis, me basant sur mes recherches doctorales en cours au Sénégal, j’ancrerai ces critiques dans la pratique et, plus précisément, dans la question de la reconnaissance et de la valorisation des savoirs dits traditionnels dans les projets de coopération internationale à portée environnementale. Je présenterai des façons alternatives de situer différentes formes de savoirs dans l’écosystème de relations dans lequel s’inscrivent les ONG environnementales.
-
Communication orale
Savoirs traditionnels matrimoniaux et patrimoniaux : véhicules de l’apprentissage dans les milieux éducatifs et sociauxRégine Dondon-Zou (Université des Antilles)
Le jardin créole aux Antilles françaises est un héritage culturel vivant, investi tant par les professeur.e.s du premier degré que par les professeur.e.s du second degré dans différentes disciplines. Lieu et vecteur d’apprentissages, tant de la part des acteurs de la société civile que des institutions, il permet aussi la satisfaction de besoins économiques, culturels et sociaux. Le caractère patrimonial de cet agrosystème en fait un dépositaire des savoirs locaux. Nombre de ces savoirs sont scientifiquement valorisés : reconnus comme pratiques agro-écologiques et comme ressources pour la prévention en matière de santé. Une impulsion concerne le jardin créole comme patrimoine, ce qui rend nécessaire l’objectivation des enjeux, des motivations et des pratiques à l’œuvre, ainsi que l’appropriation de cet objet d’enseignement dans ses dimensions physique et épistémique. L’introduction des savoirs locaux sur le jardin créole dans les savoirs enseignés et les projets déployés par des professeur.e.s est ici étudiée. L’analyse des retours d’expérience permettra de définir les objectifs poursuivis, notamment l’explicitation du caractère ancestral de certains de ces savoirs. Ce travail donne une place notable aux éducations transversales comme l’éducation au développement durable, à la citoyenneté et à la santé.
-
Communication orale
Savoirs traditionnels et conservation de la biodiversité au Gabon : entre marginalisation, reconnaissance et valorisationSosthène Ibouanga (Université Côté d'Azur)
La conservation de la nature n’est pas un concept nouveau. Bien entendu, il varie selon les représentations, les savoirs et les pratiques culturelles des acteurs. Au Gabon, et plus précisément dans les parcs nationaux, les populations locales ont su développer de longue date les connaissances endogènes relatives à la conservation de la biodiversité. Longtemps dévalorisés, ces savoirs locaux ont connu un regain depuis la convention de Rio (1992). Désormais, et face aux limites des savoirs scientifiques, les savoirs locaux acquièrent une place essentielle dans les projets de conservation de la biodiversité.
Dans cette étude, nous proposons d’examiner la place des savoirs locaux à l’exemple du projet de conservation de la biodiversité en forêt tropicale à travers la coexistence durable entre l’humain et l’animal (PROCOBHA) dans le parc de Moukalaba-Doudou, et d’analyser dans quelle mesure les pratiques culturelles autant que les savoirs scientifiques participent durablement à la conservation de la biodiversité. Par la démarche méthodologique : recherche documentaire et enquêtes ethnographiques, nous montrerons que les connaissances des populations locales sur leur milieu naturel passent par des médias marginaux comme les contes, les légendes et les croyances (totems, forêts rituelles). Ceux-ci les sensibilisent au quotidien et leur permettent de pérenniser la biodiversité : une attitude qui dénote leur participation à cette conservation durable et qui prend des formes méconnues.
Pause dîner
Approches innovantes dans la valorisation des savoirs traditionnels
-
Communication orale
Apport de la géographie culturelle dans la valorisation des savoirs traditionnels dans les activités agricoles, la santé et la préservation de l’environnement, exemple des communesAminata Diop (Université Cheikh Anta Diop)
Le Sénégal est marqué par une grande pluralité culturelle et les sociétés ont su capitaliser un important stock de savoirs traditionnels ayant permis le développement d’activités diversifiées indispensables à leur survie et à leur épanouissement. Cette étude a été menée dans deux localités du Sénégal présentant des différences environnementales et culturelles : il s’agit de la commune de Dagana au nord du pays et de celle de Suelle au sud. L’objectif est de montrer la place de la géographie culturelle dans l’explication de l’apport des savoirs traditionnels dans la santé, dans le déroulement des activités agricoles et dans la protection de la biodiversité. Les entretiens menés avec des personnes-ressources ont fait ressortir la capacité d’agir sur les phénomènes naturels dans les deux localités. La détention des savoirs traditionnels était familiale et les savoirs sont fortement influencés par l’Islam dans le nord. Les rendements (agricoles et cynégétiques) étaient tributaires des savoirs traditionnels dans le sud. La maîtrise de ces savoirs, tributaire des caractéristiques naturelles et culturelles, repose sur la capacité de mettre en synergie des facteurs géographiques (orientations, mouvements du soleil, direction du vents). Dans les deux localités, des pratiques cultuelles sont mises en œuvre pour protéger la biodiversité. Cependant ces savoirs traditionnels sont menacés par les changements climatiques, l’urbanisation et la scolarisation.
-
Communication orale
La recherche engagée au service des communautés : la transversalité et la pluriversalité comme paradigmes épistémologiquesMarie Fall (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
La recherche engagée au service des communautés exige, à quelques occasions, de porter plusieurs casquettes : chercheure, conseillère, administratrice, gestionnaire, leader communautaire, militante, etc. Les savoirs reçus et/ou développés au cours d’une recherche engagée font appel à des attentions toutes particulières. Dans bien des cas, le pluralisme institutionnel, l’intersectionnel, l’interculturel, l’interconnaissance, l’interdisciplinarité et l’interaction deviennent des enjeux transversaux qui finissent par imposer de nouveaux paradigmes : la transversalité et la pluriversalité.
La recherche engagée représente, dans bien des cas, la réponse la plus fréquente à la volonté de réaliser des apprentissages auprès des communautés et apprendre d’elles des savoirs et des expertises à partager avec le monde entier. Il est alors plus que nécessaire de se questionner sur la manière dont les concepts sont définis et s’ils sont représentatifs de toutes les réalités des communautés. Comment contribuer à la production des normes qui reflètent les aspirations et répondent aux besoins réels des communautés ? Comment construire des savoirs dans un monde appréhendé de manière si différente d’un endroit à l’autre, d’une communauté à l’autre, d’une personne avec des perspectives si diversifiées ? Quelles méthodes de recherche privilégier pour une meilleure hybridation des savoirs issus des interactions avec les communautés ? Autant de questions pertinentes qui méritent des réponses.
Synthèse de la journée
L'essai au sous-titre expressif : "critique de la raison décoloniale" (Gaussens et Makaran, 2020) analyse et contredit certains aspects théoriques notables des études décoloniales. Il marque ainsi un contrepoint au "tournant décolonial" (Castro Gómez et Grosfoguel, 2007). Ce panel reviendra sur les arguments exposés lors de la conférence d'ouverture, convoquant tant les auteur.e.s concerné.e.s par l'un et l'autre des ouvrages mentionnés, que celles et ceux ici et là évoqués, comme c'est par exemple le cas de Frantz Fanon. Nous interrogerons la pertinence des modèles de pensée proposés, selon une approche interculturelle du raisonnement.
Perspectives politiques, organisation et administration publique
-
Communication orale
Co-construction de la résilience socio-écologique et gestion durable du bassin versant de la rivière Mulet, HaïtiZurcher Mardy, Sebastian Weissenberger (UQAM)
En Haïti, la dégradation des bassins versants représente un sérieux problème environnemental. Le bassin versant Mulet, dans le département du Sud, est caractéristique de cette situation : il connaît de sérieux problèmes de dégradation affectant les conditions de vie des communautés locales et l’équilibre des écosystèmes naturels. À l’aide d’un projet de recherche-action participative (RAP) permettant aux communautés locales d’exprimer leurs préoccupations et de valoriser leurs savoirs traditionnels et locaux, nous avons co-construit des stratégies visant à renforcer la résilience socio-écologique du bassin versant. La mise en œuvre de l’approche de RAP procède par la documentation du processus de dégradation du bassin versant et l’évaluation des mesures de conservation et de restauration identifiées par les acteurs/trices engagé.e.s. Les mesures retenues relèvent de pratiques traditionnelles et locales, résultant d’un bon niveau d’accord entre les acteurs intervenant dans le territoire. Cette démarche favorise la transparence et une meilleure appropriation des connaissances et des résultats du projet par les communautés locales. Nous pouvons conclure que l’aspect participatif et les connaissances traditionnelles et locales sont essentiels dans la définition des stratégies de gestion durable des bassins versants dans le contexte haïtien, car les communautés locales sont plus enclines à s’approprier des techniques de conservation et de restauration découlant de leur milieu.
-
Communication orale
Valoriser les savoirs traditionnels pour mieux innoverBénédicte Marie Louise Aly Séne (Université Cheikh Anta Diop)
Les savoirs traditionnels des communautés sont au cœur des actions de conservation. Ils permettent une nouvelle orientation des productions locales qui participent au bien-être, surtout nutritionnel, des communautés. La production locale d’aliments est issue de savoirs et de savoirs locaux modernisés sous l’influence soutenue de la mondialisation. Le secteur de la transformation artisanale du poisson au Sénégal en est un exemple, au regard des savoirs en matière de conservation développé par les femmes. En effet, le Sénégal est un des plus grands producteurs de poisson en Afrique de l’Ouest. Vers les années 1950, les surplus de poisson étaient séchés puis échangés contre des denrées alimentaires le long du littoral. Aujourd’hui cette activité est à l’origine d’une importante économie. Son développement s’accompagne par l’introduction de nouvelles technologies de transformation dont l’acceptation varie selon le niveau d’implication des femmes dans la conduite des projets d’innovation.
Cette étude réalisée dans les sites de transformation de Saint-Louis, Rufisque, Joal, Kayar et Bassoul adopte une méthodologie essentiellement quantitative basée sur une approche participative. Le questionnaire administré à 128 transformatrices a permis de collecter les informations sur les différentes innovations entreprises, l’engagement des femmes à innover et les échecs essuyés.
-
Communication orale
Adaptation aux changements climatiques et prise en compte des savoirs et connaissances traditionnels : à partir du cas de la commune de Sô-Ava, BéninDossa Hyppolite Dansou (Université Laval)
Face aux effets des changements climatiques (CC), les experts de la COP 21 et de la COP 22 recommandent de se tourner vers des solutions locales en privilégiant des approches multi-sectorielles y compris celles des populations locales. Cette recommandation, en replaçant ces populations au cœur des solutions d’adaptation/atténuation, met ainsi l’accent sur leurs savoirs et connaissances traditionnels pour la préservation de l’environnement. Aussi importe-t-il de s'interroger sur ces savoirs, sur leur place dans la société.
Aussi cette communication part-elle du cas d’une commune lacustre du sud Bénin (Sô-Ava) qui, à travers un projet d’adaptation aux CC financé par le Fonds Vert du Québec, a non seulement mobilisé des partenaires nationaux et internationaux aux compétences variées, mais aussi et surtout des savoirs traditionnels en environnement (caractère rituel de certaines plantes, protection des mangroves, etc.) des populations pour atteindre les objectifs du projet. Ceci a favorisé une meilleure participation de toutes les actrices et tous les acteurs inclus.e.s dans le projet avec une efficacité et une efficience dans l’atteinte des résultats.
Le cas de Sô-Ava, en soulignant la collaboration entre divers acteurs au profit des solutions d’adaptations aux CC, met en exergue la nécessaire prise en compte des savoirs et des connaissances traditionnels locaux pour une meilleure appropriation et une plus grande réussite dans les projets nationaux et internationaux.
-
Communication orale
S’appuyer sur les connaissances et savoir-faire locaux pour penser la gestion de la pêche en HaïtiSamson Jean Marie (Ministère de la Transition Écologique / Caribea Initiative)
L’activité de la pêche occupe une place très importante dans l’économie nationale. Elle compte pour 13.6% du PIB et contribue fortement au revenu de ses pratiquants, soit environ 52.000 pêcheurs et 60.000 autres bénéficiaires. De surcroît, elle joue des rôles multiples : alimentaire, social, environnemental (Saffache, 2006). Cependant, la ressource a toujours été exploitée de façon opportuniste. Malgré leurs grandes capacités d’adaptation, les pêcheurs s’inquiètent de la diminution de leurs prises et ne parviennent plus toujours à nourrir leurs familles.
Dans ce contexte, le pays s’est engagé dans une réflexion sur sa politique des pêches qui tient compte tant des savoirs que des pratiques des communautés de pêcheurs encore peu valorisés. Une recherche ethnographique a été menée auprès de 260 personnes impliquées dans la filière (63 femmes et 197 hommes) dans la région sud du pays, pour décrire les pratiques privilégiées des pêcheurs, rendre compte des valeurs, savoirs et savoir-faire locaux afin de favoriser leurs activités et organiser la gestion des territoires.
Le travail de terrain a permis de constater leur adaptabilité et leur inventivité dans les pratiques, notamment dans le choix des matériaux pour fabriquer les engins, mais aussi dans la constitution de modes de gestion pour accéder aux territoires marins et à l’ensemble de la filière. Les nombreux savoirs des pêcheurs gagneraient à être le support des politiques des pêches.
-
Communication orale
Analyse anthropologique du rapport entre conservation et préservation : nature et cultureMontserrat Fitó (EHESS, Paris - CIRCACIA, Cayenne)
Notre communication interrogera, depuis l’anthropologique critique, le rapport entre « conservation » et « préservation ». À partir de faits anthropologiques principalement observés en Guyane française, où réside l’auteure, mais également dans d’autres territoires et/ou pays, nous montrerons que le rapport entre les deux notions devient contraste, sinon contradiction et pourquoi. La familiarité avec des auteur.e.s comme Martine Chalvet, historienne de l’environnement et Guillermo Bonfil Batalla, anthropologue mexicain théoricien du contrôle culturel, enrichissent le débat ici proposé.
-
Communication orale
Entre savoirs traditionnels et savoirs scientifiques : enjeux pour la transition agro-écologique dans la CaraïbeHarry Ozier-Lafontaine (INRAE)
L’agriculture conventionnelle intensive héritée du système de plantation aux Antilles est aujourd’hui dans l’impasse. Face aux enjeux de sortie des pesticides (Loi d’Avenir, 2014), d’adaptation au changement climatique (GIEC, 2022) et de sécurité alimentaire (Loi EGALIM, 2018), il est impérieux d’engager des dynamiques innovantes autour d’une transition agroécologique inclusive et vertueuse. Le défi de l’hybridation des savoirs traditionnels et scientifiques, au sein de démarches participatives, prend ici tout son sens, si l’on veut produire de l’innovation appropriable par les bénéficiaires, tout en étant écologiquement, socialement et économiquement soutenable. La recherche agronomique s’inscrit dans cette nouvelle orientation (INRAE 2030). À travers deux exemples : i) la traque aux innovations pour des alternatives de régulation de la fourmi manioc, bio-agresseur majeur des productions végétales en Guadeloupe ; ii) la mise en œuvre d’un réseau de plateformes de laboratoires vivants dans la Caraïbe/Amazonie au sein du projet CambioNet (INTERREG V), nous illustrons les stratégies mises en œuvre pour faciliter la fertilisation croisée entre savoirs traditionnels et savoirs scientifiques, au bénéfice de la transition agro-écologique. Ces initiatives traduisent les changements d’attitude requis pour aborder ces nouveaux défis.