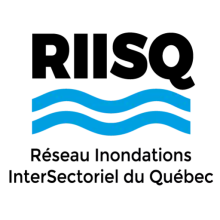Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :Des risques à réévaluer
2023 est l’année des records. Record des températures d’abord : juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde avec 0,51 degré au-dessus de la moyenne 1991-2020. Des sécheresses, ensuite : l’Europe a connu une sécheresse historique durant l’été 2023. Des incendies, enfin : à la mi-août, le Canada enregistre plus de 14 millions d’hectares de surface brûlée, dont plus de 700 000 hectares pour le Québec, selon la SOPFEU à la même période. Pourtant, le Canada est un précurseur dans la prévision du risque d’incendies de forêt avec l’indice forêt-météo, de Ressources naturelles Canada, qui évalue le risque d’incendie sur une base quotidienne. Le calcul du risque est renforcé par une couverture satellitaire des points chauds partout au pays, avec à la clé une cartographie du risque. Mais le Canada est un pays de forêts, et la forêt est à la fois victime des incendies et vecteur, car elle fournit elle-même le carburant (combustible). Paradoxalement, c’est la zone nordique qui est la plus touchée. Le 15 août, la Ville de Yellowknife, au nord du 62e parallèle, ordonne l’évacuation de ses 20 000 habitants en raison de menaces d’incendies. Les conditions météorologiques y étaient favorables à cause de la sécheresse qui a sévi. Les causes des incendies sont pour plus de 80 % d’origine naturelle (foudre). En juin déjà, un grand nombre de foyers sont déclarés incontrôlables. Faut-il revoir l’indice forêt-météo à la lumière des changements climatiques? Les défis demeurent énormes aussi sur les plans de la prévention et de l’adaptation à ces risques, et les recherches doivent mettre l’accent sur ces aspects.
Les recherches devraient se poursuivre également sur d’autres risques, plus récurrents. La cartographie des zones inondables, par exemple, est à parfaire, et les modèles de prévision sur les périodes de retour des crues extrêmes, à améliorer.
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Mustapha Kebiche (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Philippe Gachon (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Thomas Buffin-Bélanger (UQAR - Université du Québec à Rimouski)
- Pascal Bernatchez (UQAR - Université du Québec à Rimouski)
Programme
Connaissance des aléas I
-
Communication orale
Un réveil collectif pour le secteur forestier québécoisYan Boulanger (CFL - Centre de foresterie des Laurentides), Jonathan Boucher (Centre de Foresterie des Laurentides, Canadian Forest Service, Natural Resources Canada, Qc, Canada), Clémence Benoit (Étude et Simulation du Climat à l’Échelle Régionale (ESCER), Université du Québec à Montréal, Montréal, Qc, Canada), Philippe Gachon (Étude et Simulation du Climat à l’Échelle Régionale (ESCER), Université du Québec à Montréal, Montréal, Qc, Canada)
2023 a été l’année de tous les extrêmes climatiques dans le monde mais particulièrement au Canada et au Québec. En effet, les feux de forêt y ont consumé des superficies records, alimentés par des conditions météos tout aussi extrêmes. Bien que projetée par la communauté scientifique depuis plusieurs années, cette situation fut un choc pour plusieurs. Les impacts de ces feux de même que de ceux projetés dans les prochaines décennies ont été et seront particulièrement importants et ce, pour divers pans de la société. Le secteur forestier mais aussi les communautés, les infrastructures, les Premières Nations et la biodiversité subissent et subiront les conséquences de l’augmentation de l’activité des feux en raison des changements climatiques. L’adaptation sera nécessaire afin de rendre les forêts plus résistantes et plus résilientes au feu, pour mieux protéger les communautés, notamment celles situées en milieu boréal, de mieux protéger notre patrimoine naturel et de rendre l’industrie forestière plus résiliente aux changements.
-
Communication orale
Évaluation des conditions météorologiques et atmosphériques à l'origine des feux de forêt exceptionnels de 2023 au QuébecClémence Benoit (UQAM - Université du Québec à Montréal), Yan Boulanger Yan Boulanger (Centre de Foresterie des Laurentides, Canadian Forest Service, Natural Resources Canada), Jonathan Boucher (Centre de Foresterie des Laurentides, Canadian Forest Service, Natural Resources Canada), Philippe Gachon (Étude et Simulation du Climat à l’Échelle Régionale (ESCER), Université du Québec à Montréal)
Durant la saison de feux de 2023 au Québec, les conditions météorologiques exceptionnelles furent à l’origine de feux majeurs, brûlant près de 4,5 millions d'hectares de forêt, soit le double du précédent record de 1989. Cette étude permettra de dresser un portrait des conditions qui ont mené à ces feux de grande envergure, et établira le caractère exceptionnel des anomalies chaudes et sèches et des indices forêts-météo, durant la période de mai à octobre au sein de la forêt boréale. Différents produits provenant de réanalyse et de simulations du modèle régional du climat à haute résolution, développé au centre ESCER de l’UQAM, seront utilisés afin de dresser un portrait régional d’ensemble de la saison de feux de 2023. Une analyse des liens avec les caractéristiques de blocages atmosphériques à l’origine des situations persistantes de temps chauds et secs dans le nord du Québec sera également présentée. Les travaux en cours afin d’évaluer les modifications du régime de feux de forêt au Québec, dans le contexte des changements climatiques, seront également brièvement présentés.
-
Communication orale
Variabilité spatiale des courbes IDF issues du CMIP6 pour l’Est du CanadaSalah El Adlouni (Université de Moncton), Wafaa El Hannoun (Département de mathématiques, Université Mohamed V, Rabat), Abdelhak Zoglat (Département de mathématiques, Université Mohamed V, Rabat)
Plusieurs régions du Canada ont enregistré des précipitations record au cours des deux dernières années. Dans cette étude, nous avons analysé les effets de ces nouvelles observations sur les estimations des courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF). Les séries d’observations historiques ont été combinées aux derniers enregistrements et comparées aux sorties des scénarios climatiques des modèles climatiques mondiaux (MCM) de la phase 6 du projet d'inter-comparaison de modèles couplés (CMIP6). Les résultats confirment l’augmentation du risque associé aux intensités extrêmes surtout pour les faibles durées en régions côtières.
Dîner
Connaissance des aléas II
-
Communication orale
Tendances multivariées des crues au CanadaFateh Chebana (INRS - Institut national de la recherche scientifique), Dorsaf Goutali (INRS - Institut national de la recherche scientifique)
Les impacts du changement climatique (CC) sur les régimes hydrologiques sont très préoccupants. Les crues comptent parmi les événements hydrologiques les plus importants, en termes de pertes humaines et de coûts économiques. A cause du CC entre autres, la fréquence et l’intensité des crues seront en hausse. De plus, les crues sont considérées comme des événements multivariés décrits par leurs pointe et volume parmi d’autres variables dépendantes. Par conséquent, un cadre multivarié est nécessaire pour traiter les différentes composantes des tendances des crues. Notre objectif est d'étudier les tendances des crues au Canada. Plus de 140 stations hydrométriques avec des enregistrements sur une période commune de 45 ans sont analysées. Les tendances spatiales des séries de crues sont étudiées à l'aide de tests de tendances statistiques univariés et multivariés. En particulier, des tests de tendance multivariés récemment développés sont appliqués pour mieux identifier les composants affectés (volume, pointe, leur dépendance ou toute combinaison de ceux-ci). Les résultats de cette étude sont présentés dans différentes cartes pour une meilleure visualisation. Cette étude peut être menée dans d'autres régions et/ou d'autres événements hydrologiques, tels que les sécheresses, où des données spatiales sont disponibles.
-
Communication orale
Relation entre l’indice climatique de réchauffement global et la variabilité temporelle de la sécheresse éco-hydrologique en hiver au Québec méridionalHabiboulaye Gano (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Ali A. Assani (Département des sciences de l’Environnement, Université du Québec à Trois-Rivières)
De nombreux travaux ont été déjà consacrés à l’analyse de la relation entre les indices climatiques et les débits de rivières au Québec méridional. Cependant, aucun de ces travaux n’a jamais utilisé l’indice climatique de réchauffement global pour déterminer son influence sur la variabilité temporelle des débits. Pour combler cette lacune, cette étude a pour objectif de comparer l’influence de cet indice à celle des autres indices déjà utilisés au Québec méridional pour expliquer la variabilité temporelle de la sécheresse éco-hydrologique (durée et intensité). L’étude est fondée sur l’analyse des débits journaliers hivernaux de 17 rivières réparties dans les trois régions hydroclimatiques pendant la période 1950-2023 au moyen de plusieurs méthodes statistiques. La sécheresse éco-hydrologique est définie comme le nombre de jours pendant lesquels les débits journaliers sont inférieurs aux débits réservés écologiques pour la protection des habitats des différentes espèces de poissons qui peuplent les rivières du Québec. Le résultat de cette étude révèle un lien négatif entre cet indice climatique et la sécheresse éco-hydrologique. Ce lien signifie que la durée et l’intensité de cette sécheresse diminuent dans le temps dans toutes les rivières du Québec en raison de la hausse de la température dont les impacts se traduisent par la hausse de la quantité de pluies en automne, principale source des débits d’étiages en hiver, et la fonte précoce de neige en hiver.
-
Communication orale
La connectivité sédimentaire et la sensibilité géomorphologique peuvent-elles nous informer sur la mobilité d’un cours d’eau?Félix Lachapelle (UQAR - Université du Québec à Rimouski), Thomas Buffin-Bélanger (Université du Québec à Rimouski), Francis Gauthier (Université du Québec à Rimouski)
Le transport de sédiments grossiers est une composante intrinsèque à la mobilité des rivières et des risques qui y sont associés. Ce transport est difficile à prévoir, notamment en raison de la complexité liée à la disponibilité en sédiment autant à l’échelle du bassin-versant que du tronçon fluvial. La présente étude s’intéresse à la problématique de l’apport des sédiments vers un cours d’eau montagnard et de l’effet de ceux-ci sur sa morphologie. Le cours d’eau étudié, le Ruisseau des Portes de l’Enfer, est situé dans le Parc national de la Gaspésie et occupe une superficie de drainage de 17.8 km2. La combinaison d’un indice de connectivité (IC) du bassin-versant à une cartographie du corridor fluvial donne une perspective originale sur les interactions entre le transport sédimentaire et la morphologie. Les premiers résultats permettent d’identifier des zones d’accumulation où le potentiel de mobilité est plus élevé ainsi que des zones de production et de transport sédimentaire moins mobiles mais qui ont le potentiel d’apporter plus de matériel en aval. La prochaine étape est d’analyser ces résultats sous la loupe de la sensibilité géomorphologique pour identifier comment la distribution de la connectivité sédimentaire se manifeste en termes de mobilité. C’est de cette façon que la connectivité, jusqu’ici largement théorique, deviendra un outil applicable à l’aménagement et à la gestion des risques.
Évaluation et atténuation des risques I
-
Communication orale
Évaluation du risque lié aux aléas hydrogéomorphologiques des petits cours d’eau dans la région du Bas-Saint-LaurentDahoua Virginie Bile (UQAR - Université du Québec à Rimouski), Thomas Buffin-Bélanger (Université du Québec à Rimouski), Pascale Biron (Université Concordia)
Peu d’outils permettent de faire un audit des aléas hydrogéomorphologiques (HGM) auxquels les petits cours d’eau (PCE) sont sujets, pourtant à ces PCE sont associés plusieurs aléas HGM qui compromettent l’intégrité d’enjeux qui y sont exposés. L’objectif du projet vise à examiner et à proposer des outils pour l’évaluation du risque lié aux aléas HGM pour les petits cours d’eau. Pour ce faire, cinq bassins versants de la région du Bas-Saint-Laurent ont été identifiés comme sites d’étude. Dans un premier temps, des outils SIG (Exzeco, Geomorphon Landform) sont appliqués pour établir un portrait des aléas présents dans ces PCE, puis dans un deuxième temps de les caractériser en évaluant leur intensité, leur étendue et leur distribution spatiale et, finalement, de déterminer le niveau d’exposition des enjeux aux aléas. Une attention particulière est portée dans ce projet aux cônes alluviaux qui sont des zones particulièrement sensibles aux aléas d’inondabilité et de mobilité. Les résultats mettent en exergue l’importance des zones d’avulsion et de mobilité potentielles dans les PCE, ainsi que les zones sensibles aux obstructions et aux inondations. Des recommandations seront émises sur les méthodes les plus pertinentes d’analyse cartographique du risque résultant du croisement entre l’aléa et les enjeux pour les PCE.
-
Communication orale
Modélisation numérique et techniques de télédétection pour adapter les méthodes de prévision des risques d'inondation à la réalité des embâcles de glace sur les rivières du QuébecJason Duguay (UdeS - Université de Sherbrooke)
Les rivières des climats nordiques sont propices à la formation d’embâcles de glace et aux inondations qu’ils peuvent provoquer. Cependant, que ce soit pour le prévisionnel ou le normatif, les méthodes actuelles de cartographie de l'étendue des inondations ne tiennent généralement pas compte de l’influence des embâcles. Cette recherche vise à développer, évaluer et proposer des moyens d'adapter les méthodes de cartographie à la réalité des embâcles. Des méthodes numériques cryo-hydrodynamiques sont utilisées en combinaison avec des ensembles de données géospatiales afin de développer des cartes de probabilité d'inondation causée par des embâcles. Des approches de modélisation stochastique sont en cours d'évaluation pour tenir compte de l'incertitude inhérente à la majorité des paramètres influençant le moment et le lieu de formation des embâcles de glace ainsi que la sévérité des inondations qui en résultent. Le travail de modélisation est soutenu par une combinaison de mesures de télédétection, y compris des drones (par exemple, photogrammétrie, radar à pénétration de sol, altimètres laser), l'imagerie satellitaire dans les bandes visuelles et radar et une variété de mesures in situ de surveillance du couvert de glace et d’indicateurs morphologiques et botaniques de dynamiques fluvioglacielles. Les méthodes et les résultats de cette recherche sont utiles pour les personnes impliquées dans la gestion des risques d'inondation au Québec.
-
Communication orale
Impacts des tempêtes sur les côtes de pergélisols d'un delta arctique: le cas de la région de Kugluktuk et de la rivière Coppermine, Nunavut (Canada)Samuel Binette (UQAR - Université du Québec à Rimouski), David Didier (Université du Québec à Rimouski), Stéphanie Coulombe (Savoir Polaire), Charles Jourdain-Bonneau (Université du Québec à Rimouski), Richard Akana (Kugluktuk HTO), Émile Bujold (Université du Québec à Rimouski), Jacob Stolle (Institut National de la Recherche Scientifique), Thomas Buffin-Bélanger (Université du Québec à Rimouski)
À l’ouest du Nunavut, l'intensité et la trajectoire des changements géomorphologiques des environnements côtiers demeurent peu connues en raison du manque de données historiques et récentes. Des observations et préoccupations soulevées par des membres de la communauté de Kugluktuk ont mené au développement d’un projet de recherche visant à documenter ces changements. Dans le delta de la rivière Coppermine, l’érosion importante des côtes menace un cimetière se trouvant sur une île. Conjointement avec le Hameau et le HTO de Kugluktuk, ce projet consiste à quantifier la mobilité de la côte le long d'un segment de 1,4 kilomètre de l'île et à caractériser les processus morphogènes au sein du delta. Des images aériennes et satellitaires (1952-2017) combinées à des relevés par drone à très haute résolution (2021-2023) ont permis de révéler un retrait historique maximal de la côte de 48,2 m, ainsi que des taux d'érosion récents de près de 3 m/an. Les analyses volumétriques démontrent une perte nette de 814 m3 de matériel entre 2021 et 2023. L’analyse des processus morphogènes révèle des patrons d’érosions récurrents principalement d'origine hydrodynamique. L'augmentation des niveaux d'eau lors des grandes marées, combinée à des vagues de tempêtes incidentes à la côte, entraînent une augmentation de l'érosion induite par les vagues en pied de falaise. Dans cet environnement sableux, ces processus hydrodynamiques semblent dominants par rapport aux processus thermiques.
Évaluation et atténuation des risques II
-
Communication orale
Vers une meilleure compréhension des risques de submersion côtière au NunavikAntoine Boisson (UQAR - Université du Québec à Rimouski), Béatrice Roberge (Laboratoire d’études des littoraux nordiques et arctiques (LNAR), Université du Québec à Rimouski), Laura-Christine Daigneault (Université Laval), David Didier (Laboratoire d’études des littoraux nordiques et arctiques (LNAR), Université du Québec à Rimouski)
Cette présentation porte sur les résultats de recherche d’un projet RIISQ-RQM visant à une meilleure compréhension des risques de submersion côtière au Nunavik, dans les communautés d’Umiujaq, de Salluit, de Tasiujaq et de Kangiqsualujjuaq. Les dynamiques côtières au Nunavik sont relativement peu documentées, surtout en comparaison avec celles de l’estuaire et du Golfe du Saint-Laurent. Ainsi, plusieurs campagnes de terrain ont été réalisées entre 2021 et 2023, utilisant différentes approches méthodologiques telles que des consultations dans les communautés, des vols de drone, l’installation de caméras et des caractérisations côtières. Un portrait exhaustif des connaissances pour chaque communauté, une analyse historique du trait de côte, et divers produits cartographiques ont permis d’améliorer les connaissances générales sur les aléas côtiers dans ces communautés. Les submersions affectent principalement Salluit et Kangiqsualujjuaq, tandis que l’érosion côtière est plus marquée à Umiujaq et Tasiujaq.
-
Communication orale
Quand un risque en cache un autre : les pollutions causées par les inondations urbaines représentent-elles un problème pour les gestionnaires québécois et français ?Maïlys Genouel (École normale supérieure de Lyon), Emeline Comby (Université Lyon 2, UMR 5600 EVS, FRANCE), Yves-Fançois Le Lay (ENS de Lyon, UMR 5600 EVS)
Dans un contexte d’urbanisation et de changements climatiques, les dommages causés par les inondations ayant augmenté, le risque de pollutions induites par ces inondations et susceptibles de perturber le métabolisme urbain s’est aussi accru. En adoptant une approche constructiviste de la pollution, nous cherchons à évaluer dans quelle mesure elle est définie comme un problème social au sein de l’arène des gestionnaires.
Trente-trois entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des gestionnaires qui travaillent dans divers services (aménagement, environnement, sécurité civile…) de différentes circonscriptions territoriales liées à dix villes en France et au Québec. Les entretiens ont été retranscrits pour traiter le corpus via une méthode mixte, entre quantitatif (analyse de contenu et textométrie) et qualitatif (extractions de citations).
Grâce à une approche comparative des discours, nous relevons une diversité de pollutions induites par différents types d’inondations et nous soulignons l’influence de leur contexte. En s’appuyant sur les réflexions issues des discard studies, nous identifions des obstacles à l'émergence de ce problème dans l’arène opérationnelle : cloisonnement des services et définition confuse des pollutions, minimisation du danger, valorisation d’une approche individuelle de la résilience. L’étude spécifique des pollutions liées au débordement des réseaux d’assainissement permet de nuancer le constat d’une absence de préoccupation.
-
Communication orale
Inondations et vagues de chaleur : Comment augmenter la capacité des systèmes à prévenir les impacts sur la santé mentale et le bien-être psychosocial des populations?Lily Lessard (UQAR - Université du Québec à Rimouski), Joanie Turmel (Département des sciences de la santé, Université du Québec à Rimouski, Lévis, Québec), Jade Talbot (Centre de recherche du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CR-CISSSCA))
Le projet CASSSIOPEE, réalisé avec les CISSS de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent et qui s’est terminé en 2023, s'est penché sur la capacité d’adaptation du système de santé et de services sociaux à prévenir et réduire les impacts psychosociaux des populations humaines exposées aux inondations et aux vagues de chaleur. Le choix d’opter pour la « santé mentale populationnelle » comme cible principale d’intervention s’inscrit dans une visée systémique des effets des changements climatiques et de l’adaptation, car la protection de la santé mentale requiert des actions complexes et intersectorielles. La présentation exposera principalement le cadre de 12 actions adaptatives pouvant être déployé par le réseau de la santé et ses différents partenaires, dont les communautés locales, pour protéger la santé et le bien-être des populations. Ce cadre repose sur les points d’experts de différents secteurs et des données recueillies auprès d’une centaine d’acteurs et d’actrices clés rencontré.es dans le cadre d’entrevues individuelles et qui sont impliqué.es dans la gestion ou le vécu de ces deux aléas, notamment au sein du réseau de la santé et de services sociaux. Les besoins et enjeux d’arrimage et d’adaptation entre les différents services et la communauté ont notamment été abordés. Le projet a également permis la réalisation d’une cartographie des vulnérabilités psychosociales à une échelle fine pour soutenir la prise de décision.
Communication et évaluation des conséquences
-
Communication orale
Enjeux de littéracie rencontrés pour la communication des risques et des bonnes pratiques liés à la qualité de l’eau des puits privésTamari Langlais (UQAR - Université du Québec à Rimouski)
La qualité de l’eau potable est un déterminant important de la santé. Au Québec, 11% des ménages s’approvisionne principalement en eau à partir de puits privés. Il incombe aux propriétaires de puits de s’assurer de la potabilité de leur eau. Or, peu d’entre eux la font régulièrement analyser, mettant ainsi à risque leur santé et celle de leurs proches. Le projet pilote Mon eau, mon puits, ma santé, cherchait à modifier ce comportement en réduisant les obstacles à l’analyse de l’eau des puits privés, c’est à dire 1) le manque de connaissances et les fausses croyances, 2) les contraintes logistiques et financières, 3) la difficulté à interpréter les résultats et 4) les contraintes à l’adoption de mesures correctrices en cas de contamination. Lors de la mise en œuvre des pilotes, le faible niveau de littératie tant général que numérique des participants a apporté son lot de défis, que le projet a pu surmonter en partie grâce à son approche axée sur la communauté. S’il a réussi à augmenter la pratique de l’analyse chez les propriétaires de puits privés des municipalités rurales participantes, le projet a aussi mis en évidence des besoins criants d’accompagnement et le peu de ressources disponibles pour l’interprétation des résultats et l’identification des mesures correctrices appropriées. Cette communication fera état des défis rencontrés en ce sens ainsi que des pistes de solutions pour mieux répondre aux besoins des propriétaires de puits privés du Québec.
-
Communication orale
Mieux comprendre les enjeux liés aux inondations pour une meilleure communication des risquesYannick Hémond (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Dans le cadre de l’appel à projets RIISQ-Ouranos, nous avons obtenu un projet pour outiller les décideurs à l’aide de tableaux de bord cartographique pour mieux gérer les inondations.
La démarche repose sur une implication du milieu économique et communautaire pour mieux identifier les vulnérabilités socio-économiques d’un territoire. En collaboration avec le centre local de développement de Brome-Missisquoi et le bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec, plusieurs entreprises et organismes communautaires ont participé à des ateliers de travail pour nous aider à mieux comprendre les conséquences des risques liés aux inondations.
Les premiers résultats de recherche de ce projet sont concluants. Ils permettent aux décideurs de mieux comprendre les interactions sur leur territoire et aux bénéficiaires de mieux communiquer leurs vulnérabilités, ce qui est essentiel en matière de gestion des risques.
Cette proposition de communication permettra de présenter ces résultats et d’ouvrir la discussion sur le transfert possible vers d’autres milieux preneurs.
-
Communication orale
Perdre son domicile post-inondations : un vécu en quatre phasesJoanie Turmel (UQAR - Université du Québec à Rimouski), Marie-Hélène Morin (Université du Québec à Rimouski), Lily Lessard (Université du Québec à Rimouski)
Les relocalisations de populations sont un moyen pour réduire les risques associés aux inondations, dont ceux pour la santé humaine. Au Québec, les inondations de 2017 et 2019 ont mené à la démolition de centaines de domiciles et cette tendance pourrait s'accroître dans les prochaines années avec les changements climatiques. En Chaudière-Appalaches, c’est plus de 400 bâtiments qui ont été démolis à Sainte-Marie et 88 à Scott après les inondations de 2019. Cette présentation porte sur cinq nouvelles phases caractérisant l’expérience de démolition de domiciles et de relocalisation de treize hommes de ces municipalités rencontrés lors d’entrevues individuelles impliquant la méthode photo-élicitation et d’un focus group. Chacune de ses phases est caractérisée par des besoins et conséquences spécifiques ainsi que des moments critiques lors desquels une attention particulière doit être portée afin d’assurer la santé et le bien-être des hommes. Dégagés à partir d’une analyse thématique inspirée d’un cadre portant sur la capacité à faire face aux impacts des changements climatiques (Reser et Swim, 2011), les résultats mènent à l’émission d’une série de stratégies d’accompagnement et de pistes d’action en matière d’organisation des services. Celles-ci permettront d’améliorer les actions et interventions en contexte de déploiement de mesures visant à atténuer les conséquences des inondations et d’ainsi accroître la résilience des individus et des communautés.
-
Communication orale
L’utilisation du Digital Storytelling pour une meilleure compréhension de vécu psychosocial des adolescents exposés à un cumul de catastrophes naturellesEve Pouliot (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Ann-Sophie Simard (Université du Québec à Chicoutimi), Danielle Maltais (Université du Québec à Chicoutimi), Christine Gervais (Université du Québec en Outaouais), Kristel Tardif-Grenier (Université du Québec en Outaouais)
Au cours des dernières années, la population de l'Outaouais a été confrontée à de nombreuses catastrophes naturelles. Afin de de mieux comprendre le vécu psychosocial des adolescents exposés à ce cumul de catastrophes, cette communication vise à mettre en évidence la pertinence de l'utilisation du Digital Storytelling (DST). Le DST est une méthode de recherche participative qui combine l'art de raconter des histoires avec un mélange de médias numériques, y compris du texte, des images, de la narration audio, de la musique et de la vidéo. Un exemple concret de l'application de cette méthode sera présenté, à la lumière d'un processus de recherche que nous avons mené avec 28 adolescents à la suite de leur exposition à un cumul de catastrophes naturelles en Outaouais. Les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de cette méthode avec les adolescents qui y ont participé mettent en évidence la possibilité pour eux d'exprimer leur point de vue sur les catastrophes naturelles et l'augmentation du sentiment de solidarité avec leur communauté. Le discours des participants souligne que le DST aide les adolescents à mieux comprendre les événements qu'ils ont vécus lorsqu'ils ont été exposés à une catastrophe, en leur permettant d'analyser les points tournants associés à cet événement dans leur vie. Les défis associés à la méthode du DST seront finalement abordés, de même que les avantages de l’utilisation de celle-ci dans les recherches menées à la suite de catastrophes.