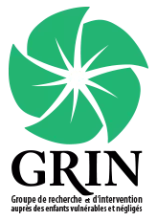Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Le tempérament réfère aux différences individuelles dans la manière de réagir, sur le plan émotionnel, moteur, attentionnel et comportemental, à la stimulation sociale et non sociale ainsi qu’aux exigences environnementales. Ce construit réfère également aux différences dans la capacité à réguler cette réactivité. Chez l’enfant, le tempérament s’exprime au moyen de différentes dimensions : par exemple, la prédisposition à la crainte, le niveau d’activité, la prise de risque et l’attention soutenue. Bien que le tempérament de l’enfant soit l’objet d’études scientifiques depuis fort longtemps, ce construit demeure encore souvent méconnu ou mal compris, autant dans la communauté de chercheurs et de praticiens que dans le grand public.
Par ailleurs, si la démonstration de l’importance du tempérament pour le développement et l’adaptation de l’enfant n’est plus à faire, il subsiste encore plusieurs questions clés s’y rapportant, sur lesquelles chercheuses et chercheurs doivent continuer de mener des travaux. Par exemple, quels facteurs influent sur la stabilité ou l’instabilité du tempérament dans le temps ? quels sont les déterminants prénataux et postnataux les plus critiques pour le tempérament ? par quel(s) mécanisme(s) le tempérament influe-t-il sur le développement social, émotionnel et cognitif de l’enfant ? comment le tempérament interagit-il avec les comportements et styles parentaux ainsi que d’autres facteurs environnementaux dans l’explication de l’adaptation de l’enfant à ses milieux de vie ?
Enfin, les résultats de la recherche sur le tempérament sont encore peu souvent pris en compte dans le champ de l’intervention sociale. Les retombées pratiques de celle-ci demeurent souvent minces ou floues, et l’applicabilité de ces résultats demeure souvent un mystère pour les intervenantes et les intervenants. Il est nécessaire de réfléchir aux enjeux et défis qui participent à cet état de fait et d’identifier des manières de favoriser une meilleure utilisation de ces connaissances dans l’intervention auprès de l’enfant.
Le colloque permettra de mettre en lumière l’importance de la recherche sur le tempérament de l’enfant et du rôle clé que celui-ci joue dans le développement et l’adaptation des enfants, et de mieux délimiter ce construit en le distinguant de construits scientifiques ou non scientifiques apparentés. Il contribuera à la clarification et à la diffusion de la conception moderne du tempérament et ainsi stimulera l’intérêt pour une prise en compte plus systématique et mieux appuyée de ce construit dans l’étude du développement humain et de l’adaptation sociale, comportementale et scolaire.
Par ailleurs, le colloque mettra la table pour un rassemblement des forces vives en recherche dans le domaine du tempérament dans l’espace francophone, favorisera la formation de la relève dans ce domaine, contribuera directement à l’avancement des connaissances sur le développement et l’adaptation de l’enfant, et permettra un rapprochement entre les milieux de la recherche et ceux de la pratique.
Remerciements :Nous remercions le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles, le Groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance, le Groupe de recherche et d'intervention auprès des enfants vulnérables et négligés, le Labo international sur l’inclusion scolaire et le Labo de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation psychosociale à l'école
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Jean-Pascal Lemelin (UdeS - Université de Sherbrooke)
- Jessica Pearson (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
- Élizabeth Harvey (Université Sainte-Anne)
Programme
Mot de bienvenue
Tempérament de l’enfant : déterminants, conséquences et processus développementaux (partie 1)
-
Communication orale
Trauma maternel et affectivité négative de l’enfant : Corrélats et déterminants de la grossesse à la première année de vieJulia Garon-Bissonnette (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Kim Deschênes (Université du Québec à Trois-Rivières), Sabrina Bernier (Université du Québec à Trois-Rivières), Roxanne Lemieux (Université du Québec à Trois-Rivières), Jean-Pascal Lemelin (Université de Sherbrooke), Nicolas Berthelot (Université du Québec à Trois-Rivières)
Les traumas vécus durant l’enfance sont associés à des impacts intergénérationnels, dont un risque d’affectivité négative chez les enfants. Des liens transactionnels entre des vulnérabilités de la mère et de l’enfant ont récemment été suggérés. La présentation explorera deux grandes questions: Les traumas maternels sont-ils associés à l’affectivité négative de l’enfant et interagissent-ils avec cette prédisposition de l’enfant pour prédire le stress parental? Cent trente-sept participantes (Mâge=29,5, ÉT=4,4), recrutées dans une vaste étude pré- et postnatale, ont rempli des questionnaires sur leur histoire traumatique (CTQ), leur exposition à des événements stressants (SRRS), le tempérament de leur enfant (Mâge=7,7 mois, ÉT=2,5; IBQ-R) et leur niveau de stress parental (PSI). Des analyses de médiation et modération avec la macro PROCESS ont révélé un effet indirect des traumas maternels sur l’affectivité négative de l’enfant via les stresseurs prénataux, b=0,006, IC 95% [0,001;0,013]. Les traumas maternels modéraient aussi l’association entre l’affectivité négative et le stress parental, b=6.47, 95% CI [1.12;11.83], de sorte que l’association était plus forte chez les mères avec traumas que celles sans traumas. Les résultats révèlent que l’affectivité négative des tout-petits représente à la fois un corrélat des traumas et un déterminant de l’adaptation chez les mères ayant vécu des traumas et soulignent l’importance d’interventions psychosociales dès la grossesse.
-
Communication orale
Analyse des composantes de la détresse infantile en lien avec la sensibilité maternelle et l’affectivité négativeWilliam Trottier-Dumont (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Jessie Tremblay (Université Laval), Annabelle Harvey (Université du Québec à Trois-Rivières), Maëlle Scrosati (Université Laval), Jean-Pascal Lemelin (Université de Sherbrooke), Tristan Milot (Université du Québec à Trois-Rivières), Jessica Pearson (Université du Québec à Trois-Rivières), Claire Baudry (Université du Québec à Trois-Rivières), George Tarabulsy (Université Laval)
La détresse chez le nourrisson occupe une place prépondérante de sa vie émotionnelle et peut s’avérer difficile et exigeante à réguler pour les parents. L’objectif de la présente étude est d’examiner les contributions du tempérament du nourrisson et de la sensibilité maternelle pour expliquer la détresse manifestée par les nourrissons lors de séparations mère-enfant. L’affectivité négative, une dimension du tempérament, a été mesurée via un questionnaire complété par la mère à 4 mois. La sensibilité maternelle a été évaluée par observation lors de visites à domicile à 8 mois. Une procédure de séparation parent-enfant a été effectuée auprès de 89 dyades mère-enfant à risque psychosocial modéré lorsque les enfants étaient âgés de 16 mois pour générer de la détresse. La latence, l’intensité et le taux de récupération de la détresse ont été codifiés et calculés par des observateurs externes. Des corrélations bivariées ont révélé un lien significatif pour la latence et l’intensité de la détresse en lien avec la sensibilité maternelle. L’affectivité négative n’était pas associée à aucune des composantes de la détresse, suggérant que lors d’une séparation avec le parent, la détresse manifestée par l’enfant est tributaire d’enjeux relationnels associés à la sensibilité maternelle. Dans cette perspective, les résultats permettent de mieux cibler les efforts d’intervention et de guider les parents dans leurs réponses envers leurs enfants.
-
Communication orale
Le tempérament du nourrisson et les pratiques paternelles de soutien à l’autonomieCélia Matte-Gagné (Université Laval), Emma Laflamme (Université Laval)
Selon la théorie de l’autodétermination, encourager l’enfant à faire des choix et à résoudre par lui-même les problèmes qu’il rencontre (c.-à-d. soutien à l’autonomie) permet de favoriser son développement optimal (Deci & Ryan, 2002). De nombreuses études appuient le rôle important du soutien parental à l’autonomie (SA) dans l’adaptation scolaire et psychosociale de l’enfant (Vasquez et al., 2016). Les facteurs qui expliquent que certains parents soutiennent davantage l’autonomie de leur enfant demeurent toutefois méconnus, surtout chez les pères. La présente étude examine le rôle du tempérament du nourrisson dans la prédiction des comportements de SA chez les pères. 115 dyades père-enfant ont été évaluées à 6 (T1) et 12 (T2) mois. Le tempérament de l'enfant a été évalué au T1 à l'aide de la version très courte de l'Infant Behavior Questionnaire-Revised (Putnam et al., 2014). Au T2, le SA des pères a été évalué par observation durant une séquence de résolution de problèmes père-enfant. Des analyses de régression indiquent que le niveau d’extraversion ou de surgence de l'enfant à 6 mois prédit négativement le SA paternel (β = -.25, p = .007), et ce, même en tenant comptant d’un prédicteur reconnu des pratiques paternelles, soit le soutien de la mère au rôle du père (β = .22, p = .015). Les résultats de cette étude suggèrent que les politiques et interventions qui visent à promouvoir les pratiques paternelles de SA devraient tenir compte du tempérament de l'enfant.
-
Communication orale
Association entre le tempérament de l’enfant et son développement cognitif en début de vie : examen du rôle médiateur des comportements parentauxJessica Pearson (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Jean-Pascal Lemelin (Université de Sherbrooke), Magdalena Zdebik (Université du Québec en Outaouais)
Alors que plusieurs études vérifient le lien entre le tempérament et le développement socio-émotionnel, peu examinent son association avec le développement cognitif. Cette étude a pour objectifs 1) d’examiner le lien entre le tempérament et le développement cognitif en début de vie; et 2) d’examiner le rôle médiateur des comportements maternels dans ce lien. Méthode : 225 mères ont complété des questionnaires en ligne. Lorsque l’enfant était âgé de 6 mois, le tempérament a été évalué par l’IBQ-R (version courte; Putnam et al., 2013). À 12 mois, les comportements maternels ont été évalués par le CPBQ (Majdandzic et al., 2016) et le développement cognitif par l’ASQ-3 (résolution de problèmes; Squires et al., 2009); et l’IMBCD (vocabulaire expressif et réceptif; Trudeau et al., 1999). Résultats : Des régressions linéaires multiples indiquent que le facteur tempéramental d’extraversion prédit positivement la résolution de problème, ainsi que le vocabulaire expressif et réceptif. La procédure du bootstraping indique que les comportements maternels de mise au défi, de chaleur et de discipline positive sont des médiateurs du lien entre l’extraversion et la résolution de problème, alors que la discipline positive est un médiateur du lien entre l’extraversion et le vocabulaire expressif. Discussion : Les résultats soulignent la pertinence de considérer le tempérament comme un prédicteur du développement cognitif, tout en tenant compte du rôle de l’écologie développementale.
Dîner
Table ronde – Le tempérament de l’enfant : en route vers le futur
Tempérament de l’enfant : déterminants, conséquences et processus développementaux (partie 2)
-
Communication orale
Quelles caractéristiques tempéramentales rendent les jeunes enfants plus sensibles aux influences de leur environnement familial sur leur niveau de préparation scolaire?Jasmine Gobeil-Bourdeau (UdeS - Université de Sherbrooke), Jean-Pascal Lemelin (Université de Sherbrooke), Marie-Josée Letarte (Université de Sherbrooke), Angélique Laurent (Université de Sherbrooke)
Le tempérament et la qualité de l’environnement familial sont reconnus comme des déterminants importants de la préparation scolaire, c’est-à-dire les habiletés des enfants dans différents domaines leur permettant de s’ajuster aux exigences de l’école. Néanmoins, comment ces deux variables interagissent pour prédire la préparation scolaire demeure inconnu. Cette étude longitudinale examine donc le rôle modérateur du tempérament (émotivité négative, réactivité/extraversion, régulation volontaire) dans la relation entre l’environnement familial (pratiques parentales, risque sociodémographique) et la préparation scolaire. L’échantillon inclut 98 enfants (59 % garçons) à risque en raison de leur faible préparation scolaire à 4,5 ans. Le tempérament a été rapporté par les parents alors que les caractéristiques de la famille résultent d’une combinaison de questionnaires aux parents et d’observations lors d’une visite à domicile. La préparation scolaire a été mesurée directement auprès de l’enfant et rapportée par les parents à la fin de la maternelle. Les régressions linéaires multiples hiérarchiques ont montré que seul le facteur de régulation volontaire interagissait avec les caractéristiques de l’environnement familial pour prédire la préparation scolaire. Comme les enfants semblent différemment affectés par leur environnement familial, les interventions visant à les préparer pour l’entrée scolaire devraient être ajustées en fonction de leurs caractéristiques tempéramentales.
-
Communication orale
L’inhibition comportementale : Liens longitudinaux avec les problèmes intériorisésMagdalena Zdebik (UQO - Université du Québec en Outaouais)
L’inhibition comportementale (IC), une vulnérabilité physiologique à réagir plus rapidement et intensément face à la nouveauté et l’incertitude, est l'un des profils de tempérament le plus largement étudié et établi en tant que facteur de risque pour les troubles intériorisés, tels que l’anxiété sociale, l’anxiété généralisée et la dépression. De plus, un lien entre ce profil de tempérament et le concept cognitif transdiagnostique de l’intolérance à l’incertitude, la tendance à réagir négativement à des situations ou à des évènements qui provoquent un sentiment d’incertitude, a également été démontré. Cette présentation vise à faire une synthèse de nos travaux des dernières années sur l’inhibition comportementale.
L’inhibition comportementale sera décrite et comment elle est mesurée. Des études examinant les liens entre l’inhibition comportementale à l’enfance et 1) les problèmes intériorisés à l’adolescence (anxiété sociale, anxiété généralisée, dépression) 2) l’intolérance à l’incertitude à l’émergence de l’âge adulte et 3) le trouble d’anxiété généralisée à l’âge adulte seront présentées.
Ces résultats soulignent l’importance de mieux comprendre le rôle des facteurs de risque précoces, comme le tempérament, en lien avec les troubles intériorisés dans une perspective lifespan, afin non seulement de mieux cerner l’étiologie de ces troubles, mais aussi de les prévenir en identifiant des pistes concrètes pour développer des programmes de prévention et d’intervention précoces.