L’individu humain, peu importe sa singularité, ne souffre pas comme il le veut. Même s’il souffre somme toute individuellement et que certaines dimensions de sa souffrance resteront à jamais dans son for intérieur, la grammaire de sa souffrance ne lui appartient pas : elle est à tous et à personne.
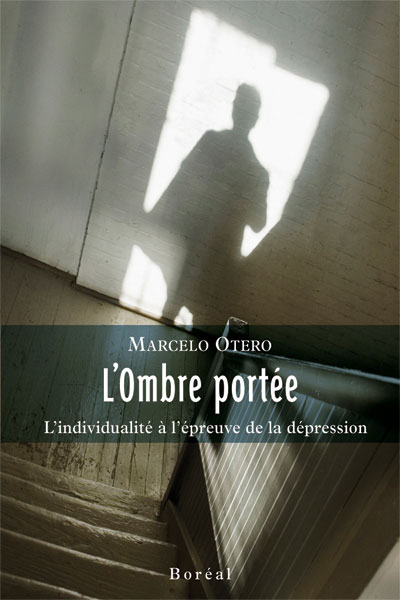
L’épidémie de dépression illustre l’extrême de cette logique. On assiste à une souffrance psychique de masse et à une prise d’antidépresseurs comme thérapie quasi universelle. Et on se retrouve avec un paradoxe qu’on ne remarque plus : on n’a jamais pris autant d’antidépresseurs et on n’a jamais été autant déprimés. L’univers du travail est au cœur de cette tragédie, car en l’état de notre civilisation, le « bien-être » social passe essentiellement par cette voie.
La souffrance psychique
La souffrance psychique, ainsi que les manières de la combattre, la gérer ou l’accueillir (de la religion à l’antidépresseur en passant par le masochisme) sont à la fois un lieu de rencontre et un socle collectif. Tantôt, elles permettent la reconnaissance mutuelle réconfortante, tantôt l’assignation inquiétante dans les multiples figures du pathologique.Toutefois, qu’est-ce que souffrir peut bien vouloir dire quand tout le monde souffre et, de surcroît, semble vouloir et devoir en parler? S’agit-il seulement de l’effet de l’extension du soin psychique à de larges catégories de personnes auparavant exclues? Le policier et le délinquant, le pompier et le sinistré, le col bleu et le riche homme d’affaires étalent au grand jour les détails de leur souffrance, la nomment, la communiquent, la partagent, la réfléchissent.
La souffrance psychique « fait société » comme jamais auparavant. Elle semble en effet « unifier » l’inégalités des individus, mieux que l’impersonnel humanisme juridique des droits de l’homme, devenu plus détaché des expériences concrètes de chacun.
Un phénomène de masse
La dépression s’assimile toutefois mal à ce seul registre vague de la souffrance, à la fois social et psychologique, qui va des effets négatifs du stress quotidien aux passages à l’acte les plus spectaculaires en passant par les séquelles ravageuses du harcèlement psychologique en milieu de travail. Elle ne se résume pas seulement à un état subjectif de malheur ou de tristesse ordinaire, grave ou moins grave, normale ou pathologique, vieux comme le monde et coextensif de toute expérience humaine. Dans la dépression, il existe quelque chose qui est à la fois de profondément contemporain et socialement emblématique autant dans sa forme que dans sa prévalence imposante. Un mal fort répandu, institutionnellement reconnu, normativement balisé et socialisé jusqu’à la plus déroutante des familiarités appelle souvent un remède qui partage les mêmes caractéristiques.
Tout comme le furent jadis la névrose et la psychanalyse, la dépression et les antidépresseurs se sont imposés en tant que nouveau tandem emblématique de la souffrance sociale contemporaine et de ce qu’on doit faire pour la traiter.
«La dépression et les antidépresseurs se sont imposés en tant que nouveau tandem emblématique de la souffrance sociale contemporaine.»
Des antidépresseurs mur à mur
Au Canada, au chapitre des motifs de consultations médicales, la dépression se classe au troisième rang, après l’hypertension et le diabète, avec un chiffre effarant de 8 millions de consultations par année1. Le traitement de choix pour la combattre est sans conteste l’antidépresseur. Celui-ci se hisse au premier rang de toutes les catégories de médicaments délivrés par des pharmacies avec 34 millions d’ordonnances annuelles exécutées2 (IMS Brogan, 2011). Ce sont les médecins généralistes à plus de 80 % qui la diagnostiquent3 avec une aisance remarquable et délivrent les molécules thérapeutiques avec une rapidité étonnante. Après tout, ne s’agit-il d’un mal général que tout le monde peut subir et reconnaître de soi-même?
Scientifiquement suspecte, mais socialement costaude
À première vue, on pense savoir de quoi il s’agit dès lors qu’on s’en remet aux logiques épidémiologiques lancinantes de régularité, aux nosographies psychiatriques descriptives qui dessinent d’une main sur l’atlas humain du « mental pathologique » et aux essais cliniques pharmaceutiques qui légitiment les effets bénéfiques des antidépresseurs. De plus près cependant, tout devient nébuleux et rien ne semble tenir sans sérieuses mises en garde : ni les définitions établies du mal éprouvé, ni les causes évoquées pour l’expliquer, ni les circonstances qui sont censées l’entourer et lui donner un sens, ni encore les effets escomptés des médicaments que l’on affirme obstinément spécifiques et thérapeutiques.
Ce que l’on croyait scientifique, familier et évident, devient suspect, inconfortable et inexplicable lorsqu’on s’y attarde de manière systématique hors des logiques purement médicales. Toutefois, rien n’y fait, le tandem magique « dépression-antidépressseur » règne admirablement à l’échelle du social : la prévalence des dépressions ne fléchit pas, la consommation d’antidépresseurs non plus.
La tempête parfaite
Lorsqu’on y pense, tout s’est passé très vite. Au cours des années 1950 la dépression n’était qu’un symptôme perdu dans les manuels de psychiatrique (DSM I, 1952) pour en devenir en quelques décennies seulement le trouble mentale vedette que l’on connaît (DSM IV-TR) et que l’on craint à la fois pour ses effets ravageurs tant sur les individus que sur l’économie (absentéisme, coût du remboursement des médicaments, affaiblissement de la main d’œuvre par la chronicisation des états dépressifs, etc.).
«Sociologiquement parlant, le déprimé contemporain est moins un individu triste qu’un individu fatigué (l’action est en panne) et démotivé (l’envie n’est plus là).»
La popularité actuelle de la dépression (et de plus en plus des anxiodépressions4 comme souffrance psychique de masse) et de ses remèdes institutionnels (surtout les antidépresseurs de masse) s’inscrit dans un contexte sociétal large qui lui sert de terreau fertile. Pensons seulement à la montée de l’individualisme de masse, à la friabilité des supports sociaux, aux profondes transformations des configurations familiales, à la démultiplication des exigences de performance sur tous les plans et à la consécration du travail comme méta-valeur suprême de l’existence sociale (Martuccelli, 2010).
Toutes ces transformations sociales sont étroitement en phase avec les deux grands symptômes empiriques dont souffre le déprimé contemporain : « ne pas pouvoir » et « ne pas pouvoir vouloir ». En effet, sociologiquement parlant, le déprimé contemporain est moins un individu triste qu’un individu fatigué (l’action est en panne) et démotivé (l’envie n’est plus là).
L’univers du travail au centre de ce mal-être
Dans une société où la dépression est la figure de proue de la nervosité sociale, le lieu typique des tensions de l’individualité, c’est-à-dire la manière sociale d’être un individu aujourd’hui (Otero, 2003), est avant tout l’univers quotidien du travail.
C’est surtout dans ce contexte que les limites de l’individu sont testées en permanence5. Jusqu’où peut-on aller? Jusqu’où doit-on aller? Quelle cadence peut-on maintenir et pour combien de temps? C’est là une autre manière de se demander à soi-même, sous la menace permanente du déclassement social, qui on est et quelle place sociale on est capable d’occuper et de conserver.
«Hors de l’univers du travail, point de salut social : voilà le drame auquel la dépression nous confronte quotidiennement.»
L’individu déprimé se trouve seul aux prises avec un problème majeur qui menace le fondement même de son existence sociale : sa capacité d’action est sérieusement entravée. Dans un monde où les assurances sociales sont inégalement distribuées et où les positions statutaires peuvent se fragiliser en cours de trajectoire, la panne de l’action et synonyme, à terme, de mort sociale. Hors de l’univers du travail, point de salut social : voilà le drame auquel la dépression nous confronte quotidiennement.
La dépression : un objet pour les psychiatres et les sociologues?
Dans le cas de la dépression, le statut des symptômes qui prétendent l’expliquer font partie du débat entre sociologiques et psychiatres : sous quelles conditions un dysfonctionnement social peut-il être considéré comme un symptôme médical et capté légitimement par la psychiatrie dans le cadre d’un trouble mental spécifique? Sous quelles conditions un symptôme doit-il être démédicalisé et restitué à l’univers des tensions sociales ordinaires?
Pour la psychiatrie contemporaine, la dépression est un syndrome, c’est-à-dire un ensemble cliniquement significatif (signes et symptômes) «associé» à une souffrance ou à un dysfonctionnement social. Toutefois, rien dans les argumentations de la psychiatrique actuelle (du déficit de tel ou tel neurotransmetteur à la génétique défaillante) ne permet de comprendre pourquoi tant de personnes se sont mises à dysfonctionner dans la figure syndromique de la dépression. Comment expliquer la résonance extraordinaire des mêmes signes, symptômes, souffrances et dysfonctionnements chez des millions d’individus partout en Occident et de plus en plus ailleurs? La compréhension des racines sociales de cette « démocratisation » dépressive, qui nous touche tous et toutes, revient à la sociologie. Voilà le problème principal auquel ce livre veut s’attaquer.
Bibliographie :
- American Psychiatric Association (1952), (DSM I) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Washington, American Psychiatric Association Mental Hospital Service.
- American Psychiatric Association (2000),(DSM IV-TR) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
- Benigeri, M. (2007), L’utilisation des services de santé mentale par les Montréalais en 2004-2005, Montréal, Carrefour montréalais d’information sociosanitaire et Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
- Conseil du médicament du Québec (2008), Usage des antidépresseurs chez les personnes inscrites au régime public d’assurance médicaments du Québec. Étude descriptive - 1999-2004. Québec : Les Publications du Québec.
- IMS Health, Canada, (2007, 2011, 2012)
- Kavanagh, M. et al. (2006), La dépression majeur en première ligne, Québec : ASSS, INSP.
- Martuccelli, D. (2010) La société singulariste, Paris, A. Collin.
- Mercure, D. et M. Vultur (2010), La signification du travail. Sainte-Foy, Presses de l’Université de Laval.
- Otero, M. (2003), Les règles de l’individualité contemporaine. Santé mentale et société, Presses de l’Université Laval.
- 1Au Québec, le chiffres se ressemblent : la dépression et l’anxiété s’échangent la troisième et quatrième place selon les années au chapitre des consultations médicales (1,5 millions environ chacune) précédées par l’hypertension (4,4 millions) et le diabète (2,4 millions) tandis que les antidépresseurs sont le deuxième médicament délivré en pharmacie avec 12 millions d’ordonnances exécutées annuellement, précédés par les hypocholestérolémiants (14 millions). (IMS Brogan, 2011).
- 2Même si les antidépresseurs sont majoritairement prescrits pour les indications de dépression, plusieurs autres indications sont évoquées dans les rapports gouvernementaux dont les troubles anxieux, de l’adaptation, de conduites alimentaires, du déficit de l’attention, la bipolarité, la fribromyalgie, etc. (Conseil du médicament du Québec, 2008)
- 3Depuis 1999, le nombre d’ordonnances des ISRS (antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) qui représentent environ 81% de tous les antidépresseurs prescrits au Canada a augmenté de 83 %. En 2003, les médecins de famille et les omnipraticiens ont prescrit 81% des ISRS, une tendance qui continue à se confirmer depuis (IMS, 200&, 2011).
- 4Tant au Canada qu’au Québec, les nombre consultations médicales pour dépression (troubles dépressifs) et anxiété (troubles anxieux) tendent à se rapprocher depuis 2002. En 2012, le nombre de consultations pour anxiété ont dépassé pour la première fois de quelques milliers celles pour dépression à Montréal et dans l’ensemble du Québec. 60 % de l’ensemble des consultations du réseau public en santé mentale montréalais correspondent à part égales aux troubles anxieux et aux troubles dépressifs (Benigeri, 2007).
- 5Malgré les nombreuses études portant sur la «fin du travail» qui ont vu le jour depuis le dernier quart du XXe siècle, la centralité du travail dans la vie des individus ne fait que s’affirmer (Mercure et Vultur, 2010).
- Marcelo Otero
Université du Québec à Montréal
Marcelo Otero est professeur du département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal. Il est chercheur au CRI, au CHRS et au CREMIS. Ses projets de recherche portent sur les nouveaux problèmes de santé mentale et les problèmes sociaux complexes. Il a publié notamment Les règles de l’individualité contemporaine, PUL, 2003 et L’ombre portée : l’individualité à l’épreuve de la dépression, Boréal, 2012 et Qu’est-ce qu’un problème social aujourd’hui? (avec Shirley Roy), PUQ, 2013.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre



