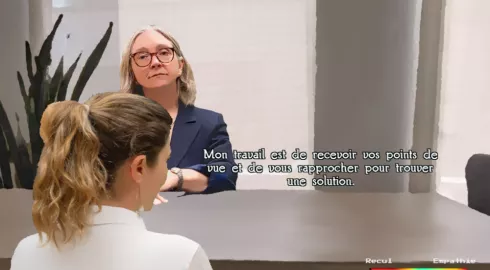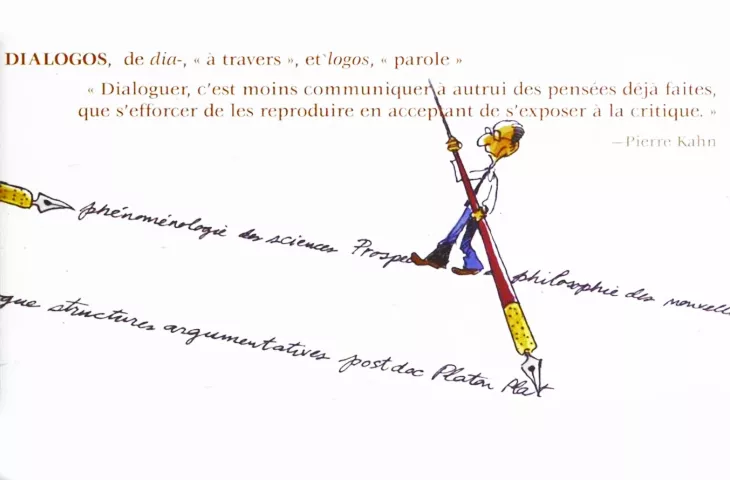La communauté la plus dynamique que j’aie rencontrée en science est celle de Science Online : un congrès annuel, des échanges sur Twitter à l’année longue, des conversations, et ce entre des gens qui ont réalisé avoir tout intérêt à profiter de l’expérience des autres.
 Une suite d'évolutions
Une suite d'évolutions
Vous êtes intéressés par des textes d’apparence journalistique, vite faits et pas chers, pour meubler votre site? La firme américaine Narrative Science est imbattable : elle offre un abonnement à des textes rédigés par des... robots.
Certes, il faut que ce soient des comptes-rendus de la journée en finances — comme « la firme X a augmenté son bénéfice de Y » — ou des résumés de matchs sportifs des ligues mineures. Ce n’est pas demain la veille que le robot gagnera un prix de journalisme. Mais je ne serais pas étonné que l’équivalent soit déjà possible en science : « le chercheur X a annoncé hier la découverte Y dans la revue Z ».
Si un tel fil de presse existait, ceux qui lisent Découvrir n’y trouveraient certainement pas leur compte. Mais un nombre hélas assez élevé de lecteurs s’en satisferait. Il suffirait que des gestionnaires de sites jugent que ce nombre en vaut la peine, pour qu’ils s’abonnent à ces « textes-robots ».
En comparaison, quand l’Agence Science-Presse a été fondée en novembre 1978, il y a aujourd’hui 35 ans, c’était une autre époque : les hebdomadaires régionaux — les mêmes qui, à présent, sont composés à 85 % de publicités — étaient prêts à s’abonner à des reportages sur la science — des vrais! L’Agence s’inscrivait de plus dans une double décennie qui, chez nous, avait vu la naissance du Jeune naturaliste (1962) futur Québec Science, et de l’Association des communicateurs scientifiques (1976), tandis qu’aux États-Unis et en Europe, les journaux multipliaient leurs pages Science.
Depuis, deux évolutions ont frappé :
- L’univers des médias a vécu une dégradation des conditions de travail : les journaux ont coupé dans leurs salles de rédaction (et les pages Science sont disparues dans le processus); les chaînes de télé spécialisées se sont mises à produire des émissions d’affaires publiques avec des journalistes recherchistes qui sont embauchés pour des contrats de quelques semaines; les pigistes vivotent sur des tarifs au mot qui sont parfois les mêmes qu’il y a 30 ans; et au Québec, il n’est plus rare de tomber sur un journaliste employé... par deux hebdos!
- Les relations publiques, de leur côté, ont augmenté radicalement, ce qui est la meilleure chose qui soit arrivée depuis 35 ans à la communication scientifique : davantage d’opportunités pour des professionnels désireux de parler de science. Mais chaque médaille a son revers : une communication d’entreprise, aussi bien vulgarisée soit-elle, atteint parfois ses limites si elle ne peut parler que de son entreprise — et jamais en mal.
On aurait tort de croire que les scientifiques et leurs institutions n’ont pas de prise sur l’évolution délétère des médias. Un moment de l’histoire récente de la vulgarisation peut nous éclairer à ce sujet : en Amérique du Nord et en Europe, la double décennie de croissance s’est terminée par la création de nombreux magazines de qualité, tous disparus ensuite : chez nous, La Puce à l’Oreille, Science et technologie, Astronomie Québec, chez nos voisins du sud Science Digest, Science ’80, Omni...
Or, selon le professeur de communication scientifique Bruce Lewenstein, de l’Université Cornell, la cause de ce recul peut être en partie imputée à la communauté scientifique. Le public intéressé par ces magazines était par définition limité; ces médias auraient eu besoin, pour survivre, d’un appui des institutions — universités, conseils subventionnaires, etc. Or, cet appui ne s’est jamais manifesté.
Vaincre la méfiance
Il subsistera toujours une méfiance entre le scientifique et le journaliste. Le premier sera perpétuellement insatisfait des « simplifications » du deuxième, et sera toujours tenté de dire « ah, si c’était moi qui communiquais, ce serait tellement mieux... ». C’est dans cette perspective que des milliers de chercheurs et d’étudiants ont adopté avec enthousiasme les blogues. Certains se sont même mis à rêver tout haut : et si les blogueurs remplaçaient les journalistes?
«Il subsistera toujours une méfiance entre le scientifique et le journaliste».
Les années qui passent font toutefois apparaître un portrait plus nuancé : des chercheurs passionnés, qui communiquent avec talent et se bâtissent une belle crédibilité — des blogues comme Real Climate ou Bad Science — remplissent un vide ou répondent à un besoin, mais ils ne peuvent pas tout faire. Lorsque le New York Times a mis fin à sa couverture journalistique de l’environnement cette année, ou lorsqu’il est devenu clair que le Huffington Post avait choisi un modèle d’affaires qui remplace les journalistes rémunérés par des blogueurs bénévoles, même les scientifiques blogueurs se sont aperçus que l’information scientifique était perdante.
Et ce sera sans doute là l’enjeu des 35 prochaines années : redonner du tonus à un journalisme scientifique solide, critique et indépendant.
L’expérience manquée des années 1980 et l’expérience réussie des blogues de science ouvrent deux pistes de solutions :
1) Financement. Si les quotidiens ont fait disparaître leurs pages Science, c’est parce que personne ne s’en est plaint. Le jour où deux, trois, quatre institutions, demanderont à leur quotidien préféré que les publicités soient placées dans une page Science, le message montera très vite du vendeur de publicité jusqu’au rédacteur en chef.
Aux États-Unis, le magazine en ligne Pro Publica a été lancé en 2008 par une fondation vouée à soutenir le journalisme d’enquête. On lui doit entre autres une longue série d’articles sur le gaz de schiste. Pro Publica a remporté des prix de journalisme et d’autres mécènes se sont joints à l’entreprise. À quand une fondation vouée à soutenir la production de contenu de qualité en journalisme scientifique?
2) Partenariats. Plutôt que de lancer des projets chacun dans leur coin, chercheurs et institutions devraient s’associer à ce qui existe déjà. Ne pas espérer la perfection, mais viser le compromis entre les planètes de la science et de la communication. Deux modèles parmi d’autres : Climate Central et Yale Environment 360, qui tiennent tantôt du magazine, tantôt du groupe de réflexion, mais qui ont en commun de profiter de la plume de chercheurs et de journalistes.
Lorsque l’Agence Science-Presse a été fondée en 1978, les opportunités pour construire de telles expériences étaient à des années-lumière de ce qu’il est possible aujourd’hui sur Internet. Ce n’est pas un hasard si la communauté la plus dynamique que j’aie rencontrée en science soit celle de Science Online : un congrès annuel, des échanges sur Twitter à longueur d'année, des conversations, et ce entre des gens qui ont réalisé avoir tout intérêt à profiter de l’expérience des autres. Des chercheurs qui communiquent en dilettantes, des journalistes professionnels, et des hybrides entre les deux.
Imaginez si, avec la communauté des blogueurs, l’Agence Science-Presse réussissait la même chose. Ou si, à travers son anthologie francophone annuelle, elle réussissait à créer un lieu d’échange, amenant les scientifiques à mieux comprendre le travail des journalistes — et même, à l’apprécier.
Le journalisme scientifique est déjà loin de ce qu’il était en 1978. Qui peut dire ce qu’il sera en 2048?

- Pascal LapointeProfessionnel·le – médiasJournaliste scientifique
Pascal Lapointe est journaliste scientifique depuis une vingtaine d’années et a été directeur de l’Agence Science-Presse de 1996 à 2006. Au-delà de l’actualité scientifique, il a notamment écrit sur l’avenir du journalisme et des rapports entre blogues de science et médias. Il est chargé de cours en vulgarisation à l’Université de Montréal.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre