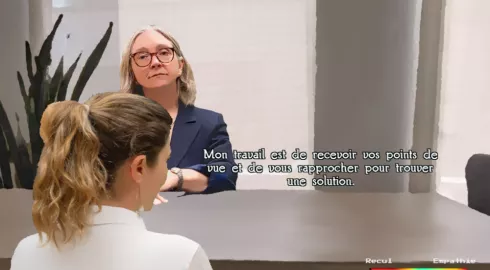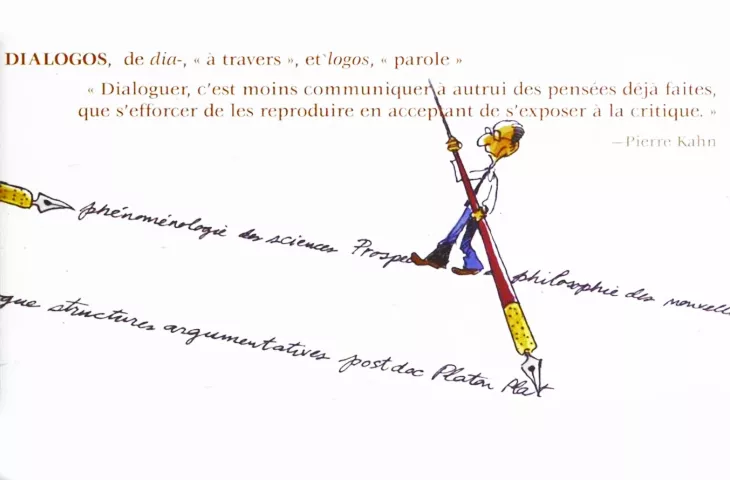Cette joie, elle vient essentiellement de ce que, dans tout le travail préparatoire aux cours, travail exigeant et incessant, j’apprends, j’apprends à chaque lecture, vivante par-delà le temps, merveille de ces textes que j’ai le loisir d’enseigner.
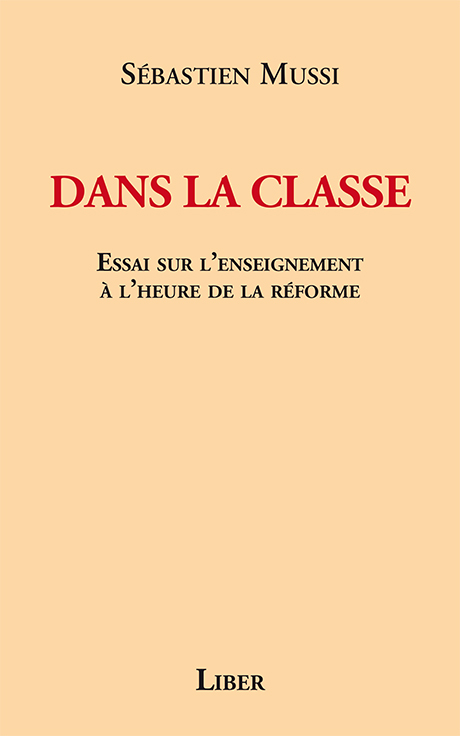
[Publié une première fois en avril 2013 dans le présent magazine]
Connaître, apprendre, enseigner
J’aimerais tout d’abord, et très brièvement, soulever une nuance qui me semble importante – du moins en ce qui concerne ce que je vais tenter de cerner ici – : connaître et apprendre, ce n’est pas tout à fait la même chose. « Apprendre » renvoie à un processus en devenir, alors que « connaître » concerne un savoir réalisé ou considéré comme un objectif (déterminé par qui?) à réaliser. C’est au (manque de) désir d’apprendre que je vais m’intéresser.
J’enseigne la philosophie au cégep. Cette discipline, il n’est pas inutile de le rappeler, jouit d’un statut particulier : tout d’abord, au plan institutionnel, chaque étudiant qui entend obtenir son DEC (diplôme d’études collégiales) doit réussir trois cours de philosophie (c’était quatre avant 1993-94), qui couvrent autant des domaines (rationalité, conception de l’être humain, éthique et politique) que des périodes historiques (Antiquité gréco-romaine, Moyen-Âge et Lumières, Modernité et Période contemporaine) : c’est dire que la philo est une matière obligatoire et que la personne qui l’enseigne a le redoutable privilège de voir passer dans ses classes la quasi totalité des étudiants d’un cégep, quels que soient leurs choix professionnels ou académiques. Ensuite, comme matière, la philosophie embrasse une ampleur temporelle peu commune, 2500 ans (au moins); elle offre ainsi un champ à la fois inépuisable et, disons-le, assez intimidant, dont l’ébauche de maîtrise exige évidemment de s’intéresser à d’autres domaines. Il me semble que, pour enseigner la philosophie, et dans un tel contexte, il ne faut jamais s’arrêter d’apprendre – et que, même, commencer à enseigner, c’est véritablement commencer à apprendre. Et sans doute cela est-il vrai de toute matière, l’étendue temporelle de la philosophie ne faisant que rendre ce constat un peu plus évident.
(À) l’école
Je dois avouer qu’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais tellement aimé apprendre. Je garde de l’école un souvenir plutôt angoissant, celui d’un lieu où la joie d’apprendre (ce « plaisir causé par des sensations […] en dehors même de [son] utilité » qu’évoque Aristote) n’avait que peu de place. Cette question du désir d’apprendre de l’étudiant, ce doute quant à l’existence de ce désir, n’est pas nouvelle – et il faut à mon sens souligner que c’est bien une question de prof : justement, qui d’autre pourrait bien la soulever, cette question? Une partie de la réponse tient tout simplement dans le fait même de l’école, considérée assez largement (consciemment ou non, en toute bonne foi ou non) et depuis longtemps comme une vaste entreprise de répression.
Et pourtant je suis encore à l’école.
Et pourtant, à mon tour, j’accepte de jouer ce rôle répressif que l’institution impose (car il faut bien noter, évaluer, sélectionner) aux professeurs. Moi aussi, je nourris l’angoisse de mes étudiants – lien fort entre l’angoisse et la note, explicitement formulé par une étudiante, au trimestre d'automne 2012 (celui de l'après grève), m'affirmant que la crainte de la note lui retire toute la joie qu’elle éprouve à écouter les cours…
Ces quelques maîtres m’ont bien montré ce que penser et enseigner pouvaient vouloir dire, que penser et enseigner vont de pair, que cela peut se faire dans la joie – et que la joie est la seule justification possible à ce que nous faisons.
Cette question, celle de ma présence, encore, à l’école, celle de longues, très longues études malgré le rapport pour le moins ambigu que j’entretiens avec l’institution, ne me quitte plus depuis que je suis passé de « l’autre côté » de la salle de classe, depuis que je suis celui qui inflige la note (et il ne s’agit pas ici d’autoflagellation : l’étudiant participe à ce processus, évidemment).
J’ai eu la chance, il est vrai, de rencontrer quelques professeurs exceptionnels, notamment (mais pas seulement, il faudrait remonter au jardin d’enfants sans doute, et je ne veux pas minimiser ce que certains profs du primaire, du secondaire ou du lycée ont pu me donner) à l’université – mais cela ne suffit pas à expliquer cette obstination à (en) rester là. Car si ces quelques maîtres m’ont bien montré ce que penser et enseigner pouvaient vouloir dire, que penser et enseigner vont de pair, que cela peut se faire dans la joie – et que la joie est la seule justification possible à ce que nous faisons –, mes rapports avec l’école ne se sont pas améliorés avec le temps; au contraire, si j’ai réussi, plus ou moins, à faire la paix avec l’école de ma jeunesse, celle que nous offrons (vendons?) aujourd’hui à nos jeunes me fait peur. J’y vois la négation de toute transmission, de tout savoir qui vaudrait par lui-même (gratuitement), de tout désir d’apprendre, une volonté de former (d’imposer une forme) et non plus du tout d’enseigner. Je me suis déjà par ailleurs étendu sur ce sujet (Dans la classe, Liber, 2012).
Que m’ont-il donc apporté, ces quelques maîtres qui, manifestement, selon la très belle expression de Daniel Pennac (Chagrin d’école), m’ont « sauvé de l’école »?
Du legs et du désir
Du jardin d’enfant au doctorat, une dizaine de noms, pas plus, me viennent à l’esprit (ma mémoire est sans doute un peu cruelle), 30 ans d’apprentissage dont la résultante est ma présence, pratiquement tous les jours, en classe, à raconter l’aventure de la pensée de ce que nous nommons (par commodité) l’Occident à une quarantaine d’adolescents… une gageure, un pari à bien des égards (on ne sait pas si ça marche, ni quoi). Une performance quotidienne que ces trois heures de cours, à peine interrompues par une pause-café. Il doit bien y avoir quelque chose.
Je crois que ce qu’ils m’ont donné, c’est précisément ce désir d’apprendre, désir confus et qui a mis bien du temps à se manifester – à la limite, maintenant seulement, alors que justement « on » ne s’attend plus à ce que j’apprenne –, désir d’apprendre encore et toujours, par la lecture et l’écriture bien souvent (mais je ne vois pas pourquoi cela devrait s’y limiter).
Il me semble ainsi que ce désir d’apprendre, dont on dit qu’il aurait déserté les étudiants, ou que les étudiants l’auraient désormais répudié, il vient, il ne peut venir, que des profs – d’eux autres, c’est-à-dire de nous; de moi.
Il me semble ainsi que ce désir d’apprendre, dont on dit qu’il aurait déserté les étudiants, ou que les étudiants l’auraient désormais répudié, il vient, il ne peut venir, que des profs – d’eux autres, c’est-à-dire de nous; de moi. J’ajoute que, malgré ce que j’en dis, j’ignore absolument si cela, je suis capable en effet de le donner à mon tour (c’est la gageure). Aucun moyen ne permet de le mesurer (heureusement!), les indices sont épars, quelques remerciements (autant de cadeaux!, les étudiants savent-ils à quel point ces remerciements, qui se font après, nous touchent et nous émeuvent?), les progrès aussi, constatés au tournant de chaque trimestre.
Désir d’apprendre : le prof
Le désir d’apprendre vient donc du prof. Et voilà qu’il me semble que ce n’est plus le désir d’apprendre de l’étudiant qui devrait soulever des questions : qu’en est-il, en effet, du désir d’apprendre du professeur? S’il ne l’a pas, ce désir, s’il se croit « arrivé », si tout son voyage dans la géographie de la pensée consiste en ce court trajet qui va du pupitre au bureau, comment peut-il montrer que la pensée est une aventure – tout comme la vie elle-même, la seule aventure qui soit. Comment initier au voyage?
C’est ce désir-là qui devrait être questionné. Et il s’agit d’une question éminemment pratique : comment s’émerveiller, année après année, classe après classe, cohorte après cohorte, comment s’émerveiller du génie de tel texte enseigné 10, 20, 50 fois? Luchini, récitant La Fontaine (« c’est la source », dit-il!) :
« ‘Un Rat, sans plus, s’abstient d’aller faire un tour; C’était un vieux routier, il savait plus d’un tour…’ Je crois que je le jouais depuis 25 ans – je ne suis pas encore usé, je suis encore capable de dire ‘Un Rat, sans plus, s’abstient’, tu te rends compte?! »
Pour ma part, je ne peux imaginer enseigner, c’est-à-dire me présenter devant 40 personnes tous les jours (j’insiste, on oublie trop à quel point l'enseignement est aussi une performance de scène, publique) et leur parler, sans ce désir de découvrir encore et toujours ce champ infini (un champ dépourvu de limite comme de centre! Magnifique champ que ce champ – c’est aussi celui de l’apprentissage) qu’est la philosophie.
Seulement voilà : cela exige du temps.
C’est une question pratique. Aussi.
Allumer le désir
Il me semble que nos institutions devraient tout faire pour maintenir cet amour de l’apprentissage vivant, et que cela devrait commencer par la reconnaissance que ce que le prof fait pour le nourrir et l’entretenir comme du travail, minimalement au même titre que les autres tâches désormais associées au « métier d’enseignant ». Et pour cela, il faut bien reconnaître la part incommensurable de ce travail : comment, en effet, mesurer le temps que cela prend pour comprendre Spinoza, Platon, Nietzsche…? Si la passion n'est pas là, le prof va se contenter du manuel idoine; si la passion n’est pas entretenue et rendue possible, c’est l’épuisement, l’usure et l’amertume qui guettent – et je me demande s’il y a quelque chose de pire qu’un professeur amer.
Or, actuellement, ces conditions de travail se détériorent. Non qu’elles soient inhumaines, évidemment – ce n’est pas la question, la question c’est d’avoir un enseignement et un enseignant qui soient là pour les élèves et les étudiants. Mais ces conditions, actuellement, impliquent une telle (auto)mobilisation infinie, permanente des professeurs pour d’autres tâches que celles reliées à l’enseignement que le temps manque pour l’incommensurable et que le désir d’apprendre ne trouve plus à s’exprimer. Elles impliquent aussi, de plus en plus, un jugement sur ce qu’est « un bon prof » en termes tellement administratifs que les questions évoquées ici ne peuvent que passer entre les mailles d’une telle tentative de balisage de la profession : car le bon prof, désormais, ce n’est plus celui dont le désir parvient parfois, toujours dans la plus extrême fragilité d’une parole toujours à reprendre et dont l’équilibre est sans cesse à retrouver, à animer sa matière.
J’aimerais encore dire la joie que j’ai à exercer le métier qui est le mien [...], car cette joie, elle est la condition pour que les étudiants, à leur tour, éprouvent le désir d’apprendre et de savoir.
Écrire fait, pour ma part, irrémédiablement partie de cet apprentissage, manière incontournable d’assimiler la matière, de la transformer pour pouvoir ensuite la délivrer aux étudiants; manière encore de comprendre ce que je fais « dans la classe ». Clément Rosset (Le choix des mots, Minuit, 1995), répondant à un haut fonctionnaire français qui s’étonnait de son désir d’écrire, de ce « dangereux supplément » (Derrida) à la pensée que serait l’écriture, lui penseur si sage et profond, récuse la distinction entre pensée et écriture, disons : entre la pensée et son expression. L'enseignement vivant, animé, empli d’un désir qui pourrait allumer les étudiants (je me permets de renvoyer ici au Banquet) et que l’on pourrait finalement transmettre, est une telle expression de la pensée. Il faudrait prendre garde à ce qu'elle reste possible, en tant qu'expression de la pensée.
J’aimerais encore dire la joie que j’ai à exercer le métier qui est le mien, la joie que j’ai, en classe, à initier ces adolescents au travail de la pensée, de l’écriture, de la lecture (en philo, mais cette joie doit être la même pour le prof de chimie qui partage une expérimentation avec ses étudiants), car cette joie, elle est la condition pour que les étudiants, à leur tour, éprouvent le désir d’apprendre et de savoir. Cette joie, elle vient essentiellement de ce que, dans tout le travail préparatoire aux cours, travail exigeant et incessant, j’apprends, j’apprends à chaque lecture, vivante par-delà le temps, merveille de ces textes que j’ai le loisir d’enseigner.
- Sébastien Mussi
Collège de Maisonneuve
Sébastien Mussi enseigne la philosophie au Collège de Maisonneuve. Il a aussi enseigné les sciences politiques à l’UQAM. Il a publié récemment Dans la classe : essai sur l’enseignement à l’heure de la réforme (Liber, 2012). Membre fondateur des Cahiers de l’idiotie, il a publié Le Nomos de l’Amérique en question, La merde (2008, 2012, avec D. Giroux) et Thierry Hentsch, et La pensée réversive (2008). Il a aussi agi à titre de chercheur associé au Groupe de travail Biotechnologies et destin de l’humanité de l’Association internationale des sociologues de langue française.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre