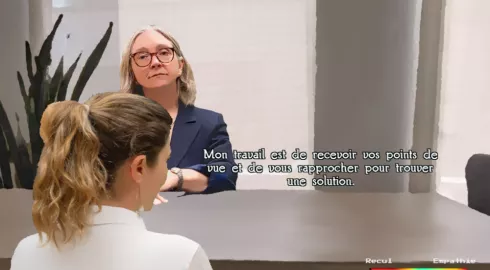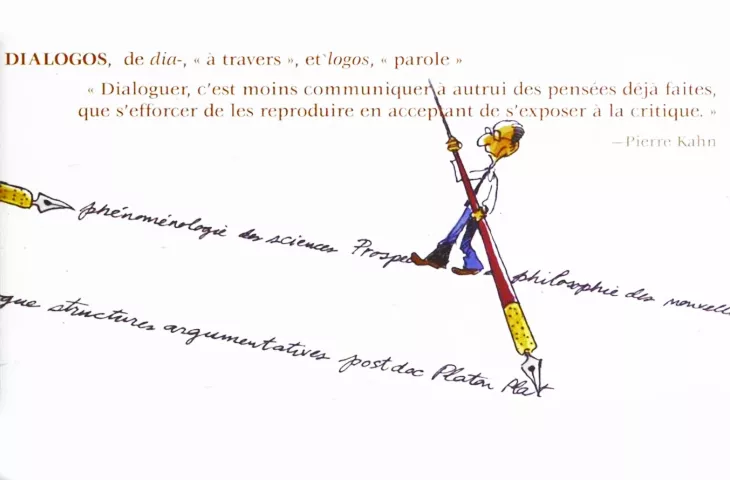Il y a un sérieux déséquilibre entre l’armada de recherche, d'une part, et les fantassins de sa valorisation et de son développement commercial, d'autre part.
En enseignement comme en recherche, les universités canadiennes s’acquittent avec brio de leur mission. Et année après année, nos chercheurs remportent des palmes d’or en termes de publications et d’excellence, et ce, tant au niveau national qu’international. Les résultats sont probants : le Canada, avec 0,5 % de la population mondiale et 2,4 % du PNB mondial, représente plus de 4 % des publications scientifiques. Comment se fait-il alors que depuis plus de 20 ans, l’OCDE attribue au Canada des mentions de médiocrité pour la commercialisation des résultats de recherche? Mentions qui frisent l’indécence pour un pays aussi technologiquement avancé.
Le Québec n'échappe pas à ce diagnostic canadien. Pourtant, n'avons-nous pas pris les dispositions nécessaires il y a une décennie en nous dotant de quatre sociétés de valorisation universitaires (SVU)? L’Université peut-elle encore se réfugier dans une bulle académique sans tenir compte des transitions et des pressions qui l’entourent? Le talon d’Achille soulevé par l’OCDE fait ressortir, entre autres, le déséquilibre entre l’armada de recherche, d'une part, et les fantassins de sa valorisation et de son développement commercial, d'autre part. C’est un peu comme si on avait investi massivement dans des sous-marins nucléaires sans avoir mis les ressources pour les approvisionner.
Un contexte fragile
Cette faiblesse du système de recherche québécois, juxtaposée au moment d’instabilité que vivent les universités présentement, laisse à penser qu’il sera difficile de faire beaucoup mieux en termes de retombées socioéconomiques sans une volonté politique forte.
Les universités sont actuellement sous la loupe très critique des éléments les plus sceptiques de la société civile, des gouvernements et… des étudiants. S’ajoutent les questionnements autour de l’influence que peut avoir le monde industriel sur la recherche universitaire, sur l’adéquation entre les besoins du marché du travail et la formation d’étudiants qualifiés, sur le dépassement des périodes prévues pour l’obtention des maîtrises et des doctorats, sur l’appui financier des jeunes leur permettant de compléter leurs études sans être ensevelis sous les dettes…
Les universités sont actuellement sous la loupe très critique des éléments les plus sceptiques de la société civile, des gouvernements et… des étudiants.
Bref, le défi n’est pas mince, car les attentes sont multiples et les intérêts divergents.
D’une part, les gouvernements aimeraient bien stimuler la croissance d’entreprises dérivées, moteur d’une société du savoir. Pour cela, le gouvernement du Québec devra concilier dans son prochain Sommet sur l'enseignement supérieur des demandes contradictoires et des réalités devant faire l’objet de débats de fond. D’autre part, les universités voudraient encore accroître leur arsenal de recherche, étant donné qu'il s'agit là d'un enjeu de compétition à l’échelle mondiale et d'un moyen d'assurer leur notoriété internationale – pour le recrutement d’étudiants et de chercheurs, entre autres.
Les étudiants, quant à eux, voudraient une meilleure prise en compte de leurs aspirations et une garantie d’accessibilité aux études, en plus de la remise en question de la gouvernance et du mode de financement des universités. D’ailleurs, n’ont-ils pas un peu raison de souligner les nombreuses dérives de certains administrateurs universitaires alors que le besoin de probité ressort si cruellement depuis quelque temps?
Enfin, les entreprises, elles, veulent avoir plein accès au savoir généré, à des ressources de qualité à bas coûts et à un dispositif de recherche, notamment grâce à des crédits d’impôts.
Les enjeux de valorisation
La valorisation des résultats de recherche au Québec est inférieure, par dollar investi, à celle du reste du Canada, selon un sondage canadien de l’Association of University Technology Managers (AUTM). De plus, la performance canadienne est bien inférieure aux résultats de nos voisins du sud, notamment en termes de revenus de licences, exception faite de Voice Age à l’Université de Sherbrooke.
Ainsi, non seulement le Canada traîne-t-il de la patte derrière les États-Unis en ce qui a trait aux revenus de licences, mais le Québec aligne un déficit de l’ordre de 25 % en termes d’inventions générées par dollar de R-D investi, par rapport au reste du Canada. De plus, on constate un déficit considérable pour ce qui est du nombre d’entreprises dérivées, soit 7 au Québec en 2011 contre 68 pour l'ensemble du Canada, toujours selon les statistiques d’AUTM. On en dénombrait 17 au Québec pour un total de 67 au Canada en 2001. Qui plus est, durant cette période de 2001 à 2011, le coût des activités de recherche engagées dans nos universités canadiennes passait de 1,8 à 5,4 milliards de dollars.
Plusieurs facteurs ont été avancés pour expliquer ces résultats : la valorisation a commencé plus tardivement au Canada, notre économie possède moins d’entreprises aptes à exploiter les inventions, la culture est moins entrepreneuriale et le goût du risque moins développé.
Certains questionnent aussi la validité des mesures quantitatives de l'AUTM touchant les SVU. Il reste que des repères demeurent inéluctables : le nombre d’inventions, le nombre de licences signées et le nombre d’entreprises dérivées créées. Mais peut-on ne pas tenir compte des revenus que les SVU génèrent et qui, dans une large mesure, reflètent leur impact socioéconomique? Le débat est de savoir quel degré d'importance y accorder, car les missions diffèrent suivant les établissements desservis par ces SVU.
La performance « apparente » du Québec a pu être maintenue jusqu'ici grâce à Voice Age, une invention issue de l’Université de Sherbrooke. Or, le Klondike que lui procure ces brevets de compression de la parole est en voie d’épuisement après 20 ans et avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Un succès commercial remarquable, mais exceptionnel. En conséquence, les statistiques sur les revenus de licences au Québec risquent de prendre bientôt un tout autre aspect et la comparaison avec le reste du Canada sera encore plus désavantageuse. En effet, les revenus de Voice Age représentent à eux seuls 65 % de l’ensemble des revenus de licences de source universitaire au Québec et 14 % de l’ensemble canadien. Un impact négatif additionnel sur la performance du Québec est à prévoir.
Le transfert et la valorisation des connaissances s’opèrent d'abord à travers les relations directes entre les chercheurs et les entreprises ou par le placement étudiant sur le marché du travail. Cependant, le rôle de catalyseur des organismes de valorisation est un service essentiel.
Le transfert et la valorisation des connaissances s’opèrent à bien plus grande échelle, que ce soit par les relations directes entre les chercheurs et les entreprises ou par le placement étudiant sur le marché du travail. Il est donc légitime de relativiser l'importance des unités de valorisation. En effet, les passerelles que procurent ces unités au sein des établissements universitaires jouent souvent un rôle de catalyseur dans cette dynamique de partenariat entreprises-universités. Et c'est cet aspect « service » qui est souvent négligé dans les mesures de performance. De plus, pour certains chercheurs prolifiques, la fonction de valorisation est un service essentiel.
Notons que les licences représentent environ 1 % de rendement sur le capital investi en R-D et que bien souvent le rendement est négatif si l’on tient compte des frais d’exploitation et de brevet. Les unités de valorisation ne sont donc pas des centres de profit, mais de services. Ceux qui pensaient que la valorisation pouvait financer la recherche pourraient être déçus.
Un effort québécois de 50 millions...
Au début des années 2000, la Bourse de Montréal, constatant une rupture de flux d’entreprises dérivées (start-ups), lance un exercice visant à convaincre le gouvernement d’agir et d'encourager l'émergence de nouvelles entreprises. Après analyse, on s'aperçoit que le pipe line en provenance des universités ne produit pas une relève apte à créer des PME ayant le potentiel requis pour s'inscrire sur les marchés boursiers.
Bernard Landry, avec détermination, introduit dans le budget du 9 mars 1999 un poste de 100 millions pour la création de Valorisation-Recherche Québec (VRQ), et le financement initial doit aller à la mise en place de SVU. Surpris, les recteurs font pression pour en faire dévier la moitié vers la recherche orientée en créant des consortiums de recherche, lesquels font école. Par ailleurs, avec 50 millions sur cinq ans, les SVU sont lancées et voient leurs contributions renouvelées depuis.
...et 10 ans après, nous sommes toujours en retard
Malgré des rapports « phares » (Fortier, STIC, Council of Canadian Academies, Jenkins), le thème de la commercialisation, de la valorisation, du transfert de connaissances, de l'engagement partenarial, autant de vocables suivant les époques, n'a été endossé que du bout des lèvres par la haute direction des universités canadiennes, à part de rares exceptions.
Il est clair que ces dernières ont à cœur le développement de leurs établissements respectifs et des chercheurs affiliés. Leur mission première est l’enseignement, et la recherche comme outil d’enseignement. L’enjeu de la commercialisation ou de l'innovation n’est pas au centre de leurs préoccupations – les universités régionales et les écoles de génie sont des exceptions.
Cependant, plus récemment, on a constaté un intérêt grandissant pour le partenariat entreprises-universités dans l'administration universitaire. Ce levier permet d'accroître le volume de recherche contractuelle et partenariale, et ce à partir d'approches diverses. Certaines sociétés sont impliquées dans la structuration de partenariats tels Univalor ou Sovar. D'autres, MSBi-V et Socpra, par exemple, se concentrent sur les licenses et les démarrages d'entreprises. On voit bien qu'il n'y a pas de modèle unique pour les SVU au Québec.
Les motivations dictent généralement les comportements. Ainsi, celle des vice-présidents à la recherche (VPR) est d’accroître le volume de recherche et l’excellence de celle-ci. La valorisation, pour eux, se place loin derrière, à moins qu’elle ne devienne un moyen pour attirer des activités de recherche. Pour leur part, les chercheurs veulent d’abord publier, et les retombées économiques ou sociétales sont, règle générale, plutôt secondaires. Ceci est aussi vrai aujourd’hui qu’il y a 20 ans.
Dans ce contexte, peut-on prétendre que les universités québécoises ont vraiment amorcé l’effort nécessaire pour pleinement valoriser leurs résultats de recherche? Ou ont-elles été réactives, s’ajustant aux impératifs des gouvernements et comptant sur leur générosité pour y arriver?
On attend encore que 5 % des fonds de recherche soit dédié à la valorisation...
Personnellement, je pense que c’est un rendez-vous manqué. Si nous nous étions rendus aux recommandations du rapport Fortier en dédiant 5 % des fonds de recherche à la valorisation, le présent débat « science et société », visant à démontrer l’impact de la recherche sur la société, serait fort probablement chose du passé.
Cette inefficience ne peut être attribuée ni à la complexité des enjeux, ni à la multiplicité des joueurs. La problématique est plus profonde, peut-être endémique.
Nos jeunes chercheurs ont beaucoup moins d’appréhensions que la génération précédente lorsqu’il s’agit de travailler en partenariat avec l’industrie.
D'une part, notons un effet générationnel : nos jeunes chercheurs ont beaucoup moins d’appréhensions que la génération précédente lorsqu’il s’agit de travailler en partenariat avec l’industrie. Les « cheveux gris », cette génération des baby-boomers, est plus frileuse, et elle inclue encore la plupart des administrateurs universitaires.
Dans le domaine social et celui des arts, on réalise maintenant qu’il existe un potentiel de rejoindre, commercialement ou non, la société et de l’influencer. A titre d’exemple, la plateforme VIH-TAVIE, une application web de soutien aux patients atteints du VIH qui vient d'être développée par des chercheurs du CHUM, de Polytechnique et de l'Université Laval en collaboration avec l'entreprise 360Medlink.
D’autre part, soulignons le fameux dilemme vocationnel. Les activités liées aux services à la communauté, au sens large, ne sont pas reconnues dans les mesures de performance des chercheurs. Les fonds subventionnaires encouragent de diverses manières les partenariats entreprise-université, mais il n’existe aucune mesure pour s’assurer que les résultats de la recherche dite libre, qui représente près des deux tiers des 3 milliards du budget octroyés annuellement, peuvent être traduits efficacement dans le secteur privé quand c’est pertinent.
Les moyens consacrés à la valorisation n’ont pas vraiment augmenté depuis une décennie alors qu’on constate une augmentation substantielle des fonds de recherche durant cette période. Kevin Lynch, ex-greffier du Conseil privé du gouvernement du Canada, affirmait récemment que le statu quo n'est plus une option et que les universités doivent travailler avec l'industrie dans un effort d'amélioration de notre productivité nationale.
Mais comment y arriver sans des courroies d’entrainement permettant à ces deux cultures, celle de l'université et celle de l'industrie, de se comprendre? Doit-on considérer l’Université comme un des portails de la vie économique ou au contraire laisser foisonner ce bouillon de culture indépendamment sans aucune préoccupation de nature commerciale? Certains trouvent réducteur de voir l’université exercer le rôle de courroie d’entrainement du monde économique. D’autres y voient un passage obligé vers des emplois de haut niveau ou des avancées technologiques. Sous de telles pressions, les universités se transformeraient-elles en instrument de développement économique? Autant d'enjeux au cœur de leurs états d’âme, de contre-courants, de leur vocation même et de leur structure organisationnelle. Est-il encore opportun de les considérer encore comme des tours d’ivoire? Un peu comme une bulle, sont-elles en train d'éclater?
Une solution : la triangulation universités-collèges-entreprise
L’entreprise considère que le chercheur universitaire, idéalement, serait à l’écoute de ses besoins et réagirait en lui proposant un programme structuré dans le temps lui permettant de surmonter ses défis technologiques à venir. Dans la réalité, les chercheurs ont aussi leurs propres impératifs, et ils ne sont pas tributaires de l’entreprise ni liés à elle.
Comment alors concilier ces deux univers, dans un esprit de respect mutuel de leurs valeurs et aspirations?
L’idéal serait une triangulation permettant aux CCTT d’être en première ligne et aux universités de répondre de manière plus structurée et fondamentale aux besoins des entreprises, notamment des PME.
Déjà, si les partenariats avec les entreprises étaient pris en compte dans les critères d’évaluation des chercheurs universitaires, dans les secteurs pertinents, un grand pas serait accompli. Les entreprises sont aussi partagées entre leurs objectifs immédiats et leurs besoins futurs. Elles voient l’université comme un moyen de défrichage des idées à long terme. Ce qui est un rôle valable et nécessaire.
Les cégeps, à travers leurs centres de transfert technologiques (CCTT), sont souvent mieux positionnés pour répondre à cette dynamique du court terme. L’idéal serait une triangulation permettant aux CCTT d’être en première ligne et aux universités de répondre de manière plus structurée et fondamentale aux besoins des entreprises, notamment des PME.
Dans 10 ans…
Nous pouvons tenter de nous rassurer en pensant qu’avec la prochaine politique nationale de recherche et d’innovation et des programmes tel Engage, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), nous aurons, dans 10 ans, tourné la page. Mais quelles sont les garanties? Il y a 10 ans, avec la création de VRQ et des SVU, nous espérions y arriver.
Que s’est-il donc passé? Pourquoi, avec ces injections de financement à répétition dans les SVU et plus d’une cinquantaine de professionnels hautement qualifiés dévoués à cette cause, n’avons-nous pu, durant cette décennie, égaler tout au mois le reste du Canada, sans même penser à nous rapprocher des résultats de nos collègues du sud? Avait-on trop misé sur le potentiel d'autofinancement des organismes de valorisation?
Certains diront que les États-Unis ont des conditions favorables qui expliquent nos différences, par exemple la proximité d’entreprises innovantes, la très forte présence d’entrepreneurs, une politique unifiée de propriété intellectuelle, entre autres. Ces facteurs ne sont pas négligeables et pourraient sans aucun doute contribuer à faire fructifier les investissements des organismes de valorisation de la recherche au Québec. Jusqu’ici, force est de constater que le statu quo observé en termes de ressources depuis une décennie n’a pas permis de tirer pleinement avantage de cet énorme effort de la recherche publique.
Devrions-nous nous inspirer des Français et de leurs efforts consentis dans le cadre du Grand Emprunt avec la création des sociétés d'accélération de transfert technologique (SATT) financées à travers l’Agence nationale de la recherche (l’ANR est l’équivalent du CRSNG) à hauteur de 1 milliard d’euros sur 10 ans et regroupant plusieurs établissements universitaires et instituts de recherche publics? Les SATT sont dotées de fonds propres de valorisation, favorisant à long terme le développement d’entreprises dérivées ainsi que de licences porteuses. Ce dernier ingrédient n’est pas négligeable et pourrait contribuer au succès des sociétés de valorisation québécoises.
Un système de recherche en évolution rapide
On observe une évolution rapide des universités depuis la Révolution tranquille. Dans les années 1960, elles deviennent des usines à diplômes visant l’établissement de compétences professionnelles de haut niveau; puis, dans les années 1980, elles entreprennent une montée en puissance de la recherche, pour se transformer dans les années 2000 en un véritable « mixage » industrie-université dans les domaines du génie et des sciences de la santé; enfin, plus récemment, elles adhèrent à des réseaux nationaux et internationaux de compétences sectorielles et intersectorielles, encouragées notamment par des programmes tels ceux des centres d’excellence du CRSNG.
Des partenariats comme le Consortium de recherche en aéronautique du Québec (CRIAQ), sous l'impulsion d’un cofinancement public-privé, se profile comme une des initiatives de calibre mondial.
Aujourd’hui, des notions de créativité entrepreneuriale dans un contexte multidisciplinaire prennent forme. Par exemple, la création de partenariats comme le Livestock Research and Innovation Corporation (LRIC) en Alberta ou le CRIAQ (Consortium de recherche en aéronautique du Québec), qui, sous l'impulsion d’un cofinancement public-privé, se profilent comme des initiatives de calibre mondial.
Les barrières disciplinaires traditionnelles s’écroulent au sein des universités, mais les regroupements se reforment autour de nouvelles thématiques : énergies vertes, matériaux avancés, communications sans fil, réchauffement climatique, pour ne prendre que quelques exemples. Ce modèle que les universités redoutent tant, soit la spécialisation sectorielle à l’échelle internationale, autour de masses critiques spécifiques à chacune d’entre elles, est-il en train de s'installer malgré tout?
Une effervescence d’initiatives
Depuis 50 ans, le monde industriel subit lui aussi des métamorphoses structurelles importantes. Aucun de ces deux mondes n’était prêt à ces transformations, à des rapprochements aussi intenses, mais les programmes gouvernementaux, aussi bien au Canada qu’en Europe, ont forcé ces partenariats. Opportunisme et logique économique ont prévalu. L’innovation ouverte est une des manifestations de ces changements de paradigme. Les hubs de créativité et les living labs en sont une autre. L’émergence d’initiatives d’entrepreneuriat et de mentorats intra-universitaires, voire d’incubation d’entreprises au sein même des programmes de premier et de deuxième cycle, permet d’espérer aussi un changement en profondeur, lequel semble prisé par les étudiants qui peuvent en bénéficier. L’approche pédagogique traditionnelle, didactique, est elle aussi remise en question.
C’est dans ce contexte qu'on doit se poser encore une fois la question des moyens à prendre pour capitaliser sur l'excellence de la recherche et faire en sorte que la société puisse en bénéficier.
- Alex Navarre
Numinor Conseil inc.
Alex Navarre a travaillé dans l’industrie, au gouvernement fédéral et dans l’administration universitaire, où il a contribué à mettre sur pied des unités de valorisation (Université McGill et Université Western). Il a implanté le premier bureau régional québécois du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et a participé au développement du concept de Quartier de l’innovation de Montréal. Il enseigne la gestion de la propriété intellectuelle à l’ÉTS et possède un baccalauréat de l’Université Laval, un Ph. D. de l’Université McGill et un MBA de l’Université Western.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre